no 23. mars 2003.
https://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP2303edito2.html
© Maureen Perkins and Mary Besemeres
Maureen Perkins and Mary Besemeres
Curtin University of Technology
|
|
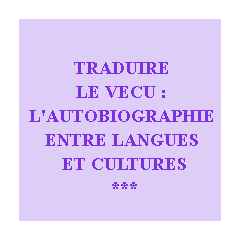
Si, comme le suggère la célèbre expression de L.P.
Hartley, "le passé est un autre pays", il est plus que probable qu'on y
parle une autre langue[1]. Tout souvenir est donc une traduction. Une telle
proposition n'a rien de bien original dans un climat post-moderne où le
pouvoir créateur de la langue est largement accepté. Toutefois,
le rôle de l'écriture autobiographique dans la formulation d'une
expérience interculturelle — le thème qui nous occupe ici — est
plus spécifique ; et dans la mesure où le nombre de personnes
exprimant cette rencontre de l'interculturalité et de l'écriture
est de plus en plus grand, ce rôle requiert qu'on s'y intéresse de
manière urgente.
Quelles que soient nos expériences enfantines, ces dernières ont été déterminées — du moins en partie — par le vocabulaire de l'enfant que nous étions. Dès lors, lorsque nous essayons d'exprimer ces expériences en faisant appel à notre savoir linguistique d'adulte, nous clarifions ce qui, à l'époque, était encore flou ; nous fixons ce qui n'était alors que fluidité. L'espace à enjamber est plus grand encore lorsqu'on écrit son autobiographie dans une langue qui n'est pas celle de son enfance et que l'on ajoute un second niveau de traduction à celui de la mémoire : celui de l'espace entre les cultures. De telles traductions interculturelles de soi-même sont de plus en plus fréquentes à une époque où la population du monde entier est sujette à un flux constant de migrations transnationales. Non seulement les personnes vivant dans un pays où leur langue d'origine n'est pas la langue dominante de la société dans laquelle elles vivent sont de plus en plus nombreuses, mais le flot des personnes proposant une réflexion d'elles mêmes par le biais de l'écriture, semble être sans précédant.
Un livre plus que tout autre a sans doute contribué à lancer le nouveau genre auquel on a donné le nom de "mémoire de langage". C'est Lost in Translation : A life in a New Language [Perdu en traduction : une vie dans une nouvelle langue] d'Eva Hoffman, publié en 1989. L'auteur qui émigra au Canada à l'âge de 13 ans fut la première à utiliser le terme d'"auto-traduction" (self translation) pour exprimer son expérience et son désir de traduire deux mondes conceptuels et affectifs différents : celui de la langue d'origine et celui d'une langue apprise ultérieurement. On retrouvera la même intention dans Métisse Blanche — l'autobiographie publiée en 1989 par Kim Lefèvre, une auteur franco-vietnamienne. Quand bien même Lefèvre propose son ouvrage sous l'étiquette de "roman" et non pas celle d'"autobiographie" — soulignant par là que lorsque sa mémoire lui renvoie les échos d'un passé pour elle très lointain, elle a l'impression que ce passé échappe à la réalité — les souvenirs de la petite Vietnamienne, fille d'un soldat français abandonnée dans un orphelinat, ont permis à l'auteur de se retrouver. Une interview de Lefèvre avec Nathalie Nguyen est proposée à la fin de ce numéro.
Les ouvrages d'Eva Hoffman et de Kim Lefèvre illustrent bien la problématique soulevée dans ce numéro de Mots Pluriels : Dans quelle mesure l'autobiographie est-elle nécessairement une traduction de cet autre pays qu'on appelle le passé? A quels obstacles — semés sur la route du souvenir — l'individu qui vit, pense et écrit dans une langue qui n'est pas sa première langue doit-il faire face? Et quelles formes ces obstacles prennent-ils pour les lecteurs qui ne savent rien de la langue et de la culture d'origine de l'auteur ?
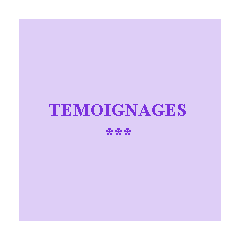
Notre premier article proposé par ![]() est le
fruit d'une expérience directe des phénomènes migratoires
contemporains. L'auteur, qui a émigré de Chine en Australie il y
a quelques années, souligne les énormes différences
culturelles qui séparent les deux cultures auxquelles elle appartient
désormais. Différences d'attitudes, mais aussi différences
linguistiques et Ye affirme: "Il n'est pas de jour, où je ne voyage
entre l'anglais, le Mandarin ou le Shanghailais, ma langue d'origine". Le
silence même semble être soumis à cette pluralité,
comme en témoigne la relation de l'auteur avec sa mère qui, lors
d'une visite en Australie, partage avec sa fille une manière "chinoise"
d'être et de penser qui se situe au-delà des mots. En
dépit des moments difficiles qui marquent ce va-et-vient entre deux
cultures, Ye souligne aussi la richesse de cette dualité. Elle montre de
manière émouvante la façon dont les deux manières
d'exprimer ses émotions en fonction des normes chinoises et
australiennes auxquelles elle doit se conformer — et parfois la
difficulté et la nécessité de choisir entre ces deux
manières contradictoires de s'exprimer — façonne son
identité publique et privée. De cette dualité difficile
à gérer, semble pourtant émerger une satisfaction
certaine, celle de la découverte et de la reconstruction de soi.
est le
fruit d'une expérience directe des phénomènes migratoires
contemporains. L'auteur, qui a émigré de Chine en Australie il y
a quelques années, souligne les énormes différences
culturelles qui séparent les deux cultures auxquelles elle appartient
désormais. Différences d'attitudes, mais aussi différences
linguistiques et Ye affirme: "Il n'est pas de jour, où je ne voyage
entre l'anglais, le Mandarin ou le Shanghailais, ma langue d'origine". Le
silence même semble être soumis à cette pluralité,
comme en témoigne la relation de l'auteur avec sa mère qui, lors
d'une visite en Australie, partage avec sa fille une manière "chinoise"
d'être et de penser qui se situe au-delà des mots. En
dépit des moments difficiles qui marquent ce va-et-vient entre deux
cultures, Ye souligne aussi la richesse de cette dualité. Elle montre de
manière émouvante la façon dont les deux manières
d'exprimer ses émotions en fonction des normes chinoises et
australiennes auxquelles elle doit se conformer — et parfois la
difficulté et la nécessité de choisir entre ces deux
manières contradictoires de s'exprimer — façonne son
identité publique et privée. De cette dualité difficile
à gérer, semble pourtant émerger une satisfaction
certaine, celle de la découverte et de la reconstruction de soi.
Témoignant d'un mouvement migratoire vers l'Australie un peu plus
ancien, ![]() relate avec perspicacité — et non sans humour — ce
que représentait dans les années 1970 le fait d'être une
teenager installée inconfortablement à la frontière de
deux mondes, de deux cultures résolument différentes.
Partagée entre les exigences du monde scolaire anglo-australien dans
lequel elle évoluait et son univers familial, fortement attachée
à ses racines ukrainiennes et à son histoire, l'auteur
évoque quelques épisodes frappants qui illustrent le choc de ces
deux pôles de son existence : des épisodes humiliants,
déroutants et souvent associés, à l'époque,
à un sentiment de culpabilité mais aujourd'hui riches d'ironie et
source d'expérience. Son essai republié dans Mots Pluriels
avec quelques illustrations montre avec éloquence combien il est
important de s'aventurer au-delà de la surface des choses dans tout
dialogue interculturel, en Australie comme ailleurs.
relate avec perspicacité — et non sans humour — ce
que représentait dans les années 1970 le fait d'être une
teenager installée inconfortablement à la frontière de
deux mondes, de deux cultures résolument différentes.
Partagée entre les exigences du monde scolaire anglo-australien dans
lequel elle évoluait et son univers familial, fortement attachée
à ses racines ukrainiennes et à son histoire, l'auteur
évoque quelques épisodes frappants qui illustrent le choc de ces
deux pôles de son existence : des épisodes humiliants,
déroutants et souvent associés, à l'époque,
à un sentiment de culpabilité mais aujourd'hui riches d'ironie et
source d'expérience. Son essai republié dans Mots Pluriels
avec quelques illustrations montre avec éloquence combien il est
important de s'aventurer au-delà de la surface des choses dans tout
dialogue interculturel, en Australie comme ailleurs.
L'article de ![]() qui pourrait certainement aussi figurer dans
notre rubrique "Perspectives critiques", combine le témoignage
autobiographique et la réflexion critique. Ce texte propose une
reconceptualisation de l'expérience des D.P. — les personnes
déplacées à la fin de la Deuxième guerre mondiale
— en prenant pour point de départ le père de l'auteur et sa vie
en Ukraine et en Australie. L'extrait de l'histoire du père — traduit
de l'ukrainien — qui conclut le texte de Longley souligne le voile de
tristesse qui enveloppe à l'infini la vie "ordinaire" de ceux et de
celles qui ont jadis tout perdu. Il montre aussi l'importance vitale du
témoignage et de la réminiscence dans la formulation des valeurs
personnelles et sociales tant pour les réfugiés que pour les
populations qui les accueillent.
qui pourrait certainement aussi figurer dans
notre rubrique "Perspectives critiques", combine le témoignage
autobiographique et la réflexion critique. Ce texte propose une
reconceptualisation de l'expérience des D.P. — les personnes
déplacées à la fin de la Deuxième guerre mondiale
— en prenant pour point de départ le père de l'auteur et sa vie
en Ukraine et en Australie. L'extrait de l'histoire du père — traduit
de l'ukrainien — qui conclut le texte de Longley souligne le voile de
tristesse qui enveloppe à l'infini la vie "ordinaire" de ceux et de
celles qui ont jadis tout perdu. Il montre aussi l'importance vitale du
témoignage et de la réminiscence dans la formulation des valeurs
personnelles et sociales tant pour les réfugiés que pour les
populations qui les accueillent.
Le texte extrêmement évocateur proposé par ![]() fait penser à une sorte de haiku en prose. En l'espace d'une
page, la narratrice qui se considère tour à tour
"franco-tunisienne" et "tunisio-française" montre le caractère
instable et fluctuant de son allégeance aux deux cultures dont elle se
réclame. Il serait vain, dit-elle, d'essayer de comprendre le
va-et-vient de l'individu entre ces deux pôles d'attraction en termes de
passeports ou de nationalité. L'expérience interculturelle se
situe au-delà des définitions identitaires administratives qui
n'arrivent à en saisir ni la complexité, ni le caractère
instable. "Mon histoire", dit-elle, "commence tous les matins dans le monde:
l'appel du muezzin qui m'émeut, le tohu-bohu des klaxons qui me
révoltent. Puis le sentiment soudain qu'il aurait été doux
que ma porte s'ouvre plutôt sur les quais parisiens..."
fait penser à une sorte de haiku en prose. En l'espace d'une
page, la narratrice qui se considère tour à tour
"franco-tunisienne" et "tunisio-française" montre le caractère
instable et fluctuant de son allégeance aux deux cultures dont elle se
réclame. Il serait vain, dit-elle, d'essayer de comprendre le
va-et-vient de l'individu entre ces deux pôles d'attraction en termes de
passeports ou de nationalité. L'expérience interculturelle se
situe au-delà des définitions identitaires administratives qui
n'arrivent à en saisir ni la complexité, ni le caractère
instable. "Mon histoire", dit-elle, "commence tous les matins dans le monde:
l'appel du muezzin qui m'émeut, le tohu-bohu des klaxons qui me
révoltent. Puis le sentiment soudain qu'il aurait été doux
que ma porte s'ouvre plutôt sur les quais parisiens..."
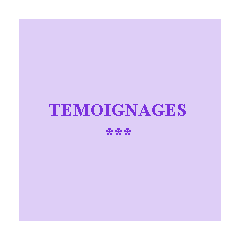
Publié en 1994, French lessons [Les leçons de
français] de l'auteur américaine ![]() retrace la
manière dont la narratrice tombe amoureuse de la langue
française. Ce récit représente une variation
intéressante des mémoires de langues et l'article proposé
par Alice Kaplan dans ce numéro de Mots Pluriels offre une
réflexion autobiographique fascinante sur la traduction de soi au
carrefour de la langue littéraire et des cultures. La narratrice y
relate ses démêlés avec le traducteur de son ouvrage en
français avant d'élargir son propos aux aléas de plusieurs
traductions littéraires ayant prêté à controverse
pour des raisons légales, éthiques ou politiques, celles de
Brontë, de Nabokov et de Céline entre autres.
retrace la
manière dont la narratrice tombe amoureuse de la langue
française. Ce récit représente une variation
intéressante des mémoires de langues et l'article proposé
par Alice Kaplan dans ce numéro de Mots Pluriels offre une
réflexion autobiographique fascinante sur la traduction de soi au
carrefour de la langue littéraire et des cultures. La narratrice y
relate ses démêlés avec le traducteur de son ouvrage en
français avant d'élargir son propos aux aléas de plusieurs
traductions littéraires ayant prêté à controverse
pour des raisons légales, éthiques ou politiques, celles de
Brontë, de Nabokov et de Céline entre autres.
La psychologie familière de la traduction à laquelle fait
allusion Kaplan dans son article est aussi pertinente à l'article de ![]() et
et ![]() . Cet article témoigne de l'activité du
groupe féministe "East meets West" [L'Orient rencontre
l'Occident] constitué lors de la 4ème Conférence mondiale
des femmes qui se tint à Beijing en 1995. Un des buts du groupe
consistait à élaborer un langage et un cadre conceptuel communs
qui soient en mesure de favoriser les échanges entre les Chinoises et
les femmes du reste du monde. Cela devait déboucher sur la traduction en
chinois d'articles féministes occidentaux en anglais et leur publication
dans la presse féminine chinoise. D'autres traductions suivirent,
certaines du chinois en anglais, rendant les participantes au projet de plus en
plus conscientes du fait que la traduction n'est pas uniquement une question de
mots, mais aussi de culture linguistique. Bien que les histoires qu'elles
furent amenées à traduire ne fussent pas directement les leurs,
l'engagement des auteurs dans le domaine de la traduction influença
profondément leur propres destinées, celles des autres membres du
groupe et de toutes celles qui ont lu leur travail.
. Cet article témoigne de l'activité du
groupe féministe "East meets West" [L'Orient rencontre
l'Occident] constitué lors de la 4ème Conférence mondiale
des femmes qui se tint à Beijing en 1995. Un des buts du groupe
consistait à élaborer un langage et un cadre conceptuel communs
qui soient en mesure de favoriser les échanges entre les Chinoises et
les femmes du reste du monde. Cela devait déboucher sur la traduction en
chinois d'articles féministes occidentaux en anglais et leur publication
dans la presse féminine chinoise. D'autres traductions suivirent,
certaines du chinois en anglais, rendant les participantes au projet de plus en
plus conscientes du fait que la traduction n'est pas uniquement une question de
mots, mais aussi de culture linguistique. Bien que les histoires qu'elles
furent amenées à traduire ne fussent pas directement les leurs,
l'engagement des auteurs dans le domaine de la traduction influença
profondément leur propres destinées, celles des autres membres du
groupe et de toutes celles qui ont lu leur travail.
Un autre témoignage personnel de traduction en collaboration est
proposé par
![]() qui travailla avec Almamy Maliki Yattara
à la production de l'autobiographie de ce dernier. L'ouvrage se trouve
à l'intersection de la biographie et de l'autobiographie dans la mesure
où le texte, écrit à la première personne par
Salvaing, est bel et bien l'histoire d'Almamy — sage, historien et marabout
d'origine malienne — Salvaing n'étant là qu'au titre
d'écrivain-traducteur, la langue première d'Almamy n'étant
pas le français. Les raisons ayant poussé les deux hommes
à traduire en français un récit de vie fortement
enraciné dans l'oralité et la culture malienne sont propres
à chacun d'eux et elles expriment différents buts,
différentes traditions de la transmission du savoir et de
l'érudition, Mais au-delà de ce qui les sépare, les deux
auteurs — qui considèrent tous deux l'ouvrage comme "leur livre" —
s'offrent mutuellement l'occasion d'accéder au monde de l'autre et
d'engager un dialogue interculturel significatif. Comme le dit Salvaing:
"Peut-être en effet ce que je cherchais en Afrique était-il la
capacité de sortir de moi-même et à m'imbiber d'une culture
extérieure assez profondément pour la vivre de
l'intérieur".
qui travailla avec Almamy Maliki Yattara
à la production de l'autobiographie de ce dernier. L'ouvrage se trouve
à l'intersection de la biographie et de l'autobiographie dans la mesure
où le texte, écrit à la première personne par
Salvaing, est bel et bien l'histoire d'Almamy — sage, historien et marabout
d'origine malienne — Salvaing n'étant là qu'au titre
d'écrivain-traducteur, la langue première d'Almamy n'étant
pas le français. Les raisons ayant poussé les deux hommes
à traduire en français un récit de vie fortement
enraciné dans l'oralité et la culture malienne sont propres
à chacun d'eux et elles expriment différents buts,
différentes traditions de la transmission du savoir et de
l'érudition, Mais au-delà de ce qui les sépare, les deux
auteurs — qui considèrent tous deux l'ouvrage comme "leur livre" —
s'offrent mutuellement l'occasion d'accéder au monde de l'autre et
d'engager un dialogue interculturel significatif. Comme le dit Salvaing:
"Peut-être en effet ce que je cherchais en Afrique était-il la
capacité de sortir de moi-même et à m'imbiber d'une culture
extérieure assez profondément pour la vivre de
l'intérieur".
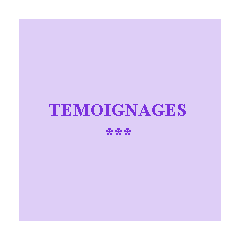
![]() qui arriva en France en 1968, fut elle aussi appelée
à 'vivre une culture extérieure de l'intérieur'. De tout
temps les Béninoises ont exercé un pouvoir important dans leur
pays, mais ce n'est que depuis les Indépendances que plusieurs d'entre
elles ont été amenées à prendre le chemin du Nord
pour se familiariser avec la culture occidentale et y poursuivre des
études universitaires. Comme ses soeurs africaines, Adjahi a
tenté pendant toute sa vie de réconcilier l'ouverture et les
valeurs communautaires de sa culture d'origine avec l'individualisme et les
portes closes de la culture d'accueil. Stimulée plutôt que
découragée par les conditions de vie difficiles auxquelles elle a
dû faire face lors de son arrivée, elle a poursuivi ses
études jusqu'au doctorat (en géographie). Toutefois, dit-elle
dans le texte autobiographique qu'elle nous propose, c'est vers
l'oralité et les légendes de son enfance qu'elle se tourne
à l'heure de dire son histoire et de témoigner de sa vie en
situation interculturelle. C'est aussi son attachement à
l'oralité qui facilite ses relations non seulement avec ses concitoyens
mais aussi avec la société française en
général. "Raconter et écouter" devient une manière
de rapprocher la culture d'origine de celle du pays d'accueil. "Quand l'envie
de raconter des contes africains m'a saisie," dit-elle, " je n'ai pas eu de mal
à retrouver un certain nombre de contes de mon enfance. Sur
scène, j'avais l'impression de lire sur mon écran
intérieur".
qui arriva en France en 1968, fut elle aussi appelée
à 'vivre une culture extérieure de l'intérieur'. De tout
temps les Béninoises ont exercé un pouvoir important dans leur
pays, mais ce n'est que depuis les Indépendances que plusieurs d'entre
elles ont été amenées à prendre le chemin du Nord
pour se familiariser avec la culture occidentale et y poursuivre des
études universitaires. Comme ses soeurs africaines, Adjahi a
tenté pendant toute sa vie de réconcilier l'ouverture et les
valeurs communautaires de sa culture d'origine avec l'individualisme et les
portes closes de la culture d'accueil. Stimulée plutôt que
découragée par les conditions de vie difficiles auxquelles elle a
dû faire face lors de son arrivée, elle a poursuivi ses
études jusqu'au doctorat (en géographie). Toutefois, dit-elle
dans le texte autobiographique qu'elle nous propose, c'est vers
l'oralité et les légendes de son enfance qu'elle se tourne
à l'heure de dire son histoire et de témoigner de sa vie en
situation interculturelle. C'est aussi son attachement à
l'oralité qui facilite ses relations non seulement avec ses concitoyens
mais aussi avec la société française en
général. "Raconter et écouter" devient une manière
de rapprocher la culture d'origine de celle du pays d'accueil. "Quand l'envie
de raconter des contes africains m'a saisie," dit-elle, " je n'ai pas eu de mal
à retrouver un certain nombre de contes de mon enfance. Sur
scène, j'avais l'impression de lire sur mon écran
intérieur".
Un autre parcours étroitement lié à l'apprentissage et la
poursuite du savoir est celui d' ![]() . Après avoir grandi en Côte d'Ivoire, la jeune femme émigra
d'abord au Burkina Faso — le pays d'origine de ses parents — afin d'y
entreprendre ses études universitaires. Au terme de celles-ci, elle prit
la route du Canada pour y faire un doctorat. Son texte témoigne d'un
périple au pays de l'interculturalité et il souligne la
différence de perception identitaire de l'individu et de la
société qui l'entoure. Il montre les difficultés
résultant de l'attachement de la narratrice au Burkina, quant elle
était enfant, et les pressions de ses camarades ivoiriens; mais il
prend aussi la mesure du caractère aléatoire des
prétentions identitaires : en dépit de son attachement au pays de
ses parents, la narratrice est traitée
de diaspo et elle est considérée comme une Ivoirienne au
Burkina, à cause de son accent, et plus tard de Canadienne lorsqu'elle s'établit au Canada. Dès
lors, partagée entre différents mondes, elle joue la carte de
l'interculturalité et affirme: "Je me sens partout chez moi en Afrique!
Mais aussi ailleurs! Je travaille à me sentir chez moi partout où
je me trouve".
. Après avoir grandi en Côte d'Ivoire, la jeune femme émigra
d'abord au Burkina Faso — le pays d'origine de ses parents — afin d'y
entreprendre ses études universitaires. Au terme de celles-ci, elle prit
la route du Canada pour y faire un doctorat. Son texte témoigne d'un
périple au pays de l'interculturalité et il souligne la
différence de perception identitaire de l'individu et de la
société qui l'entoure. Il montre les difficultés
résultant de l'attachement de la narratrice au Burkina, quant elle
était enfant, et les pressions de ses camarades ivoiriens; mais il
prend aussi la mesure du caractère aléatoire des
prétentions identitaires : en dépit de son attachement au pays de
ses parents, la narratrice est traitée
de diaspo et elle est considérée comme une Ivoirienne au
Burkina, à cause de son accent, et plus tard de Canadienne lorsqu'elle s'établit au Canada. Dès
lors, partagée entre différents mondes, elle joue la carte de
l'interculturalité et affirme: "Je me sens partout chez moi en Afrique!
Mais aussi ailleurs! Je travaille à me sentir chez moi partout où
je me trouve".
Alors que certains s'observent au miroir de leur écriture, l'auteur
canadienne
![]() affirme, d'un point de vue personnel,
littéraire et artistique, que ses écrits ne sont pas une
traduction mais une part indissociable d'elle-même; ils sont ce qu'elle
est. Considérant que la vie et l'écriture sont deux facettes de
la même expérience, sa conception de l'écrit — qu'il soit
autobiographique ou non — réfute l'existence d'un espace entre ces deux
éléments. Son article remet donc en cause l'idée
d'autobiographie-traduction proposée plus haut et suggère
l'idée, pour paraphraser E.M. Forster, qu'on écrit pour savoir
qui l'on est. "Dans l'écriture comme dans toutes les autres aventures
humaines," dit Daviau, "je crois que le commencement n'est toujours que
l'après coup."
affirme, d'un point de vue personnel,
littéraire et artistique, que ses écrits ne sont pas une
traduction mais une part indissociable d'elle-même; ils sont ce qu'elle
est. Considérant que la vie et l'écriture sont deux facettes de
la même expérience, sa conception de l'écrit — qu'il soit
autobiographique ou non — réfute l'existence d'un espace entre ces deux
éléments. Son article remet donc en cause l'idée
d'autobiographie-traduction proposée plus haut et suggère
l'idée, pour paraphraser E.M. Forster, qu'on écrit pour savoir
qui l'on est. "Dans l'écriture comme dans toutes les autres aventures
humaines," dit Daviau, "je crois que le commencement n'est toujours que
l'après coup."
![]() et
et ![]() sont toutes deux des danseuses et elles mettent l'accent sur la visibilité d'une catégorie
particulière d'expérience interculturelle: celle des personnes
d'origine mixte. Plus que la traduction linguistique qui n'est pas au coeur
de leur préoccupation, les auteurs font appel au concept de
"hapa" qui exprime l'idée d'une "demi-appartenance" pour se
définir. Chatterjee et Moorty sont toutes deux "à moitié
indiennes" et de ce fait, elles incarnent un sorte de rencontre entre l'Orient
et l'Occident sans pour autant représenter vraiment l'un ou l'autre.
Dès lors, elles essayent d'échapper au système binaire
rigide qui les menace. Refusant que leur art soit mis au service d'une vision
essentielle et stéréotypée de l'Inde, leur but est de
résister aux pressions visant à accentuer un monoculturalisme
rigide et de proposer au public le spectacle de leur identité
interculturelle. A l'aise face à leur double-appartenance, elles
entendent mettre leur talent au service de leur double héritage culturel
et elles soulignent les possibilités d'une approche interculturelle
à l'intersection de deux systèmes de signes différents.
sont toutes deux des danseuses et elles mettent l'accent sur la visibilité d'une catégorie
particulière d'expérience interculturelle: celle des personnes
d'origine mixte. Plus que la traduction linguistique qui n'est pas au coeur
de leur préoccupation, les auteurs font appel au concept de
"hapa" qui exprime l'idée d'une "demi-appartenance" pour se
définir. Chatterjee et Moorty sont toutes deux "à moitié
indiennes" et de ce fait, elles incarnent un sorte de rencontre entre l'Orient
et l'Occident sans pour autant représenter vraiment l'un ou l'autre.
Dès lors, elles essayent d'échapper au système binaire
rigide qui les menace. Refusant que leur art soit mis au service d'une vision
essentielle et stéréotypée de l'Inde, leur but est de
résister aux pressions visant à accentuer un monoculturalisme
rigide et de proposer au public le spectacle de leur identité
interculturelle. A l'aise face à leur double-appartenance, elles
entendent mettre leur talent au service de leur double héritage culturel
et elles soulignent les possibilités d'une approche interculturelle
à l'intersection de deux systèmes de signes différents.
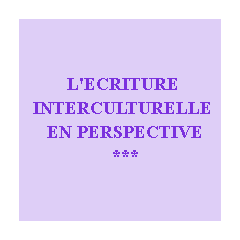
La seconde partie de ce numéro "Traduire le vécu" commence par
trois articles concernant la littérature beure, c'est-à-dire les
oeuvres des enfants des immigrants maghrébins domiciliés surtout
en France. La littérature beure a connu ses heures de gloire dans les
année 1980 et les oeuvres qui s'y rattachent ont provoqué de nombreux débats
sur l'idée de double identité culturelle et linguistique.
Le texte d' ![]() propose une analyse de l'autobiographie
de la journaliste et écrivaine Mélina Gazsi (1999) et il porte
une attention particulière à la relation de la narratrice avec
son père, un Algérien qui a abandonné Mélina et sa
mère, française, quand Mélina était toute petite.
Hantée par cette absence et maintenue dans l'ignorance par la
mère qui refuse de répondre à ses questions, Mélina
essaie de retrouver l'image du père dans sa propre image: "Tout ce que
je sais de lui, c'est le miroir qui me l'a appris. C'est un négatif, la
partie manquante de ce que je connais trop bien. Et chaque jour en me brossant
les cheveux, je m'arrête sur la ligne du nez. Fine et
légèrement busquée. J'ai un profil arabe. Cela ne saute
aux yeux de personne, pour moi c'est une obsession."
propose une analyse de l'autobiographie
de la journaliste et écrivaine Mélina Gazsi (1999) et il porte
une attention particulière à la relation de la narratrice avec
son père, un Algérien qui a abandonné Mélina et sa
mère, française, quand Mélina était toute petite.
Hantée par cette absence et maintenue dans l'ignorance par la
mère qui refuse de répondre à ses questions, Mélina
essaie de retrouver l'image du père dans sa propre image: "Tout ce que
je sais de lui, c'est le miroir qui me l'a appris. C'est un négatif, la
partie manquante de ce que je connais trop bien. Et chaque jour en me brossant
les cheveux, je m'arrête sur la ligne du nez. Fine et
légèrement busquée. J'ai un profil arabe. Cela ne saute
aux yeux de personne, pour moi c'est une obsession."
Au cours des années 80, la littérature beure exprima le choc des
cultures auquel les enfants des immigrés nord africains devaient faire
face. Les écrits autobiographiques de Tadjer et Kanzi analysés
par ![]() témoignent d'une fracture et d'une division du
moi fréquente chez les jeunes de cette deuxième
génération. Pour ces auteurs, souvent abandonnés à
leur solitude et à leur crise identitaire, l'écriture offre le
moyen de mettre au défi la xénophobie et les nombreux
stéréotypes qui ont cours dans la population de souche; elle
offre aussi l'occasion de remettre en cause les traditions culturelles et
religieuses rigides symbolisées par leurs parents; elle leur permet
enfin d'affirmer leur liberté de choix, leur droit et leur place dans un
environnement peu enclin à les accueillir tels qu'ils sont.
témoignent d'une fracture et d'une division du
moi fréquente chez les jeunes de cette deuxième
génération. Pour ces auteurs, souvent abandonnés à
leur solitude et à leur crise identitaire, l'écriture offre le
moyen de mettre au défi la xénophobie et les nombreux
stéréotypes qui ont cours dans la population de souche; elle
offre aussi l'occasion de remettre en cause les traditions culturelles et
religieuses rigides symbolisées par leurs parents; elle leur permet
enfin d'affirmer leur liberté de choix, leur droit et leur place dans un
environnement peu enclin à les accueillir tels qu'ils sont.
Vingt ans plus tard, une nouvelle génération d'auteurs d'origine
nord-africaine se distance résolument de cette étiquette car,
comme ![]() le relève dans son article, la valeur
littéraire de l'expérience de l'individu n'est pas fonction de
ses origines mais de son talent et de sa capacité à
dépasser son individualité pour accéder à
l'universel. Pour cette nouvelle génération, il y a un
écart énorme entre les sphères intérieures et
extérieures de l'individu et chaque auteur revendique le droit
d'exprimer qui il est de la manière qui lui convient, mais sans pour
autant contribuer au renforcement des images stéréotypées,
des thèmes et des représentations symboliques inadéquates
du monde qui l'entoure. Aujourd'hui les "Beurs" refusent de vivre dans l'ombre
d'eux-mêmes et, comme le souligne Harzoune : "En se réappropriant
leur histoire, en multipliant les genres et les formes stylistiques, ils
entendent bien être reconnus pour ce qu'ils font et non plus pour ce
qu'ils sont".
le relève dans son article, la valeur
littéraire de l'expérience de l'individu n'est pas fonction de
ses origines mais de son talent et de sa capacité à
dépasser son individualité pour accéder à
l'universel. Pour cette nouvelle génération, il y a un
écart énorme entre les sphères intérieures et
extérieures de l'individu et chaque auteur revendique le droit
d'exprimer qui il est de la manière qui lui convient, mais sans pour
autant contribuer au renforcement des images stéréotypées,
des thèmes et des représentations symboliques inadéquates
du monde qui l'entoure. Aujourd'hui les "Beurs" refusent de vivre dans l'ombre
d'eux-mêmes et, comme le souligne Harzoune : "En se réappropriant
leur histoire, en multipliant les genres et les formes stylistiques, ils
entendent bien être reconnus pour ce qu'ils font et non plus pour ce
qu'ils sont".
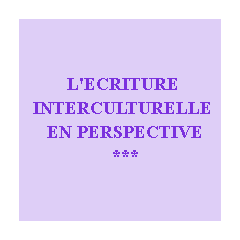
L'essai de ![]() analyse plusieurs "horizons
interculturels" associés au genre autobiograpique. Il relève en
particulier, les conflits culturels que ce genre a provoqué dans
l'univers postcolonial et sa pertinence par rapport aux histoires de vie
africaines. Il souligne par exemple le dilemme entre la loyauté envers
le clan et l'invitation à exprimer sa propre individualité que
l'on trouve dans les mémoires du Malien Amadou Hampâté
Bâ; il souligne aussi le dilemme entre le respect de certains interdits
et la manière dont certains textes les mettent à mal, comme c'est
le cas de l'autobiographie de Ken Bugul qui expose sa sexualité au grand
jour. Comme le dit Lüsebrink "Le genre autobiographique [...] semble
habité par [...] un déplacement des frontières entre le
privé et le public, entre le non-dit et le dicible [...]
L'émergence de l'autobiographie en Afrique montre que ces
déplacements, caractéristiques de l'autobiographie occidentale, y
ont suscité des réactions de rejet et de résistance, et
ont généré des formes hybrides, à cheval sur le
modèle occidental et les récits de vie inscrits dans les
traditions orales africaines." (Version française, p.117).
analyse plusieurs "horizons
interculturels" associés au genre autobiograpique. Il relève en
particulier, les conflits culturels que ce genre a provoqué dans
l'univers postcolonial et sa pertinence par rapport aux histoires de vie
africaines. Il souligne par exemple le dilemme entre la loyauté envers
le clan et l'invitation à exprimer sa propre individualité que
l'on trouve dans les mémoires du Malien Amadou Hampâté
Bâ; il souligne aussi le dilemme entre le respect de certains interdits
et la manière dont certains textes les mettent à mal, comme c'est
le cas de l'autobiographie de Ken Bugul qui expose sa sexualité au grand
jour. Comme le dit Lüsebrink "Le genre autobiographique [...] semble
habité par [...] un déplacement des frontières entre le
privé et le public, entre le non-dit et le dicible [...]
L'émergence de l'autobiographie en Afrique montre que ces
déplacements, caractéristiques de l'autobiographie occidentale, y
ont suscité des réactions de rejet et de résistance, et
ont généré des formes hybrides, à cheval sur le
modèle occidental et les récits de vie inscrits dans les
traditions orales africaines." (Version française, p.117).
L'article de Lüsebrink et celui de ![]() s'enchaînent bien. En abordant l'écriture autobiographique et le
concept du moi, El-Alaoui suggère que des auteurs marocains tels que
Chraïbi, Laâbi ou Khatibi remettent en question la perception
traditionnelle de la personne et son identité au Maroc. Ecrire en
français fait appel à un méta-langage assorti de
nombreuses contraintes, mais la langue étrangère ouvre aussi la
porte à l'évaluation de nouvelles relations de l'individu avec
lui même et la société qui l'entoure. Echapper à
l'emprise de la langue traditionnelle permet de casser l'étreinte du
patriarcat et des dominations coloniales et religieuses, et d'atteindre
à un état d'auto-reconnaisance en marge du discours traditionnel.
s'enchaînent bien. En abordant l'écriture autobiographique et le
concept du moi, El-Alaoui suggère que des auteurs marocains tels que
Chraïbi, Laâbi ou Khatibi remettent en question la perception
traditionnelle de la personne et son identité au Maroc. Ecrire en
français fait appel à un méta-langage assorti de
nombreuses contraintes, mais la langue étrangère ouvre aussi la
porte à l'évaluation de nouvelles relations de l'individu avec
lui même et la société qui l'entoure. Echapper à
l'emprise de la langue traditionnelle permet de casser l'étreinte du
patriarcat et des dominations coloniales et religieuses, et d'atteindre
à un état d'auto-reconnaisance en marge du discours traditionnel.
Burkina Blues, le long poème d'Angèle
Bassolé qui est analysé dans ce numéro par ![]() se fait l'écho des nombreuses violences et
absurdités qui dominent la vie en Afrique aujourd'hui. Toutefois, et
c'est important, l'auteur souligne surtout que Burkina Blues
représentent aussi pour la narratrice et ses concitoyens africains un
moyen d'échapper au désespoir en examinant leur condition
à la lumière de la poésie. Si le monde réel est
incapable de donner un sens au quotidien, la mémoire collective et
individuelle tout comme le rêve sont à même d'arracher la
vie des griffes de l'absurde. Etre libre signifie être capable de
recréer une image de soi-même en marge de la
négativité ambiante. Burkina Blues et la poésie,
suggère Kafarhire Murhula, offrent la possibilité d'une telle
représentation de soi. Tel un miroir, ils permettent à la
narratrice d'observer sa relation avec les autres, de prendre ses distances par
rapport aux injustices présentes et de mieux comprendre les promesses du
futur.
se fait l'écho des nombreuses violences et
absurdités qui dominent la vie en Afrique aujourd'hui. Toutefois, et
c'est important, l'auteur souligne surtout que Burkina Blues
représentent aussi pour la narratrice et ses concitoyens africains un
moyen d'échapper au désespoir en examinant leur condition
à la lumière de la poésie. Si le monde réel est
incapable de donner un sens au quotidien, la mémoire collective et
individuelle tout comme le rêve sont à même d'arracher la
vie des griffes de l'absurde. Etre libre signifie être capable de
recréer une image de soi-même en marge de la
négativité ambiante. Burkina Blues et la poésie,
suggère Kafarhire Murhula, offrent la possibilité d'une telle
représentation de soi. Tel un miroir, ils permettent à la
narratrice d'observer sa relation avec les autres, de prendre ses distances par
rapport aux injustices présentes et de mieux comprendre les promesses du
futur.
L'article d' ![]() explore un autre
phénomène important dans le domaine des écrits
(auto)biographiques. Elle aborde la question des (auto)biographies
d'Européens victimes du sida — ou de proches témoignant de ceux
et celles qui en souffrent — qui répondent au refus forcené de
la mort dans les sociétés occidentales modernes en faisant appel
à des traditions spirituelles d'ailleurs. Son article met l'accent sur
deux ouvrages: L'Histoire de Ketty (1993) et Le Baiser papillon
(1999), chacun relatant d'une manière poignante et distinctive la mort
de la personne chère à la narratrice. De façon subtile et
originale, Jaccomard relève d'une part l'engagement des deux auteurs
avec d'autres manières de percevoir la mort — hindoues, arabes et
autres — et d'autre part leur désaffection, ou tout au moins leur
ambivalence, face à leurs propres traditions (chrétienne et
judaïque).
explore un autre
phénomène important dans le domaine des écrits
(auto)biographiques. Elle aborde la question des (auto)biographies
d'Européens victimes du sida — ou de proches témoignant de ceux
et celles qui en souffrent — qui répondent au refus forcené de
la mort dans les sociétés occidentales modernes en faisant appel
à des traditions spirituelles d'ailleurs. Son article met l'accent sur
deux ouvrages: L'Histoire de Ketty (1993) et Le Baiser papillon
(1999), chacun relatant d'une manière poignante et distinctive la mort
de la personne chère à la narratrice. De façon subtile et
originale, Jaccomard relève d'une part l'engagement des deux auteurs
avec d'autres manières de percevoir la mort — hindoues, arabes et
autres — et d'autre part leur désaffection, ou tout au moins leur
ambivalence, face à leurs propres traditions (chrétienne et
judaïque).
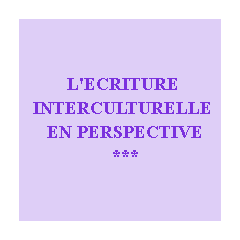
Alors que Jaccomard mentionne l'arrivée de "nouvelles" croyances
religieuses dans l'univers occidental, ![]() étudie
l'irruption d'une langue "étrangère", le malgache, dans les
romans écrits en français par Michèle Rakotoson. Son
article analyse le rôle joué par ces éléments de la
culture malgache traditionnelle et elle suggère que chez Rakotoson, la
langue malgache a une charge émotive telle qu'elle jaillit des
tréfonds de l'individu en temps de crise ou aux moments forts de son
existence. Ce faisant, Ranaivoson soulève la question de savoir si une
telle interjection de la langue d'origine dans la narration témoigne
d'une expérience interculturelle de l'auteur ou d'une
nécessité pour cette dernière de "traduire dans la langue
de l'écriture une psychologie vécue tout d'abord en malgache".
étudie
l'irruption d'une langue "étrangère", le malgache, dans les
romans écrits en français par Michèle Rakotoson. Son
article analyse le rôle joué par ces éléments de la
culture malgache traditionnelle et elle suggère que chez Rakotoson, la
langue malgache a une charge émotive telle qu'elle jaillit des
tréfonds de l'individu en temps de crise ou aux moments forts de son
existence. Ce faisant, Ranaivoson soulève la question de savoir si une
telle interjection de la langue d'origine dans la narration témoigne
d'une expérience interculturelle de l'auteur ou d'une
nécessité pour cette dernière de "traduire dans la langue
de l'écriture une psychologie vécue tout d'abord en malgache".
L'étude de ![]() sur le thème de l'identité
culturelle et de l'auto-définition nous transporte de l'univers
linguistique franco-malgache-africain à l'univers
anglo-espagnol-américain. Elle propose une analyse de l'oeuvre de Gloria
Anzaldua, de Coco Fusco et de Ruth Behar, trois auteurs ayant eu une influence
considérable dans les domaines des études féministes et
interculturelles. De l'avis d'Hincapie, ces trois auteurs utilisent
l'écriture pour remettre en question diverses formes d'exclusions qui ne
se limitent pas à l'expression et englobent les problèmes de
générations, de couleur de peau, etc.. Et, s'inspirant de
l'idée de frontière rendue célèbre par Anzaldua,
Hincapie écrit: "Ces trois auteurs ont entrepris une traduction
d'elles-mêmes qui les conduit d'une langue limitée au cadre
familial à une langue ouverte sur le monde, d'une langue parlée
par la génération de leurs parents et de leurs grands-parents
à une langue propre à leur génération".
sur le thème de l'identité
culturelle et de l'auto-définition nous transporte de l'univers
linguistique franco-malgache-africain à l'univers
anglo-espagnol-américain. Elle propose une analyse de l'oeuvre de Gloria
Anzaldua, de Coco Fusco et de Ruth Behar, trois auteurs ayant eu une influence
considérable dans les domaines des études féministes et
interculturelles. De l'avis d'Hincapie, ces trois auteurs utilisent
l'écriture pour remettre en question diverses formes d'exclusions qui ne
se limitent pas à l'expression et englobent les problèmes de
générations, de couleur de peau, etc.. Et, s'inspirant de
l'idée de frontière rendue célèbre par Anzaldua,
Hincapie écrit: "Ces trois auteurs ont entrepris une traduction
d'elles-mêmes qui les conduit d'une langue limitée au cadre
familial à une langue ouverte sur le monde, d'une langue parlée
par la génération de leurs parents et de leurs grands-parents
à une langue propre à leur génération".
![]() , quant à lui, compare les mémoires de trois auteurs
: Alice Kaplan, Eva Hoffman et Andrew Riemer, un auteur australien d'origine
hongroise. Son essai, qui incite à la réflexion, cherche à
évaluer les pertes et les gains associés à la traduction
de soi en situation interculturelle. Une attention particulière est
portée sur le rôle joué par l'apprentissage d'une seconde
langue et à la nécessité de considérer les
implications de l'apprentissage des langues qui soulignent et permettent la
fluidité des cultures et de l'identité. Par exemple,
suggère l'auteur, l'Américaine Kaplan se tourne vers le
français pour échapper, du moins en partie, aux limites
imposées à son moi par la société américaine
et, pendant un certain temps, dit-il, elle se sent en sécurité
dans son rôle de personnage français. p>
, quant à lui, compare les mémoires de trois auteurs
: Alice Kaplan, Eva Hoffman et Andrew Riemer, un auteur australien d'origine
hongroise. Son essai, qui incite à la réflexion, cherche à
évaluer les pertes et les gains associés à la traduction
de soi en situation interculturelle. Une attention particulière est
portée sur le rôle joué par l'apprentissage d'une seconde
langue et à la nécessité de considérer les
implications de l'apprentissage des langues qui soulignent et permettent la
fluidité des cultures et de l'identité. Par exemple,
suggère l'auteur, l'Américaine Kaplan se tourne vers le
français pour échapper, du moins en partie, aux limites
imposées à son moi par la société américaine
et, pendant un certain temps, dit-il, elle se sent en sécurité
dans son rôle de personnage français. p>
![]() examine le rôle de la langue dans My Odyssey [Mon
Odyssée], l'autobiographie du chef nationaliste nigérian Nnamdi
Azikiwe pour qui les connaissances linguistiques étaient d'une
importance capitale car elles préfiguraient l'avenir d'un "nouveau
Nigeria progressiste" et offraient un moyen idéal de franchir les
divisions ethniques. De plus, comme le montre Oha, le pluralisme linguistique
prôné par Azikiwe ne se limite pas à son activité
politique et à sa vision du Nigeria, il fut aussi important dans la
formation de sa propre identité et sans sa vie entre diverses cultures.
Son accent d'Oxford ridiculisé en Amérique lui coûte un
job, mais il contribue à sa réputation d'homme sage sous d'autres
cieux: "Zik e kwuo ncha. Zik a bien parlé". Sa capacité à
dépasser les revers linguistiques dont il est la victime lui permet de
transcender les multiples formes de colonisation et de frontières
linguistiques et culturelles et de parler librement au nom de son peuple et de
la population africaine. Le parcours linguistique d'Azikiwe, suggère
Oha, préfigure celui auquel la nation toute entière doit faire
face.
examine le rôle de la langue dans My Odyssey [Mon
Odyssée], l'autobiographie du chef nationaliste nigérian Nnamdi
Azikiwe pour qui les connaissances linguistiques étaient d'une
importance capitale car elles préfiguraient l'avenir d'un "nouveau
Nigeria progressiste" et offraient un moyen idéal de franchir les
divisions ethniques. De plus, comme le montre Oha, le pluralisme linguistique
prôné par Azikiwe ne se limite pas à son activité
politique et à sa vision du Nigeria, il fut aussi important dans la
formation de sa propre identité et sans sa vie entre diverses cultures.
Son accent d'Oxford ridiculisé en Amérique lui coûte un
job, mais il contribue à sa réputation d'homme sage sous d'autres
cieux: "Zik e kwuo ncha. Zik a bien parlé". Sa capacité à
dépasser les revers linguistiques dont il est la victime lui permet de
transcender les multiples formes de colonisation et de frontières
linguistiques et culturelles et de parler librement au nom de son peuple et de
la population africaine. Le parcours linguistique d'Azikiwe, suggère
Oha, préfigure celui auquel la nation toute entière doit faire
face.
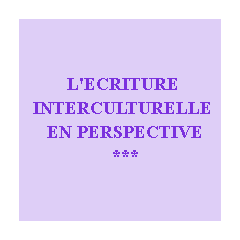
Si les conventions de l'écriture autobiographique demandent une
représentation véridique de la personne de l'auteur, du moins en
principe, l'article de ![]() entend montrer les limites d'une telle
convention en introduisant le concept d'"autobiographie fictive" et en
analysant la manière dont Maryse Condé pervertit le genre
autobiographique dans Moi, Tituba. A la frontière de l'Histoire,
cette autobiographie fictive relève les contradictions et les
difficultés de tout projet (auto)biographique cherchant à
exprimer la vie des sans noms, éternellement confrontés aux
vagueries d'un discours hégémonique. "Nomade inconvenante" -
comme le disait un critique - Condé s'imagine comme Tituba "errante,
multiple, au-delà et au-dedans". Et le regard ironique qu'elle jette
sur elle-même tout en maintenant cette image d'elle-même à
distance en rejetant les règles du jeu autobiographique lui permet
d'évaluer sa propre position à l'intersection de deux cultures
avec lesquelles elle est loin d'être tout-à-fait
réconciliée.
entend montrer les limites d'une telle
convention en introduisant le concept d'"autobiographie fictive" et en
analysant la manière dont Maryse Condé pervertit le genre
autobiographique dans Moi, Tituba. A la frontière de l'Histoire,
cette autobiographie fictive relève les contradictions et les
difficultés de tout projet (auto)biographique cherchant à
exprimer la vie des sans noms, éternellement confrontés aux
vagueries d'un discours hégémonique. "Nomade inconvenante" -
comme le disait un critique - Condé s'imagine comme Tituba "errante,
multiple, au-delà et au-dedans". Et le regard ironique qu'elle jette
sur elle-même tout en maintenant cette image d'elle-même à
distance en rejetant les règles du jeu autobiographique lui permet
d'évaluer sa propre position à l'intersection de deux cultures
avec lesquelles elle est loin d'être tout-à-fait
réconciliée.
![]() évoque elle aussi une tentative de
réconciliation interculturelle difficile de l'auteur avec son milieu. Au
Maroc, comme dans bien d'autres pays où il est contraire aux traditions
de considérer les individus comme des sujets libres et
indépendants du contexte socio-politique auxquel ils appartiennent,
l'idée d'écriture autobiographique a longtemps été
suspecte car elle semblait devoir remettre en question le fondement de la
culture et du savoir traditionnels. Le fait d'écrire son autobiographie
en français ajoute d'ailleurs une difficulté
supplémentaire pour l'écrivain marocain dans la mesure où
cette langue n'est souvent pas sa langue maternelle, ni d'ailleurs celle de ses
lecteurs maghrébins. Aux difficultés culturelles liées au
genre, s'ajoute un handicap linguistique hérité de la
colonisation. Dans ce contexte, il n'est guère surprenant, dit Annie
Devergnas-Dieumegard, que l'autobiographie marocaine se dissimule, de nos jours
encore, derrière les étiquettes de "roman" ou de "récit"
et que les auteurs hésitent à se lancer dans un genre longtemps
associé aux valeurs occidentales et accusé de voyeurisme
ethnographique. Toutefois, au Maroc comme ailleurs, l'attrait du genre augmente
auprès des écrivains contemporains et il va de pair avec
l'évolution des mentalités. Plutôt qu'un abandon des
valeurs traditionnelles, les écrivains marocains d'aujourd'hui
considèrent de plus en plus l'écriture autobiographique comme un
moyen de mieux comprendre leurs relations avec les autres et de donner un
nouveau sens à leur vie.
évoque elle aussi une tentative de
réconciliation interculturelle difficile de l'auteur avec son milieu. Au
Maroc, comme dans bien d'autres pays où il est contraire aux traditions
de considérer les individus comme des sujets libres et
indépendants du contexte socio-politique auxquel ils appartiennent,
l'idée d'écriture autobiographique a longtemps été
suspecte car elle semblait devoir remettre en question le fondement de la
culture et du savoir traditionnels. Le fait d'écrire son autobiographie
en français ajoute d'ailleurs une difficulté
supplémentaire pour l'écrivain marocain dans la mesure où
cette langue n'est souvent pas sa langue maternelle, ni d'ailleurs celle de ses
lecteurs maghrébins. Aux difficultés culturelles liées au
genre, s'ajoute un handicap linguistique hérité de la
colonisation. Dans ce contexte, il n'est guère surprenant, dit Annie
Devergnas-Dieumegard, que l'autobiographie marocaine se dissimule, de nos jours
encore, derrière les étiquettes de "roman" ou de "récit"
et que les auteurs hésitent à se lancer dans un genre longtemps
associé aux valeurs occidentales et accusé de voyeurisme
ethnographique. Toutefois, au Maroc comme ailleurs, l'attrait du genre augmente
auprès des écrivains contemporains et il va de pair avec
l'évolution des mentalités. Plutôt qu'un abandon des
valeurs traditionnelles, les écrivains marocains d'aujourd'hui
considèrent de plus en plus l'écriture autobiographique comme un
moyen de mieux comprendre leurs relations avec les autres et de donner un
nouveau sens à leur vie.
La langue véhicule la connaissance et son importance est d'autant plus
importante dans un pays tel que le Cameroun où le français et
l'anglais ont été adoptés pour promouvoir une sorte de
consensus national et institutionnel dans les écoles du pays. Dans ce
contexte,
![]() suggère que les noms propres que l'on trouve
dans les ouvrages scolaires au Cameroun reflètent la limite des efforts
faits par les autorités pour tenir compte des différences
linguistiques et culturelles du pays. Et les absences qu'on y relève ne
facilitent pas l'intégration des élèves dont
l'héritage, la langue et la culture ont été
oubliés. Le nom fait partie intégrante de l'identité et le
fait de priver l'individu de son nom revient à le priver d'une partie de
son héritage. Dès lors, dit Fandio : "L'onomastique à
laquelle le jeune apprenant camerounais est quotidiennement exposé, sans
doute plus que celle des contenus ou des approches pédagogiques, met en
lumière un décalage ou même un dysfonctionnement grave
entre les déclarations d'intention [...] et la réalité."
suggère que les noms propres que l'on trouve
dans les ouvrages scolaires au Cameroun reflètent la limite des efforts
faits par les autorités pour tenir compte des différences
linguistiques et culturelles du pays. Et les absences qu'on y relève ne
facilitent pas l'intégration des élèves dont
l'héritage, la langue et la culture ont été
oubliés. Le nom fait partie intégrante de l'identité et le
fait de priver l'individu de son nom revient à le priver d'une partie de
son héritage. Dès lors, dit Fandio : "L'onomastique à
laquelle le jeune apprenant camerounais est quotidiennement exposé, sans
doute plus que celle des contenus ou des approches pédagogiques, met en
lumière un décalage ou même un dysfonctionnement grave
entre les déclarations d'intention [...] et la réalité."
La nécessité de reconnaître la diversité culturelle
ne se limite pas à l'univers scolaire camerounais et s'applique aussi
bien sûr à la France et à ses milieux urbains dont ![]() fait l'analyse. Pour elle, la reconnaissance de
l'interculturalité par les individus et les collectivités peut
conduire à une valorisation du pluralisme et à une meilleure
intégration des immigrants. Une telle reconnaissance peut s'exprimer
sous la forme de diverses manifestations culturelles et artistiques qui
favorisent le dialogue entre les cultures et permettent aux immigrés de
développer une certaine confiance en soi. "Jamais essentielle,
l'identité fait référence à une configuration
dynamique" suggère Buffet. "Elle est le fruit d'une série de
négociations entre ce que l'on est, ce que l'on voudrait être, et
ce que l'environnement social renvoie comme représentations et valeurs
différentes des siennes".
fait l'analyse. Pour elle, la reconnaissance de
l'interculturalité par les individus et les collectivités peut
conduire à une valorisation du pluralisme et à une meilleure
intégration des immigrants. Une telle reconnaissance peut s'exprimer
sous la forme de diverses manifestations culturelles et artistiques qui
favorisent le dialogue entre les cultures et permettent aux immigrés de
développer une certaine confiance en soi. "Jamais essentielle,
l'identité fait référence à une configuration
dynamique" suggère Buffet. "Elle est le fruit d'une série de
négociations entre ce que l'on est, ce que l'on voudrait être, et
ce que l'environnement social renvoie comme représentations et valeurs
différentes des siennes".
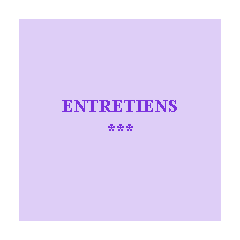
La première des trois personnes dont nous proposons l'interview
s'appelle ![]() . Elle est d'origine africaine et elle vit en
France. Dans le cadre de son travail elle a été conduite à
interviewer plusieurs femmes d'origine africaine vivant dans la région
de Lyon. Lorsqu'elles arrivent en France, dit Kula-Kim, les Africaines doivent
trouver le moyen de réconcilier leurs valeurs et leurs aspirations avec
les attentes et les exigences de la société française. Et
comme la maîtrise du français est une des conditions
préalable pour une bonne intégration, les questions linguistiques
deviennent très importantes. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il soit
pour autant nécessaire d'abandonner la culture et les valeurs du pays
d'origine et Kula-Kim souligne l'attachement de nombreuses immigrées
africaines à leur culture et à la tradition orale qui s'y
rattache. Comme le dit une des personnes interviewées : "Les mots
manquent en Français pour exprimer ce que je veux dire ou ce que je vais
dire, va perdre son charme si je le dis en français".
. Elle est d'origine africaine et elle vit en
France. Dans le cadre de son travail elle a été conduite à
interviewer plusieurs femmes d'origine africaine vivant dans la région
de Lyon. Lorsqu'elles arrivent en France, dit Kula-Kim, les Africaines doivent
trouver le moyen de réconcilier leurs valeurs et leurs aspirations avec
les attentes et les exigences de la société française. Et
comme la maîtrise du français est une des conditions
préalable pour une bonne intégration, les questions linguistiques
deviennent très importantes. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il soit
pour autant nécessaire d'abandonner la culture et les valeurs du pays
d'origine et Kula-Kim souligne l'attachement de nombreuses immigrées
africaines à leur culture et à la tradition orale qui s'y
rattache. Comme le dit une des personnes interviewées : "Les mots
manquent en Français pour exprimer ce que je veux dire ou ce que je vais
dire, va perdre son charme si je le dis en français".
La seconde interview est une rencontre avec la romancière
franco-vietnamienne ![]() proposée par Nathalie Nguyen.
Cette interview, dit Nguyen, avait pour but de demander à l'auteur de
préciser ses vues sur l'écriture autobiographique, la notion
d'identité, et aussi de lui fournir l'occasion de raconter son
expérience d'immigrante ayant dû se réinstaller en France.
Dans ses réponses, Lefèvre souligne la distinction entre
vérité et réalité "Tout est vrai, mais tout ne
s'est pas déroulé exactement de cette façon". De fait
Lefèvre suggère que son livre a représenté pour
elle une sorte de thérapie par l'écriture et lorsque Nguyen lui
demande si elle éprouve un sentiment de perte lorsqu'elle pense au
conflit qui a opposé sa double identité vietnamienne et
française, elle répond que non, que les deux moitiés de sa
personnalité sont maintenant réconciliées. "Aujourd'hui,
je suis les deux, les deux de façon importante, et je le sais moi, et je
n'ai pas besoin que quelqu'un me l'attribue".
proposée par Nathalie Nguyen.
Cette interview, dit Nguyen, avait pour but de demander à l'auteur de
préciser ses vues sur l'écriture autobiographique, la notion
d'identité, et aussi de lui fournir l'occasion de raconter son
expérience d'immigrante ayant dû se réinstaller en France.
Dans ses réponses, Lefèvre souligne la distinction entre
vérité et réalité "Tout est vrai, mais tout ne
s'est pas déroulé exactement de cette façon". De fait
Lefèvre suggère que son livre a représenté pour
elle une sorte de thérapie par l'écriture et lorsque Nguyen lui
demande si elle éprouve un sentiment de perte lorsqu'elle pense au
conflit qui a opposé sa double identité vietnamienne et
française, elle répond que non, que les deux moitiés de sa
personnalité sont maintenant réconciliées. "Aujourd'hui,
je suis les deux, les deux de façon importante, et je le sais moi, et je
n'ai pas besoin que quelqu'un me l'attribue".
Notre troisième interview propose un échange d'idées avec
la romancière malienne ![]() qui a vécu en France
pendant son enfance, en Uzbekistan pendant ses études et au Mali au
cours de ces dernières années. Son expérience montre que
vivre côte à côte avec autrui ne conduit pas
nécessairement à une compréhension réciproque de
l'autre, ni à une relation de partage. Les stéréotypes
sont difficiles à vaincre, surtout lorsque des barrières
culturelles, linguistiques ou idéologiques enferment les relations
humaines dans un carcan. La problématisation de la relation entre
fiction et réalité qui laisse entrevoir la possibilité
d'une narratrice partant — dans son prochain ouvrage — à la recherche
d'elle même au-delà d'un "je" singulier, rejoint le thème
souligné au début de cet éditorial, c'est-à-dire la
nature problématique de l'imagination dans l'autobiographie: "Le 'je'
s'est imposé de lui-même lorsque j'ai commencé à
écrire ce texte : c'est une somme d'histoires vécues ou si
souvent entendues qu'elles finissent par paraître vraies".
qui a vécu en France
pendant son enfance, en Uzbekistan pendant ses études et au Mali au
cours de ces dernières années. Son expérience montre que
vivre côte à côte avec autrui ne conduit pas
nécessairement à une compréhension réciproque de
l'autre, ni à une relation de partage. Les stéréotypes
sont difficiles à vaincre, surtout lorsque des barrières
culturelles, linguistiques ou idéologiques enferment les relations
humaines dans un carcan. La problématisation de la relation entre
fiction et réalité qui laisse entrevoir la possibilité
d'une narratrice partant — dans son prochain ouvrage — à la recherche
d'elle même au-delà d'un "je" singulier, rejoint le thème
souligné au début de cet éditorial, c'est-à-dire la
nature problématique de l'imagination dans l'autobiographie: "Le 'je'
s'est imposé de lui-même lorsque j'ai commencé à
écrire ce texte : c'est une somme d'histoires vécues ou si
souvent entendues qu'elles finissent par paraître vraies".
* *
Deux des thèmes majeurs dominant cette édition de Mots pluriels sont suggérés par notre titre : "Traduire le vécu" : Dans quelle mesure le fait de traverser langues et cultures représente-t-il une forme d'auto-traduction? Et quel rôle la traduction — traduction de la mémoire, de l'expérience, d'une identité personnelle antérieure, de nos liens avec la société — joue-t-elle un rôle dans l'autobiographie ou de manière plus générale dans l'écriture d'une vie? Ces questions qui se confondent dans le cadre de l'écriture interculturelle autobiographique pourraient être appréhendées sous l'angle du "métissage" comme l'a fait par exemple Lefèvre. Par contre, nous n'avons pas poursuivi la voie offerte par le concept d'hybridité culturelle pace que, à notre avis, ce concept ne souligne pas assez la participation dynamique de l'individu dans la formulation de sa vie et de ses déplacements entre différentes langues, différentes ethnicités et différentes cultures; parcequ'il ne souligne pas assez une prise en charge de la personne par elle-même que l'on peut constater dans tous les articles que nous proposons ici.
D'importants thèmes se retrouvent tout au long de ce numéro mais on se doit de souligner qu'ils font référence à un espace géographique, culturel et linguistique très large, un espace qui inclut le Maghreb, le Nigeria, l'Inde, le Canada, la Chine, l'Ukraine, la France, le Vietnam, les Etats-Unis, l'Australie, l'Amérique du sud, l'Uzbekhistan et bien d'autres pays. Les perspectives proposées ne sont pas moins diverses et, bien que le numéro ait été divisé en deux sections soulignant l'aspect le plus représentatif de chaque article, les témoignages comme les études publiées sous la rubrique 'L'écriture interculturelle en perspective' témoignent tous d'un engagement auto-reflectif et critique de leurs auteurs. Toutes les contributions reflètent de manière plus ou moins directe une expérience personnelle interculturelle. En cela Veronica Zhengdao Ye exprime un sentiment partagé lorsqu'elle écrit : " Ma nouvelle réalité à moi se trouve quelque part entre mes deux mondes, mais aussi entre mon passé, mon présent et mon futur. Elle est construite sur des formes et des significations nouvelles et variées et elle s'est enrichie de mon expérience des deux mondes".
Note
[1] L. P. Hartley, The Go-Between, London, 1953.
 Mary Besemeres is an ARC postdoctoral fellow at Curtin University. She is the author of Translating One's Self: Language and Selfhood in Cross-Cultural Autobiography (Oxford: Peter Lang, 2002). She received her doctorate in English literature from the Australian National University, and has taught contemporary autobiography, Russian and Australian literatures. Her research interests include cross-cultural autobiography, bilingualism and selfhood, immigrant experience, the cross-cultural family, and emotion and culture. Her current project investigates life writing by migrants to Australia and Europe. Her most recent publication is "The Family in Exile, Between Languages: Eva Hoffman's Lost in Translation, Lisa Appignanesi's Losing the Dead, Anca Vlasopolos's No Return Address", in Auto/Biography Studies (forthcoming). Mary Besemeres is an ARC postdoctoral fellow at Curtin University. She is the author of Translating One's Self: Language and Selfhood in Cross-Cultural Autobiography (Oxford: Peter Lang, 2002). She received her doctorate in English literature from the Australian National University, and has taught contemporary autobiography, Russian and Australian literatures. Her research interests include cross-cultural autobiography, bilingualism and selfhood, immigrant experience, the cross-cultural family, and emotion and culture. Her current project investigates life writing by migrants to Australia and Europe. Her most recent publication is "The Family in Exile, Between Languages: Eva Hoffman's Lost in Translation, Lisa Appignanesi's Losing the Dead, Anca Vlasopolos's No Return Address", in Auto/Biography Studies (forthcoming).
 Maureen Perkins taught at the Australian National University, Canberra, and prior to her current position at Curtin University held an ARC Postdoctoral Research Fellowship at the University of Western Australia. Her background is in cultural history. She is currently researching a project on race in modern Australia that uses anthropological and sociological as well as historical perspectives. Her special areas of interest are: magic, childhood and children's literature, race, and mixed race identity. Her publications include: Visions of the Future: Almanacs, Time, and Cultural Change 1775-1870 (Oxford, 1996)  The Reform of Time: Magic and Modernity (Pluto Press, London, 2001).
The Reform of Time: Magic and Modernity (Pluto Press, London, 2001).  'The Trial of Joseph Powell, Fortune-teller', Journal of Victorian Culture (Spring, 2001), pp. 27-45. 'The Trial of Joseph Powell, Fortune-teller', Journal of Victorian Culture (Spring, 2001), pp. 27-45.
 Third space and cross-cultural identities, Mots pluriels, No.7 July 1998 (Guest editor) Third space and cross-cultural identities, Mots pluriels, No.7 July 1998 (Guest editor)  'Australian Mixed Race', in the European Journal of Cultural Studies (forthcoming). 'Australian Mixed Race', in the European Journal of Cultural Studies (forthcoming).
|
Back to [the top of the page] [the contents of this issue of MOTS PLURIELS]