No 23. mars 2003.
https://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP2303klf.html
© Intersections et Nathalie Nguyen
| A L'ECOUTE DE KIM LEFEVRE |
Métisse Blanche
Un entretien avec Kim Lefèvre
proposé par Nathalie Nguyen
University of Newcastle
Cet échange a eu lieu en 2001.
| Article publié dans Intersections Issue 5, (May 2001). Repris avec l'aimable autorisation d' Intersections et de l'auteur. |
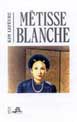 Enfant d'une mère vietnamienne et d'un père militaire français, Kim Lefèvre est née fille, bâtarde et métisse: un triple handicap au Viêt-nam pendant la période de la colonisation française. Lefèvre ne connut jamais son père et vécut une enfance et une adolescence difficiles au Viêt-nam. Son histoire, qui se déroule dans un contexte de colonisation, de guerre, de migrations internes, de décolonisation et finalement d'exil, a paru dans deux récits: Métisse blanche (1989) [1] et Retour à la saison des pluies (1990) [2]. Métisse raconte les vingt-cinq premières années de sa vie au Viêt-nam, tandis que Retour fait le récit de son retour au pays natal trente ans après. La publication de Métisse a été reconnue immédiatement. Lefèvre fut interviewée par Bernard Pivot dans l'émission de télévision Apostrophes le 7 avril 1989. Ses livres furent épuisés par la suite, y compris en livres de poche. Elle a aussi écrit un roman situé au Mexique au seizième siècle intitulé Moi, Marina la Malinche (1994) et traduit plusieurs romans et nouvelles vietnamiens en français, dont les œuvres d'écrivains contemporains connus tels Duong Thu Huong et Nguyên Huy Thiêp. Enfant d'une mère vietnamienne et d'un père militaire français, Kim Lefèvre est née fille, bâtarde et métisse: un triple handicap au Viêt-nam pendant la période de la colonisation française. Lefèvre ne connut jamais son père et vécut une enfance et une adolescence difficiles au Viêt-nam. Son histoire, qui se déroule dans un contexte de colonisation, de guerre, de migrations internes, de décolonisation et finalement d'exil, a paru dans deux récits: Métisse blanche (1989) [1] et Retour à la saison des pluies (1990) [2]. Métisse raconte les vingt-cinq premières années de sa vie au Viêt-nam, tandis que Retour fait le récit de son retour au pays natal trente ans après. La publication de Métisse a été reconnue immédiatement. Lefèvre fut interviewée par Bernard Pivot dans l'émission de télévision Apostrophes le 7 avril 1989. Ses livres furent épuisés par la suite, y compris en livres de poche. Elle a aussi écrit un roman situé au Mexique au seizième siècle intitulé Moi, Marina la Malinche (1994) et traduit plusieurs romans et nouvelles vietnamiens en français, dont les œuvres d'écrivains contemporains connus tels Duong Thu Huong et Nguyên Huy Thiêp. La voix de Lefèvre est une voix rare: celle d'une femme eurasienne du Viêt-nam. Elle a voulu faire entendre l'expérience méconnue des métisses au Viêt-nam, de celles qui, comme elle, 'avaient été méprisées et rejetées aussi bien par les Français au Viêt-nam que les Vietnamiens, qui vivent aujourd'hui quelque part et dont on n'a jamais entendu les voix.'[3] Elle a passé ses années de jeunesse au Viêt-nam, mais cela fait maintenant quarante ans qu'elle habite en France. Elle porte en elle un double héritage culturel et linguistique. J'ai voulu l'interviewer afin de lui demander ses idées sur le récit autobiographique et la notion d'identité ainsi que son expérience de l'immigration et de l'intégration. J'ai aussi voulu lui poser des questions à propos de certains points dans ses récits. Elle a répondu à fond à toutes ces questions. Kim Lefèvre m'a accordé deux interviews, la première dans son appartement à Paris le 15 janvier 2001 et la deuxième au téléphone le 8 avril 2001. Cette transcription est une version éditée de ces deux interviews.
La voix de Lefèvre est une voix rare: celle d'une femme eurasienne du Viêt-nam. Elle a voulu faire entendre l'expérience méconnue des métisses au Viêt-nam, de celles qui, comme elle, 'avaient été méprisées et rejetées aussi bien par les Français au Viêt-nam que les Vietnamiens, qui vivent aujourd'hui quelque part et dont on n'a jamais entendu les voix.'[3] Elle a passé ses années de jeunesse au Viêt-nam, mais cela fait maintenant quarante ans qu'elle habite en France. Elle porte en elle un double héritage culturel et linguistique. J'ai voulu l'interviewer afin de lui demander ses idées sur le récit autobiographique et la notion d'identité ainsi que son expérience de l'immigration et de l'intégration. J'ai aussi voulu lui poser des questions à propos de certains points dans ses récits. Elle a répondu à fond à toutes ces questions. Kim Lefèvre m'a accordé deux interviews, la première dans son appartement à Paris le 15 janvier 2001 et la deuxième au téléphone le 8 avril 2001. Cette transcription est une version éditée de ces deux interviews.
|
Quelles raisons vous ont poussée à écrire un récit autobiographique?
Le récit autobiographique d'abord, c'est assez courant dans les premières oeuvres, et ça n'est pas ce qu'il y a de moins intéressant d'ailleurs. Quand on regarde, par exemple, le récit autobiographique de Romain Gary, qui est La Promesse de l'aube, je considère que c'est son livre le plus émouvant et le plus intéressant, comme Un Barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras. J'ai pris le récit autobiographique parce que c'est une forme disons 'naturelle' quand on n'a pas encore d'expérience littéraire, et souvent c'est parce qu'on a quelque chose qu'on porte en soi, et qu'on voudrait le communiquer. Ensuite, si j'ai relaté cette histoire sous la forme 'je', c'est que ça lui donne plus d'authenticité. J'ai pensé que je pourrais, en essayant d'utiliser un procédé littéraire, le construire autrement, comme un roman, mais premièrement c'est le manque d'expérience qui m'a retenu, et deuxièmement, ça lui ôterait de son caractère véridique et authentique. Voilà pourquoi j'ai pris la forme autobiographique, c'est pour ces deux raisons.
Que signifie pour vous l'écriture?
Ecrire, c'est s'exprimer par les mots et c'est une expression qui m'est naturelle, c'est la seule que je connaisse, je ne saurais pas raconter ni le monde ni les gens ni moi-même par la peinture ou la musique, ou un autre art.
Pourquoi avez-vous choisi d'écrire en français?
Parce que d'abord, je n'ai pas pensé du tout aux lecteurs vietnamiens. La motivation que j'ai pour écrire ce livre, c'est de donner à voir et à lire aux lecteurs français — qui ont déjà lu beaucoup de livres parlant de l'Indochine — une autre facette des choses, un autre point de vue qui est le point de vue vietnamien. C'était pour les Français que j'écrivais et j'ai été extrêmement surprise par la suite de savoir que ce sont surtout les Vietnamiens qui l'ont aimé.
Quelle était votre expérience dans le procédé littéraire? Est-ce que cela a été difficile pour vous ou est-ce que c'est venu assez naturellement?
Quand j'ai commencé à écrire, ça faisait déjà un certain nombre d'années que je vivais en France et donc je pensais déjà en français et j'écrivais déjà en français, bien que j'aie été formée dans ma première langue, avec le vietnamien. Et ça a été assez naturel, parce que ce sont des choses que j'ai portées en moi pendant très longtemps, de façon très présente, et c'est sorti comme on dévide une bobine. C'est comme si vous preniez le premier fil, vous tirez et tout le reste suit. C'est pour ça que le récit est linéaire. Il suit la chronologie. Maintenant, combien de temps cela m'a pris, sept ans.
Vous avez donc commencé à écrire ce livre en quelle année?
J'ai commencé à écrire dans les années 80. J'ai écris à la main, à la plume, puisque je l'écrivais dans les hôtels, dans les trains, un peu partout, lorsque je me déplaçais pour des tournées de théâtre. J'étais comédienne de théâtre à cette époque, et donc dans les intervalles où je n'avais pas de pièce à jouer et à répéter, et bien j'écrivais, je reprenais le récit au moment où je l'avais laissé, un mois, cinq mois, un an plus tôt, et ça continuait comme si c'était hier. Quand j'écrivais ce texte, je n'avais pas du tout une idée claire de le faire publier, de le déposer chez les éditeurs. C'était un petit peu lointain. Et puis à force de le dévider, un jour, il n'y a plus eu de fil sur la bobine. Et alors, j'ai commencé à le relire. Il était très long, il faisait 500-600 pages. A ce moment là, j'ai commencé moi-même par réduire, en supprimant des chapitres que je considérais un peu comme ethnographiques, ethnologiques. Quand je l'ai déposé chez les éditeurs, j'en ai déposé chez cinq, six, sept éditeurs même, beaucoup ont refusé et puis un éditeur a accepté et l'éditeur m'a encore proposé des coupures, donc j'ai encore recoupé.
Quel est, selon vous, le rapport entre l'exil ou l'immigration et la littérature?
L'exil, le mot en lui-même, implique un certain état de difficulté et parfois de souffrance. Or, la littérature vient toujours d'une faille, d'une blessure intérieure, comme tout autre art d'ailleurs. Parce que si on vit pleinement heureux, on n'a pas envie de dire quoi que ce soit, puisque c'est suffisant en soi. Il faut qu'il y ait une brisure intérieure, ou une difficulté, ou un tourment pour qu'on ait envie de l'exprimer, de le dire. Il y a déjà la nécessité donc, si vous voulez, dans l'exil. C'est souvent que les gens qui sont exilés écrivent, parce qu'ils portent une souffrance, même si, dans mon cas, quand le livre a été écrit, cette souffrance est déjà très dominée, elle était déjà derrière moi, mais elle a eu lieu. Et c'est parce qu'elle a eu lieu qu'on a envie de le dire. On a envie de le dire aussi parce que quand on écrit, on pense que cette histoire n'est pas seulement une histoire individuelle, mais qu'elle peut concerner d'autres êtres. Ecrire, c'est pour dire, communiquer, et pour exprimer d'abord ce qu'on a en soi, et pour communiquer avec d'autres, et donc le rapport entre l'exil et l'écriture est très étroit, comme le rapport entre la souffrance et l'écriture.
Votre récit est-il plutôt un témoignage ou un documentaire?
Quand on écrit de la littérature, ça n'est jamais tout à fait un documentaire, ça n'est jamais tout à fait un témoignage non plus, puisque le témoignage se fait sur un sujet particulier, et à chaud. Mais ceci, c'est une oeuvre littéraire, tout en étant autobiographique, c'est-à-dire tirant de sa propre vie des éléments pour construire le livre. D'abord, vous avez la distance, le temps, que ne donnent jamais ni le documentaire ni le témoignage. Si je passais devant un tribunal pour jurer, dire si c'est la vérité ou non, je ne pourrais pas le faire, parce qu'à la fois, c'est vrai, et à la fois j'ai emprunté pour dire des choses qui sont encore plus vraies profondément que la réalité de ce qui s'était passé, j'ai emprunté des choses qui appartiennent à d'autres. Par exemple, dans le livre, il y a un chapitre sur le couvent des Oiseaux, et mes amies du couvent des Oiseaux l'ont lu. Et elles m'ont dit: 'Je ne reconnais rien là-dedans, mais c'est tout à fait ça.' C'est-à-dire qu'elles reconnaissent que c'est exactement comme ça qu'elles ont vécu et ressenti les choses mais qu'elles ne se souviennent d'aucun fait que j'ai raconté là-dedans. Donc, si vous voulez, quand on fait un travail artistique ou littéraire, on est toujours en train de refaire, de reconstruire la réalité, afin que cette réalité corresponde encore mieux à la vérité des choses.
Est-ce que ça a été difficile pour vous de reconstituer le passé?
Non, pas du tout, parce que c'est un passé qui a existé en moi avec une très grande force, et qui existe tellement, qu'à un moment, il fallait le dire. Je n'avais qu'un moyen de le dire, ne connaissant pas les autres outils d'expression, c'était de l'écrire. Ce qu'on porte en soi, il faut bien qu'on l'exprime, donc je l'ai exprimé et au fur et à mesure, j'ai pensé que ça pourrait intéresser d'autres que moi. Et j'ai pensé aussi que mon histoire, ce n'est pas seulement la mienne, c'est celle des centaines de milliers de métis qui étaient au Viêt-nam à cette époque et puis même après, si on pense aux Amérasiens.
Comment avez-vous décidé des détails à inclure ou à délaisser dans votre œuvre?
Pour leur signification en tant que ce que je veux exprimer, personnellement. La vérité est parfois plus grande que la réalité. C'est-à-dire, on peut inventer une chose qui va dire une situation de façon plus vraie que si on l'avait racontée de la façon dont ça se déroulait. Par exemple, je cite une anecdote qui éclaire cela. Nous avons, avec mes sœurs, une petite expérience commune qui est que, il y a eu des années difficiles au Viêt-nam où nous avions faim, on ne mangeait pas tout à fait à sa faim. Si je disais: 'C'était une année ceci cela et nous avions très faim', et bien c'est une chose qui ne touche personne, et qui ne transmet pas cette sensation de la faim. Mais si j'inventais une situation qui n'existe pas, et que je disais qu'à chaque repas, on était là à guêter son bol, pour savoir si on aurait la même quantité que d'autres, et que à partir du moment où on a eu son bol, on n'est que plongé dans son bol et surtout on veille à ce que personne ne vole même un seul grain, c'est plus vrai que si je faisais la première version. Voilà le rapport entre les faits qui se sont passés et la vérité vécue. Donc, si vous voulez, voilà ce qu'il y a dans mon livre. Tout est vrai, mais tout ne s'est pas déroulé exactement de cette façon. Il y a des choses qui se sont déroulées exactement de cette façon, et c'est la plupart du temps, mais il y a un certain nombre de choses que j'ai exprimées autrement, soit en prenant mon cas, soit en prenant un autre cas que j'ai vu ou connu, parce que ça dit plus profondément ce que je voulais dire. Voilà le rapport entre le vécu et ce qu'il y a dans le livre.
Donc, pour vous, il y a une vérité qui est plus vraie que les faits.
En littérature, oui, et en art, oui.
D'autres femmes écrivains vous ont-elles inspirée?
Inspirée, non. Mais les autres femmes écrivains, je trouve toujours ça intéressant, je trouve toujours qu'il y a quelque chose qui me concerne, mais inspirée non.
Mais, vous savez, j'aime beaucoup Duras. Parce que je trouve qu'elle écrit le français un petit peu avec une musicalité vietnamienne. Elle a dans ses phrases une musicalité orientale, et dans certains livres, elle a cette façon un peu asiatique de répéter la même chose, vous savez, de répéter une chose deux ou trois fois comme ça. Et parfois, ça surcharge un peu le texte, mais en fait je reconnais une façon d'être, une façon de s'exprimer que je trouve orientale. Je ne sais pas si, de son vivant, elle le pensait, mais en tous cas, moi, je le pense.
Donc, c'est le Viêt-nam qui l'a influencée?
Oui. C'est un certain fond, je ne sais pas, on ne peut pas dire exactement quoi, mais, quand vous lirez ces livres, vous verrez, quand on lit la phrase à haute voix, il y a une musicalité, il y a quelque chose qui ne ressemble pas à la phrase française.
Quelle a été votre expérience personnelle de l'immigration et de l'intégration?
J'ai eu une expérience facile, parce que quand je suis arrivée en France, je parlais déjà le français. J'étais à la Sorbonne, je fréquentais des gens qui étaient des étudiants, j'habitais des quartiers d'étudiants, donc c'était assez facile. Ensuite, quand je me suis mariée, j'ai changé de milieu, mais il n'y avait pas de problèmes puisque j'étais en quelque sorte une intellectuelle. J'ai épousé un Français et ça n'a pas présenté de difficultés non plus.
L'intégration, c'est une autre affaire. L'intégration est une chose qui est extrêmement lente, difficile, y compris pour des gens qui connaissent déjà le français, et qui viennent comme moi en étant étudiants, parce que l'intégration suppose l'appropriation des outils d'une société, des outils de communication, des outils de compréhension. Pour donner des exemples extrêmement terre-à-terre: au Viêt-nam on ne se serre pas la main quand on se dit bonjour, on incline un peu la tête, on fait un sourire. En France, si vous souriez aux gens, ils vous disent 'Mais qu'est-ce qu'elle veut?'. C'est trop aimable pour être honnête. On se méfie, ici, ça ne se fait pas. Qu'est-ce que c'est de sourire comme ça, c'est trop mielleux. Pour quoi faire? Qu'est-ce qu'elle veut? (rires) Donc, c'est de toutes petites petites choses. Par exemple quand je suis venue en France, je parlais un français qui était le français que j'avais appris dans les livres. En fait, je parlais un français écrit, puisque à la maison on parlait vietnamien. Je continuais en France de parler comme j'écrivais, comme on écrivait dans les livres et je me souviens très bien, mes amis français de la Sorbonne à cette époque disaient: 'Mais tu parles comme un livre.' Et c'est à partir du moment où vous commencez à parler un langage moins châtié avec plus de fautes, que cela prouve que vous êtes intégré. C'est un peu humoristique mais c'est vrai.
Donc si vous voulez, l'expérience de l'immigration, c'était assez aisé parce que je n'ai pas fait partie d'un mouvement d'immigration historique, comme par exemple les gens qui sont venus en 75 jusqu'aux années 80. C'était dans les années soixante, donc c'était individuel, c'était assez facile. Mais l'intégration, je dirais que, aujourd'hui encore — et je pense bien connaître cette société maintenant, je pense bien connaître ses rouages, ses codes, ses règles, et je pense savoir me comporter, et en général je n'ai pas de problèmes — mais au fur à mesure du temps, plus on vieillit, plus la personnalité première, plus la période de l'enfance surgit et devient présente dans la conscience, puisque on est dans une période moins bouillonnante que quand on était jeune et bien. C'est là que je remarque qu'il y a culturellement de grandes différences entre des gens qui sont natifs de France et puis des gens qui sont adoptés, parce qu'ils portent avec eux une autre culture, et moi je vois bien cette différence là et d'ailleurs c'est une différence qui pour moi est enrichissante, et non pas du tout réductrice.
Et par exemple, quand vous parlez de différence?
C'est qu' en Occident, la notion de l'individu est une notion importante, et moi je trouve que c'est un acquis humain qui est très précieux, mais à force de le développer, il prend parfois des proportions extrêmement grandes, et même énormes et exagérées, alors qu'en Orient, il n'y a pas la notion de l'individu, on n'est jamais soi-même tout seul, on est toujours le fils de quelqu'un, la fille de quelqu'un, la nièce de quelqu'un, le voisin de quelqu'un, et on est dans un tissu d'ensemble, où on a sa place, et cette place est d'un certain côté très confortable, parce que le tissu vous maintient, vous soutient, mais en même temps vous ne pouvez pas avoir de liberté de mouvement, parce qu'en même temps elle est comme une camisole. Alors qu'ici en France où je vis, il n'y a rien qui soutient, je suis très libre, mais en même temps je suis très seule, comme tous les autres. C'est-à-dire que notre liberté, nous la payons par le prix de la solitude. Et donc, ça c'est une différence culturelle qui est importante, et pour en revenir à toujours cette même question: J'ai une amie vietnamienne qui a une soixantaine d'années, et elle a des enfants qui ont été élevés d'une manière semi-occidentale, et elle me dit qu'elle est de la génération sacrifiée, puisque, quand elle était jeune, elle avait à prendre soin de ses parents, et maintenant qu'elle a des enfants, et que ses enfants ont été éduqués autrement, elle ne peut pas compter sur ses enfants, c'est-à-dire qu'elle a donné mais qu'elle ne reçoit plus, et dans la chaîne des générations, elle a perdu. Mais en même temps, elle a gagné aussi une liberté qu'elle n'aurait pas eue si elle était là-bas. Parce que les enfants ne prenant pas soin d'elle, ne se mêlent pas de sa vie. Alors que si elle avait été dans une société ancienne, dans la société vietnamienne d'encore aujourd'hui, c'est le fils aîné qui va lui dire, tu as fait comme ceci, c'est pas très bien maman. Parce que c'est lui qui va être le chef de famille, et qui va la conseiller, mais qui va aussi prendre soin d'elle, comme les autres enfants, quoi. Voilà la différence culturelle que j'ai constatée à plusieurs reprises.
Selon vous, la notion d'identité constitue-t-elle un problème?
Pour moi, oui, ça constitue un problème personnel puisque n'étant ni d'un côté ni de l'autre, n'étant ni Vietnamienne, ni Française, c'était un flou identitaire qui était certainement assez déséquilibrant, et qui probablement a marqué ma personnalité. Moins chez les Asiatiques qui sont ici, parce que leur sens de la famille est extrêmement fort, mais fort non seulement dans le sens de sauvegarder les traditions de la société initiale, mais aussi dans la solidarité c'est-à-dire que les Asiatiques, souvent, quand ils viennent ici, ils travaillent beaucoup, ils ont de l'argent, ils envoient leurs enfants à l'école, ils veillent à ce qu'ils réussissent, ce qui fait que c'est plus soudé.
Que veut dire l'identité vietnamienne pour vous?
Pour moi, c'est-à-dire chez moi, dans ma personnalité, et bien, vous savez, c'est la grande moitié de moi-même. Quand je dis grande, c'est pas dans le temps, parce que j'ai passé plus de temps en France qu'au Viêt-nam, à vrai dire, mais comme les premiers temps de la formation d'un être humain sont capitaux, disons que ce sont les fondations de la personnalité, la partie vietnamienne. Ensuite, au-dessus de cette fondation-là, il s'est construit quelque chose qui est très solide aussi, qui est extrêmement important, c'est la partie française, et dans cette partie française, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est la langue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais écrire en vietnamien, mais je ne peux pas écrire de la littérature en vietnamien, alors que j'écris en français quand il s'agit de littérature. Evidemment je sais écrire une lettre en vietnamien, pour l'envoyer à ma famille, mais pour atteindre le niveau littéraire, je ne suis plus capable. Donc aujourd'hui, je n'ai qu'une langue, vraiment, c'est le français. Alors, vous voyez, la fondation de la personnalité est vietnamienne, mais l'outil d'expression c'est le français.
Et est-ce que vous avez le sentiment que vous avez perdu quelque chose?
Non, parce que, au contraire, pour la première fois maintenant, je trouve que les deux parties de moi-même sont réconciliées, c'est-à-dire aujourd'hui, je suis les deux, les deux de façon importante, et je le sais moi, et je n'ai pas besoin que quelqu'un me l'attribue. Je n'ai pas besoin que la société vietnamienne me reconnaisse ni que la société française me reconnaisse. Ecrire en français, c'est être français.
Mais vous travaillez aussi en tant que traductrice?
Justement oui. C'est pour ne pas perdre contact avec les fondations de ma personnalité, c'est pour rester les deux. Et aujourd'hui, j'ai la chance, enfin, de réconcilier ces deux parties de moi-même, et de pouvoir les faire vivre parallèlement.
Notes
[1] Kim Lefèvre, Métisse blanche, Paris: Bernard Barrault, 1989; Paris, Editions J'ai Lu, 1990.
[2] Kim Lefèvre, Retour à la saison des pluies, Paris : Bernard Barrault, 1990 ; La Tour d'Aigues : Editions de l'Aube, 1995.
[3] Kim Lefèvre, Retour, p. 16.
| See also Nathalie Nguyen's article: Writing and Memory in Kim Lefèvre's Autobiographical Narratives in "Intersections" Issue 5, (May 2001). |
 Nathalie Nguyen lectures in French at the School of Language and Media of the University of Newcastle. Her research interests include Vietnamese Francophone literature, autobiographical narratives by Vietnamese women in English and in French, twentieth-century French and Francophone literature, and women's writing . Her publications comprise: Vietnamese Voices: Gender and Cultural Identity in the Vietnamese Francophone Novel. DeKalb: Northern Illinois University, Southeast Asia Publications. (forthcoming) ; Nathalie Nguyen lectures in French at the School of Language and Media of the University of Newcastle. Her research interests include Vietnamese Francophone literature, autobiographical narratives by Vietnamese women in English and in French, twentieth-century French and Francophone literature, and women's writing . Her publications comprise: Vietnamese Voices: Gender and Cultural Identity in the Vietnamese Francophone Novel. DeKalb: Northern Illinois University, Southeast Asia Publications. (forthcoming) ;  "Across Colonial Borders: Patriarchal Constraints and Vietnamese Women in the Novels of Ly Thu Ho", Of Vietnam: Identities in Dialogue. Eds. Jane Winston and Leakthina Ollier. New York: Palgrave. (2001), pp.193-210 ; "Across Colonial Borders: Patriarchal Constraints and Vietnamese Women in the Novels of Ly Thu Ho", Of Vietnam: Identities in Dialogue. Eds. Jane Winston and Leakthina Ollier. New York: Palgrave. (2001), pp.193-210 ;  "Images of Postwar Vietnam in Phan Huy Duong's Un Amour métèque: Nouvelles". The French Review, Special Issue on Francophone Literature (forthcoming May 2004) ; "Images of Postwar Vietnam in Phan Huy Duong's Un Amour métèque: Nouvelles". The French Review, Special Issue on Francophone Literature (forthcoming May 2004) ;  "Writing and Memory in Kim Lefèvre's Autobiographical Narratives", Intersections no. 5 (2001) [ https://wwwsshe.murdoch.edu.au/intersections/issue5/nathalie.html] ; "Writing and Memory in Kim Lefèvre's Autobiographical Narratives", Intersections no. 5 (2001) [ https://wwwsshe.murdoch.edu.au/intersections/issue5/nathalie.html] ;  "A Classical Heroine and Her Modern Manifestation: The Tale of Kieu and Its Modern Parallels in Printemps inachevé", The French Review 73-3 (2000), pp.454-462. "A Classical Heroine and Her Modern Manifestation: The Tale of Kieu and Its Modern Parallels in Printemps inachevé", The French Review 73-3 (2000), pp.454-462.
|
Back to [the top of the page] [the contents of this issue of MOTS PLURIELS]