No 20. Fevrier 2002.
https://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP2002edito1.html
© Alexie Tcheuyap
Alexie Tcheuyap
Université de Calgary
|
|
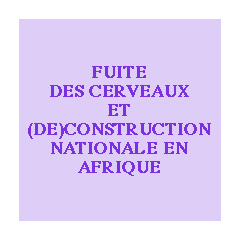
En marge des nombreux mirages qu'elle construit et de la sournoise uniformisation idéologique qu'elle déploie, la « mondialisation » a aussi pour manifestation concrète la mobilisation/mobilité des personnes, ces dernières étant ramenées de plus en plus souvent aux simples dimensions d'un capital, d'un bien dont le rendement et la rentabilité ne doivent être remises en cause sous aucun prétexte. L'humain devenu simple matérialité, des mutations surprenantes et non moins contradictoires s'imposent désormais à la sociologie de l'emploi: on assiste à une certaine tolérance de l'Autre dans les pays où la ségrégation, voire la xénophobie étaient de règle. La présence du Noir[1] devient plus importante, même là où l'usager ne s'attendait pas à la rencontrer, car les employeurs du Nord ont dû se résoudre ou se résigner à élargir leurs aires de recrutement sous le poids des exigences économiques.
Les aspects positifs de l'entrebâillement de la porte permettant à certains Africains de trouver une place au « paradis du Nord » ne pèsent toutefois pas lourd face aux frustrations de milliers d'autres personnes pour lesquelles l'Occident est devenu un véritable cauchemar. Au terme d'une émigration vers un ailleurs espéré meilleur, les diplômes, acquis après un dur labeur, perdent souvent toute leur valeur et conduisent moins souvent au succès qu'à l'alcoolisme, aux trafics en tous genres, à la poussière des métros, aux eaux crasseuses des restaurants, aux sièges de taxis usés ou au sang des boucheries industrielles. Dans la mesure où le diplômé doit embrasser une profession qui ne lui était jamais apparue, même dans ses pires cauchemars, le diplôme mentionné dans son CV ne sert plus à rien, mais il faut bien (sur)vivre!
Que le niveau d'instruction des immigrants africains soit très élevé (par exemple, plus de 80 % des immigrants africains à Montréal ont auparavant suivi des études universitaires[2]) ne signifie pas que le pays d'accueil va utiliser leur compétence de manière judicieuse. Si le Nord et le Grand capital ont besoin de cerveaux, il ont aussi besoin de main-d'oeuvre à exploiter et leurs choix se font souvent sans tenir compte des aspirations, de la formation ou du potentiel intellectuel des individus. De même, la mondialisation ne tient pas davantage compte de l'intérêt et du développement des pays du Sud qui continuent, comme à l'époque de la traite ou des colonies, à être taillables et corvéables à merci.
Le bilan de cette mobilisation/mobilité, qui arrange aussi bien les économies dévastatrices du Nord que les régimes corrompus du Sud, reste à faire et il nous a semblé nécessaire d'engager une réflexion en profondeur. La présence de plus en plus (re)marquée de diplômés et de cadres africains dans les pays du Nord est le signe d'un malaise profond, tant au Nord qu'au Sud. De plus en plus d'Africains partent, de moins en moins reviennent, et la saga de « l'étudiant noir » ou du « nègre à Paris », engagé dans une « aventure ambiguë » le ramenant quand même dans son « pays natal » est désormais révolu! Pour bien des diplômés africains d'aujourd'hui, « partir » ne rime plus avec « revenir » mais avec « Voir l'Occident et /ou (y) mourir! » Et c'est un signe des temps que le continent africain soit devenu un pourvoyeur de main-d'oeuvre - souvent hautement qualifiée - au moment où il a le plus besoin de cerveaux africains en tout genre servant dans leurs pays d'origine, dont la plupart sont en faillite totale. Le jargon institutionnel a même trouvé une expression seyante pour qualifier le phénomène : Transfert Inverse de Technologie (Reverse Transfer of Technology). Les articles proposés dans ce numéro de Mots Pluriels abordent la problématique de la fuite des cerveaux à partir de différentes perspectives : littéraires, sociologiques, anthropologiques et politiques. Après avoir offert un certain nombre de repères conceptuels, ce dossier examine les rapports entre la théorie et la pratique et théorise le vécu des migrations des cadres africains.
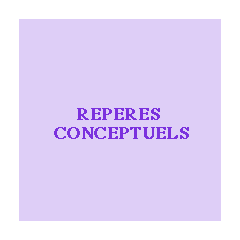 Dans le premier article,
Dans le premier article,
![]() opère une
série de mises au point sémantiques sur le concept de «
cerveaux » avant d'aborder les diverses tendances et les
présupposés idéologiques du discours sur le sujet.
Guèye nous met en garde contre la nature essentialiste,
réductrice et liberticide de certaines formulations théoriques
sur la mobilité des Africains qualifiés et il suggère que
l'expatriation ne remet pas en question l'appartenance à l'Afrique. Le
rôle positif joué par la constitution de réseaux
diasporiques et « transnationaux » analysé par
opère une
série de mises au point sémantiques sur le concept de «
cerveaux » avant d'aborder les diverses tendances et les
présupposés idéologiques du discours sur le sujet.
Guèye nous met en garde contre la nature essentialiste,
réductrice et liberticide de certaines formulations théoriques
sur la mobilité des Africains qualifiés et il suggère que
l'expatriation ne remet pas en question l'appartenance à l'Afrique. Le
rôle positif joué par la constitution de réseaux
diasporiques et « transnationaux » analysé par
![]() en fait la preuve. Son étude montre les effets positifs
que peut avoir la mobilisation des expatriés pour le
développement socio-economique et politique du continent africain.
Toutefois, comme le relèvent
en fait la preuve. Son étude montre les effets positifs
que peut avoir la mobilisation des expatriés pour le
développement socio-economique et politique du continent africain.
Toutefois, comme le relèvent
![]() et
et
![]() si certains pays ont pu tirer profit d'une
accélération des départs de leurs élites vers les
pays industrialisés, il est loin d'être certain que ce «
brain drain » soit systématiquement un « brain gain
» à long terme. En dépit de la rhétorique
néolibérale, la migration des personnes hautement
qualifiées vers les pays d'accueil semble bien rester un handicap pour
les pays qui voient partir leurs élites. Cependant, plutôt que de
rejeter le blâme de la faillite actuelle sur un bouc émissaire -
en particulier sur ceux qui quittent leur pays d'origine -
si certains pays ont pu tirer profit d'une
accélération des départs de leurs élites vers les
pays industrialisés, il est loin d'être certain que ce «
brain drain » soit systématiquement un « brain gain
» à long terme. En dépit de la rhétorique
néolibérale, la migration des personnes hautement
qualifiées vers les pays d'accueil semble bien rester un handicap pour
les pays qui voient partir leurs élites. Cependant, plutôt que de
rejeter le blâme de la faillite actuelle sur un bouc émissaire -
en particulier sur ceux qui quittent leur pays d'origine -
![]() suggère qu'il est temps de dépasser les contradictions
empiriques et théoriques et d'aborder les effets de la fuite des
cerveaux de manière unifiée, collective et propre à mettre
en valeur le savoir des Africains, où qu'ils se trouvent. Un beau
programme, sans doute, mais assez proche de l'utopie.
suggère qu'il est temps de dépasser les contradictions
empiriques et théoriques et d'aborder les effets de la fuite des
cerveaux de manière unifiée, collective et propre à mettre
en valeur le savoir des Africains, où qu'ils se trouvent. Un beau
programme, sans doute, mais assez proche de l'utopie.
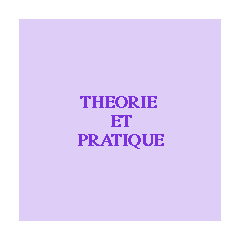 L'étude percutante de
L'étude percutante de
![]() en témoigne et
relève d'une longue expérience de « cerveau en fuite
». Avec les aberrations qu'elles suscitent, les dictatures africaines ne
reconnaissent les « cerveaux » que lorsqu'ils ont pu
s'échapper. L'exil devient alors le gage de la légitimation d'une
compétence (re)niée par des pouvoir ayant peur du savoir et de la
vérité. Comme il l'indique, cette légitimation n'est
conférée que par la société. La compétence
devient dès lors un enjeu politique. Dès lors, revenir est
souvent aussi difficile que partir et l'article d'
en témoigne et
relève d'une longue expérience de « cerveau en fuite
». Avec les aberrations qu'elles suscitent, les dictatures africaines ne
reconnaissent les « cerveaux » que lorsqu'ils ont pu
s'échapper. L'exil devient alors le gage de la légitimation d'une
compétence (re)niée par des pouvoir ayant peur du savoir et de la
vérité. Comme il l'indique, cette légitimation n'est
conférée que par la société. La compétence
devient dès lors un enjeu politique. Dès lors, revenir est
souvent aussi difficile que partir et l'article d'![]() sonne
comme une sentence : il n'y a pas de retour heureux. Pour bien des raisons, le
tragique guette les cadres retournés au bercail et, avec l'aggravation
des conditions de vie, la perspective d'un « retour au pays natal
» donne des frayeurs. Au point que l'on pourrait se demander si
émigrer n'est pas une fatalité.
Émigrer vers l'Occident,
certes, mais aussi, parfois, vers un pays voisin comme le montre
sonne
comme une sentence : il n'y a pas de retour heureux. Pour bien des raisons, le
tragique guette les cadres retournés au bercail et, avec l'aggravation
des conditions de vie, la perspective d'un « retour au pays natal
» donne des frayeurs. Au point que l'on pourrait se demander si
émigrer n'est pas une fatalité.
Émigrer vers l'Occident,
certes, mais aussi, parfois, vers un pays voisin comme le montre
![]() dans un texte très personnel qui souligne les « mauvaises
habitudes » acquises par les Nigérians et autres Africains de l'Ouest
lorsqu'ils s'installent en Afrique du Sud et y adoptent, de l'avis de l'auteur,
une attitude « macho » très répandue dans le sous-continent, et ailleurs.
dans un texte très personnel qui souligne les « mauvaises
habitudes » acquises par les Nigérians et autres Africains de l'Ouest
lorsqu'ils s'installent en Afrique du Sud et y adoptent, de l'avis de l'auteur,
une attitude « macho » très répandue dans le sous-continent, et ailleurs.
Si la fuite de cerveaux a bien une dimension inter-africaine, c'est
surtout le départ des élites vers les pays du Nord qui est
préoccupant, d'où les efforts faits en Afrique même pour en
limiter les effets désastreux. L'étude de cas de
![]() de l'Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine
Vétérinaires de Dakar relève le rôle des
institutions sous-régionales dans la lutte contre les migrations des
personnes qualifiées à partir d'une expérience de terrain.
L'auteur y énumère une série de propositions
concrètes pouvant permettre d'inverser ou, tout au moins, de
réduire les flux migratoires. Mais, pour un exemple positif, combien de
pays restent à la traîne, paralysés par la mondialisation.
de l'Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine
Vétérinaires de Dakar relève le rôle des
institutions sous-régionales dans la lutte contre les migrations des
personnes qualifiées à partir d'une expérience de terrain.
L'auteur y énumère une série de propositions
concrètes pouvant permettre d'inverser ou, tout au moins, de
réduire les flux migratoires. Mais, pour un exemple positif, combien de
pays restent à la traîne, paralysés par la mondialisation.
![]() considère de manière lucide le cas du
Cameroun, l'un des pays ayant une remarquable visibilité en Occident en
ce qui concerne le nombre de cadres et d'universitaires expatriés, mais
sa conclusion pourrait s'appliquer à bien d'autres pays : « En
résumé, on retiendra que même si l'on a conscience du
problème de la fuite des cerveaux et de la nécessité du
renforcement des capacités nationales en vue du développement
durable, les pays africains, et notamment le Cameroun, n'ont pas encore pris
les mesures requises. Cela est particulièrement vrai pour le
problème de l'exode des compétences qui n'a pas encore fait
l'objet de préoccupation quelconque ». Sont en cause ici, comme ailleurs,
l'absence totale de prévoyance, l'inconscience, voire l'insouciance d'un
gouvernement qui ne prend aucune mesure sérieuse pour endiguer
l'hémorragie des élites.
Pour
considère de manière lucide le cas du
Cameroun, l'un des pays ayant une remarquable visibilité en Occident en
ce qui concerne le nombre de cadres et d'universitaires expatriés, mais
sa conclusion pourrait s'appliquer à bien d'autres pays : « En
résumé, on retiendra que même si l'on a conscience du
problème de la fuite des cerveaux et de la nécessité du
renforcement des capacités nationales en vue du développement
durable, les pays africains, et notamment le Cameroun, n'ont pas encore pris
les mesures requises. Cela est particulièrement vrai pour le
problème de l'exode des compétences qui n'a pas encore fait
l'objet de préoccupation quelconque ». Sont en cause ici, comme ailleurs,
l'absence totale de prévoyance, l'inconscience, voire l'insouciance d'un
gouvernement qui ne prend aucune mesure sérieuse pour endiguer
l'hémorragie des élites.
Pour
![]() ,
l'exode des compétences ne prendra
fin que si l'Afrique change résolument de cap et si elle prend un
certain nombre de mesures: un changement de pratique et de culture politiques,
le respect des libertés individuelles et collectives,
l'amélioration des conditions de vie et de travail, l'engagement
solidaire des élites africaines, et aussi une attitude différente
vis-à-vis des femmes car, dit-elle, la perception du rôle social
des femmes en Afrique n'a pas beaucoup évolué et on a toujours
tendance à les négliger et à les sous-estimer dans tous
les secteurs de la vie économique, éducative, artistique, sociale
et politique.
,
l'exode des compétences ne prendra
fin que si l'Afrique change résolument de cap et si elle prend un
certain nombre de mesures: un changement de pratique et de culture politiques,
le respect des libertés individuelles et collectives,
l'amélioration des conditions de vie et de travail, l'engagement
solidaire des élites africaines, et aussi une attitude différente
vis-à-vis des femmes car, dit-elle, la perception du rôle social
des femmes en Afrique n'a pas beaucoup évolué et on a toujours
tendance à les négliger et à les sous-estimer dans tous
les secteurs de la vie économique, éducative, artistique, sociale
et politique.
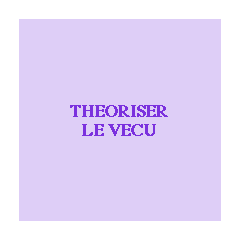 Dans une perspective « afrocentrique », presque nationaliste,
Dans une perspective « afrocentrique », presque nationaliste,
![]() dresse un tableau résolu et vigoureux des discours
sur l'identité et l'immigration des intellectuels africains. Fort utile
et d'une rare pertinence, la typologie qu'il dresse permet à chaque
« fonctionnaire de l'intellect » de se situer dans l'univers
académique contemporain et de mieux percevoir les rapports des uns et
des autres avec l'ancien « Maître », son système de valeur
hégémonique, ses clichés et sa rhétorique. Car le
drame de l'intellectuel africain, séduit par une vaine gloire, on le
verra dans l'article de
dresse un tableau résolu et vigoureux des discours
sur l'identité et l'immigration des intellectuels africains. Fort utile
et d'une rare pertinence, la typologie qu'il dresse permet à chaque
« fonctionnaire de l'intellect » de se situer dans l'univers
académique contemporain et de mieux percevoir les rapports des uns et
des autres avec l'ancien « Maître », son système de valeur
hégémonique, ses clichés et sa rhétorique. Car le
drame de l'intellectuel africain, séduit par une vaine gloire, on le
verra dans l'article de
![]() consacré à
Léopold Panet, c'est son dévouement à l'empire et à
ses valeurs. L'article d'
consacré à
Léopold Panet, c'est son dévouement à l'empire et à
ses valeurs. L'article d'
![]() exprime une idée
semblable, sans fioritures. Si l'actuelle présence des Africains dans
les institutions témoigne d'une revanche contre des théories
racistes qui en faisaient des incapables, il n'en demeure pas moins, à
ses yeux, qu'il s'agit d'une « nouvelle traite négrière
». Une traite en réalité commencée en Afrique
où les roitelets nègres s'acharnent sans pitié sur les
universitaires locaux à qui ils préfèrent souvent des
expatriés de la « coopération » dont
l'incompétence est parfois scandaleuse.
exprime une idée
semblable, sans fioritures. Si l'actuelle présence des Africains dans
les institutions témoigne d'une revanche contre des théories
racistes qui en faisaient des incapables, il n'en demeure pas moins, à
ses yeux, qu'il s'agit d'une « nouvelle traite négrière
». Une traite en réalité commencée en Afrique
où les roitelets nègres s'acharnent sans pitié sur les
universitaires locaux à qui ils préfèrent souvent des
expatriés de la « coopération » dont
l'incompétence est parfois scandaleuse.
![]() explore
les responsabilités civiques des universitaires qui décident
d'abandonner leurs pays pour échapper aux ajustements structurels et aux
brimades de tyranneaux corrompus et qui se retrouvent, pour leur malheur, dans
des pays où l'immigration se révèle souvent plus
aisée que l'intégration et la réussite professionnelle. La
perception négative de l'Afrique en Occident et l'idéologie qui
domine les relations Nord-Sud pèsent de tout leur poids sur l'avenir
d'immigrés souvent exploités de manière
éhontée.
explore
les responsabilités civiques des universitaires qui décident
d'abandonner leurs pays pour échapper aux ajustements structurels et aux
brimades de tyranneaux corrompus et qui se retrouvent, pour leur malheur, dans
des pays où l'immigration se révèle souvent plus
aisée que l'intégration et la réussite professionnelle. La
perception négative de l'Afrique en Occident et l'idéologie qui
domine les relations Nord-Sud pèsent de tout leur poids sur l'avenir
d'immigrés souvent exploités de manière
éhontée.
 Dans quelle mesure, la généralisation des nouvelles technologies
permettra-t-elle de dépasser ces anciens clivages et de freiner la fuite
des cerveaux en facilitant l'accès de l'Afrique au savoir et à
des données sur lesquels l'Occident base son développement?
Est-ce souhaitable? Il est trop tôt pour le dire, mais
Dans quelle mesure, la généralisation des nouvelles technologies
permettra-t-elle de dépasser ces anciens clivages et de freiner la fuite
des cerveaux en facilitant l'accès de l'Afrique au savoir et à
des données sur lesquels l'Occident base son développement?
Est-ce souhaitable? Il est trop tôt pour le dire, mais
![]() souligne qu'en dépit des modestes succès qu'il a eu en Afrique,
l'Internet reste solidement ancré dans les pays du Nord et il convient
de se demander si les efforts mesurés faits par les pays occidentaux
pour connecter l'Afrique n'ont pas pour but principal de créer de
nouveaux marchés permettant d'y écouler leurs produits. Comme le
relève
souligne qu'en dépit des modestes succès qu'il a eu en Afrique,
l'Internet reste solidement ancré dans les pays du Nord et il convient
de se demander si les efforts mesurés faits par les pays occidentaux
pour connecter l'Afrique n'ont pas pour but principal de créer de
nouveaux marchés permettant d'y écouler leurs produits. Comme le
relève
![]() dans un article hors dossier
consacré à la Russie, couper tous les ponts avec le passé
et se laisser emporter par le matérialiste occidental n'offrent aucune
garantie de succès. Certes, on ne peut ignorer qu'à ses risques
et périls la marche triomphante d'un capitalisme conquérant ;
mais apprendre à composer avec elle ne signifie pas s'y soumettre corps
et âme. L'Afrique a trop souvent été la victime de
faux-savoirs venus d'ailleurs et, comme le suggère
dans un article hors dossier
consacré à la Russie, couper tous les ponts avec le passé
et se laisser emporter par le matérialiste occidental n'offrent aucune
garantie de succès. Certes, on ne peut ignorer qu'à ses risques
et périls la marche triomphante d'un capitalisme conquérant ;
mais apprendre à composer avec elle ne signifie pas s'y soumettre corps
et âme. L'Afrique a trop souvent été la victime de
faux-savoirs venus d'ailleurs et, comme le suggère
![]() dans son analyse d'un ouvrage de José Tshisungu wa Tshisungu , il lui
appartient de trouver une solution « de l'intérieur » en
s'imprégnant de sa réalité historique.
dans son analyse d'un ouvrage de José Tshisungu wa Tshisungu , il lui
appartient de trouver une solution « de l'intérieur » en
s'imprégnant de sa réalité historique.
Comme en témoignent la nouvelle d'
![]() et trois
entretiens d'écrivains africains inclus dans ce dossier, l'Afrique
traverse des moments très difficiles. À partir de leurs oeuvres
et de leurs expériences respectives, le Congolais
et trois
entretiens d'écrivains africains inclus dans ce dossier, l'Afrique
traverse des moments très difficiles. À partir de leurs oeuvres
et de leurs expériences respectives, le Congolais
![]() ,
l'ivoirienne
,
l'ivoirienne
![]() et la sénégalaise
et la sénégalaise
![]() (interviewée par Julie Van Dam)
proposent un réquisitoire
sévère des potentats africains, dont les gesticulations tragiques
acculent leurs concitoyens au désespoir et les poussent à fuir la
misère ambiente pour offrir leurs services ailleurs. Dans ce contexte
difficile, la présente édition de Mots Pluriels ne
prétend pas apporter des solutions « clé en mains »
comme ce que proposent souvent en Afrique la coopération et les
institutions bilatérales. Mais au-delà des controverses
idéologiques, il demeure difficile de prétendre que
l'hémorragie des personnes qualifiées ne soit pas un
problème pour l'Afrique. Toutefois, elle n'est pas non plus une
fatalité. Elle est la conséquence de faits socio-historiques
précis. Car, comme le disait fort justement le chercheur chinois C.H. C.
Kao à propos de son pays, « les cerveaux vont où les
cerveaux sont, les cerveaux vont où l'argent est, les cerveaux vont
là où l'humanité et la justice prévalent, les
cerveaux vont là où reconnaissance et la saine compétition
sont assurées. »[3]. Ce discours
est transférable à l'Afrique et il revient à divers
gouvernements de prendre leurs responsabilités, car la fuite
endémique des cerveaux africains est un problème politique.
(interviewée par Julie Van Dam)
proposent un réquisitoire
sévère des potentats africains, dont les gesticulations tragiques
acculent leurs concitoyens au désespoir et les poussent à fuir la
misère ambiente pour offrir leurs services ailleurs. Dans ce contexte
difficile, la présente édition de Mots Pluriels ne
prétend pas apporter des solutions « clé en mains »
comme ce que proposent souvent en Afrique la coopération et les
institutions bilatérales. Mais au-delà des controverses
idéologiques, il demeure difficile de prétendre que
l'hémorragie des personnes qualifiées ne soit pas un
problème pour l'Afrique. Toutefois, elle n'est pas non plus une
fatalité. Elle est la conséquence de faits socio-historiques
précis. Car, comme le disait fort justement le chercheur chinois C.H. C.
Kao à propos de son pays, « les cerveaux vont où les
cerveaux sont, les cerveaux vont où l'argent est, les cerveaux vont
là où l'humanité et la justice prévalent, les
cerveaux vont là où reconnaissance et la saine compétition
sont assurées. »[3]. Ce discours
est transférable à l'Afrique et il revient à divers
gouvernements de prendre leurs responsabilités, car la fuite
endémique des cerveaux africains est un problème politique.
Notes
[1] Voir les « ajustements » stratégiques, mais forcés en Europe, notamment en France et en Allemagne.
[2] Dorothy W. Williams, « Histoire résumée des noirs montréalais », in James L. Torczyner et All, L'Évolution de communauté noire montréalaise : mutations et défis, Montréal, CMEPSS, p.15.
[3] Cité par Anne Marie Gaillard et Jacques Gaillard, Les enjeux des migrations scientifiques internationales. De la quête du savoir à la circulation des compétences, Paris, L'Harmattan, 1999, p.157.
 | Alexie Tcheuyap a été formé à Moray House College of Education (Edinburgh), à L'Ecole Normale Supérieure (DIPES I &II), à l'Université de Yaoundé (Licence ès Lettres Bilingues, Maîtrise et Doctorat de 3ème Cycle en littérature africaine) et à Queen's University (Kingston, Canada. PhD en littérature et cinéma). Il est l'auteur de Esthétique et folie dans l'oeuvre romanesque de Pius Ngandu Nkashama (Paris/Montréal: L'Harmattan, 1998, 240p), Littérature et Cinéma et Afrique francophone. Présence Francophone no 57, (2001) (avec Sada Niang, Eds.) et d'articles dans Protée, Research in African Literatures, CiNéMAS, Bulletin of Francophone Africa, Palabres, LittéRéalité et Mots Pluriels. Il enseigne les littératures et cinémas francophones à l'Université de Calgary. Publié en ligne : Le moine habillé. Réflexes vestimentaires et mythologiques identitaires en Afrique Mots Pluriels 10 (1999). |
Back to [the top of the page] [the contents of this issue of MOTS PLURIELS]