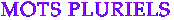
No 20. février 2002.
https://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP2002jvd.html
© Julie Van Dam et Fama Diagne Sène
Des ténèbres à la lumière :
proposé par Julie Van Dam
Cette interview a été réalisée les 26 et 27 mai 2001
Votre premier roman, "Le Chant des
ténèbres"[1]
aborde de manière originale et intime le thème de la folie, un
thème récurent de la littérature africaine d'expression
française depuis la publication de "L'Aventure
ambiguë"[2], en
1961. Qu'est-ce qui vous a inspirée et poussée à
écrire sur la folie de cette façon ?
Je pense que quand on écrit un premier roman, on ne sait jamais tout
à fait de quoi on veut parler. On observe autour de soi et il y a des
choses qui frappent le regard. Et dans ma recherche d'un sujet
d'écriture, dans ma recherche de personnages, j'ai été séduite, ou
plutôt prisonnière, de ces jeunes personnes - surtout des jeunes
filles malades mentales de plus en plus nombreuses au Sénégal, -
qui se retrouvent subitement, comme ça, en une journée bien
ordinaire, confrontées avec la folie. Au Sénégal et
peut-être partout dans le monde, ces personnes sont mal comprises,
et en voulant les aider parfois on les enfonce de plus en plus dans la maladie.
C'est en épousant la personnalité de la personne malade, en
pénétrant dans son for intérieur, qu'on parviendra à prendre part à ce
qu'elle ressent, à faire partager son message, à avertir
l'humanité : "Attention, arrêtez-vous une seconde pour lire
dans mon regard la voix interne de mes souffrances." Donc, ce choix
m'est venu comme ça, un peu par hasard et à cause de l'augmentation dramatique des maladies mentales au
Sénégal, chez les femmes et surtout les jeunes.
On pense souvent que les sociétés africaines tolèrent
mieux la folie que les sociétés occidentales mais "Le Chant des
ténèbres" semble montrer au contraire que les malades mentaux
sont rejetés en marge de la famille et de la société au
Sénégal comme ailleurs. Est-ce un phénomène
récent?
Je ne crois pas que ça soit récent. Dans la
société africaine, on vit dans une famille très large. On
vit avec les frères, les tantes, les cousins. Les familles sont encloses
dans leurs villages... il y a même des familles qui constituent des clans
de plus de cent personnes ! Mais depuis très longtemps, le
malade mental est source d'isolement et de marginalisation dans nos
sociétés. On a honte de ces malades mentaux, et
souvent quand on va visiter des familles on ne les voit pas parce qu'ils sont enfermés. On ne les voit pas et on dit :
"Dans ce village, il n'y a pas de fous", alors qu'il y a des
fous enfermés quelque part.
Donc, c'est une société qui rejette les fous en marge en les
isolant, en les enchaînant, mais parfois ils arrivent à briser
leurs chaînes et à s'enfuir, et ils vont vivre ailleurs, loin des
leurs. L'Afrique n'a jamais été tolérante vis à vis
des malades mentaux. Elle a essayé, peut-être, de les
guérir, de les ramener à la normale avec les moyens des tradi-praticiens ou
bien, en les isolant chez ces tradi-praticiens. Mais vraiment, nous n'avons
jamais eu chez nous des familles tolérantes vis à vis des
malades mentaux.
Il est souvent difficile de savoir pourquoi quelqu'un devient fou. Dans
votre ouvrage, par exemple, on se demande si la maladie de
l'héroïne Madjigéen est due au départ de sa
mère, à un amour non partagé du père, à une
malédiction ou tout simplement à un dérèglement
psychique inexplicable? Dans une interview récente, vous disiez que les
maladies mentales s'attaquent souvent à des personnes qui ont
été fragilisées quelque part et qu'elles frappent surtout
les jeunes. Quel rôle la famille et la société peuvent-ils
jouer pour diminuer le nombre de ceux qui sombrent dans la folie, quelle sorte
de secours peut-on offrir aux victimes et quelle attitude devrait-on avoir
vis-à-vis des gens atteints de folie?
C'est vrai que même les psychiatres ont des difficultés
à dire exactement ce qui bouleverse la vie d'une personne. C'est
très difficile. C'est un ensemble de situations. Il n'y a jamais un seul
fait qui entraîne cette rupture de la raison. Moi, j'ai donc
évoqué plusieurs pistes, et c'est toujours comme ça. On
cherche souvent la raison, mais, il est difficile d'en trouver une seule
parce qu'on reçoit des chocs de toutes parts et c'est comme ça
pour Madjigéen - avec l'amour non partagé du père, avec le
départ de la maman qui abandonne la famille...c'est tout ça. On
essaie de digérer ces chocs et puis en arrive un autre : l'angoisse, le
stress de l'examen du baccalauréat à faire dans quelques petites
semaines. Elle est aînée de la famille, la mère est partie,
elle veut réussir ... l'ambition et tout cela. Alors elle craque
à un moment donné, mais il y a eu tout un passé de
désespoir, d'obsession et de stress.
Vous soulevez aussi le rôle de la famille et de la société
dans la folie. Moi, je tiens énormément à la famille. Elle
est sacrée. Et je pense que si je n'avais pas eu un père
merveilleux, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Très tôt
déjà, il m'a donné le goût des livres et il m'a
donné la force de persévérer dans mon choix. Parce
qu'à l'époque, quand j'étais au collège, il y avait
déjà Aminata Sow Fall qui avait publié La Grève
des battus. Il y avait eu aussi Mariama Bâ qui avait publié
Une si longue lettre. Et j'ai demandé à mon père :
"Qui sont les autres femmes qui écrivent ?" Il m'a
répondu : "Ah, elles sont peu nombreuses encore !" Je
lui ai dit que je voulais écrire, mais je croyais que c'était
difficile. Ce à quoi il m'a répondu : "Oui, c'est
difficile mais ce qui est important dans la vie c'est de vouloir quelque chose
et de se battre pour cette chose jusqu'à ses dernières
énergies. Quand tu te bats vraiment pour quelque chose, tu réussis.
Et n'oublies pas que je suis là, je suis ton père et je ne vis
que pour la famille, pour toi, pour tes ambitions. Et la maman aussi. Tu as
déjà sur qui compter." Et quand dans la vie on a ce genre
d'appui et de personnes aimantes vers qui l'on peut aller se réfugier, se
blottir et être sûr d'obtenir du secours, c'est vraiment important. Madjigéen n'a pas eu cela. Elle n'a
jamais connu la tendresse de la maman qui n'était pas
du tout tendre, elle n'était pas maternelle. Le père n'était pas tendre non plus. Et
dans le synopsis du livre, on parle du "poncepilatisme du père" ; oui, c'était un Ponce Pilate ! Il ne savait rien de ce qui se
passait dans sa famille. Il mettait au monde des enfants mais ce n'était
que pour les mettre au monde. L'éducation, l'amour, l'affection, ce
n'était pas important, le père ne connaissait rien de cela. Et sa
distance a affecté Madjigéen.
Je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans notre société au
Sénégal, nous voyons ce problème. Avant, il y avait peu de
gens qui se séparaient, mais maintenant, les gens se séparent,
les couples se séparent. Et quand on se sépare, soit le
père, soit la mère, garde les enfants ; et puis on
évolue séparément et on se fait la guerre pour garder les
enfants, pour leur arracher l'affection de l'autre. Madjigéen a
vécu cela, et ça laisse des traces dans cette jeunesse-là
du Sénégal. La jeunesse a encore des problèmes sur le plan
des études, sur le plan de l'emploi, on ne va pas y revenir. Vous
êtes là, Julie, vous voyez ce qui se passe ici ! Il y a
énormément d'ambitions qui grouillent dans ces jeunes ; ils
n'arrivent pas à les réaliser parce que c'est très,
très difficile ici. Les opportunités sont peu nombreuses. Ils
évoluent comme ça, avec des désirs et des ambitions
inassouvies. Et il y a des conséquences plus tard qui, plus tard, peuvent les
entraîner vers la folie. Sur ce plan, la société joue le
même rôle que certains parents et favorise le rejet et
l'incompréhension.
Mais revenons au secours dont vous parlez. Selon moi - et j'ai rencontré
un psychiatre à l'hôpital de Fann, Docteur Moussa Bâ qui a
lui aussi la même vision - la personne malade mentale à elle seule
ne peut pas guérir, ce n'est pas possible. Avec des médicaments seuls,
non plus, elle ne peut pas guérir. Il faut absolument qu'elle soit aidée
à s'en sortir parce que chez nous - et il y a plusieurs gens qui m'ont
dit ça après la parution du Chant des
ténèbres - on croyait que le fou est là comme ce
stylo, que c'est un état statique, fini ; il est fou, c'est
terminé, bloqué. Point final. Je l'expliquerai plutôt en
comparant la folie à une graine qu'on a mise sous la terre ; cette
graine peut germer et mettre des feuilles, et grandir ; c'est comme ça
la folie. Au moment où on a mis la graine sous la terre, il y a beaucoup
de possibilités quand ça commence à germer. On peut donner
des formes, aider, rectifier à ce moment là - très
tôt aux premiers moments de la folie ! Aider la personne à se
réinsérer, à ne pas s'isoler; ne pas la regarder
bizarrement, ne pas l'enchaîner, ne pas l'emprisonner dans la drogue, ne
pas l'entraîner dans les sacrifices, les sacrifices de moutons, de sang,
de kolas, de lait caillé. L'aider en l'écoutant et en lui
demandant: "Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que tu as ?" Personne ne le demande à Madjigéen.
Non, on ne pose
pas cette question. On dit : "Ah ! Elle a un regard drôlement
bizarre aujourd'hui. Ça ne va pas." Ou bien, "
Regardez... elle est restée deux heures sous la douche.
Ça ne va pas." Et c'est la famille qui la force à avaler
des médicaments pour qu'elle dorme, comme au début du roman,
quand Madjigéen a une crise. Elle a des hallucinations ; elle voit une
mer de sang avec des squelettes et son grand-père qui s'est
transformé en squelette. Quand elle sort de cette crise, elle tombe et se blesse. Sa famille la soigne mais on ne lui demande
jamais "Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que tu as vu ?" Au
contraire qu'est-ce qu'on lui donne à porter ? Un tee-shirt
rouge, la couleur du sang, et elle est horrifiée. Elle enlève le
tee-shirt et elle le jette. Et on dit, "Elle n'est pas folle - elle est
impolie." On lui apporte à manger. Qu'est-ce qu'on lui apporte
à manger ? Des brochettes avec de la sauce rouge. Ça ne va pas.
Elle y voit des vers grouillant dans du sang alors elle renverse son
repas. On dit : "Tant pis ! Elle va mourir de faim ce soir parce qu'elle
est impolie. Alors, donne-lui ses médicaments." Et avec ces
médicaments, elle dort toute la journée du lendemain sans manger,
sans s'habiller.
Pour elle, elle n'est pas folle. Ce sont les autres qui sont fous parce qu'il
ne comprennent pas. Le message ne passe pas. Et c'est ce message-là que
je veux faire passer dans Le Chant des ténèbres pour
dire : "Qu'on lui pose des questions, qu'on lui demande ce qui ne va pas."
Si on noue le contact dès les premiers moments de la folie, la personne
guérira. Et je crois à cela, à cette communication avec
les autres. Je suis sûre que c'est le meilleur moyen de lui donner des chances
de guérison.
Mais l'idée de guérison est assez complexe et votre attitude
vis-à-vis du Grand guérisseur du Sine-Saloum ou du
guérisseur Baay semble ambiguë. Tous deux semblent à même de
ramener la narratrice à un semblant de normalité, mais la folie
de Madjigéen finit par reprendre le dessus. Est-ce que cela signifie que
les médecines et les approches traditionnelles n'ont pas vraiment prise sur
la folie?
C'est vrai. Le guérisseur du Siné-Saloum est venu à
la maison pour faire des sacrifices. Avec le sang que Madjigéen a bu, le
bain qu'elle a pris et le fait de dormir dans la chambre de ses parents,
sur le lit. Le guérisseur part - et c'est ça qui est
intéressant - la famille croit que Madjigéen est guérie
parce que le guérisseur pense qu'elle est guérie. Elle, elle n'a
pas dit qu'elle était guérie. Mais la famille la croit
guérie, donc elle est guérie. La famille croit ce qu'elle veut
croire et fait vérité de ses propres désirs. Nos familles
croient beaucoup à la médecine traditionnelle, c'est vrai. On
peut amener quelqu'un à l'hôpital de Fann et puis après,
quand on l'amène chez le guérisseur, on se dit : "Ah,
voilà ! Parfait. Elle est guérie." On la
réintègre dans la maison. On lui ouvre toutes les portes. Elle va
dormir dans la grande maison. Elle peut aller jardiner. Elle peut avoir
accès aux couteaux, à toutes les choses qu'on lui interdisait
auparavant, aux allumettes et tout cela. Alors, on la regarde désherber
le jardin et on se dit : "Ah, le guérisseur est très fort !
Madjigéen maintenant est raisonnable. Elle désherbe le jardin. Ah!
Elle est en train de nettoyer le salon."
Elle, elle nous dit : "Je désherbe le jardin, c'est vrai. Je
balaie le salon aussi, mais ça ne veut pas dire que je viens de
m'apercevoir que les mauvaises herbes étouffaient les plantes, non !
C'était que durant ma maladie on avait fait disparaître tout le
matériel de jardinage de peur que je me blesse. Toutes les choses avec
lesquelles j'ai évolué dans ma maison avaient disparus en une
matinée et je ne savais plus où se trouvait quoi. Et je ne voyais
nulle part la main qui les avait fait disparaître." Son
environnement a changé sans qu'elle sache pourquoi et ça
l'enfonce dans sa maladie. C'est comme si vous vous leviez demain matin et
qu'en regardant par la fenêtre vous voyiez qu'au Sénégal, il
y a plus de rues, plus de bâtiments. Vous vous retrouvez dans un monde
sans maisons, rien. Madjigéen s'est réveillée dans une
maison avec un environnement différent et elle devient folle en essayant
de trouver ses repères dans cette maison. Au départ du
guérisseur, on dit : "Ah, oui, elle est guérie !"
Et on remet les choses en place. Elle reprend sa vie comme avant et on la croit
guérie mais au retour d'une promenade où elle a vu qu'à
Tchida le mal domine et que rien n'a changé, elle assassine sa tante.
Comme quoi, elle n'est pas guérie du tout.
Je ne voulais pas montrer que la médecine traditionnelle ne pouvait pas guérir,
mais plutôt que nous, en Afrique, nous faisons trop confiance à
cette médecine-là et dès que le marabout dit une chose, on
y croit. La famille s'est rendue compte qu'elle s'était trompée,
et à ses dépens, parce que ça finit par l'assassinat de
Tanti. C'est un appel qui dit : "Attention ! Le guérisseur, il
est savant, mais attention quand même. Il ne l'a pas guérie.
"
A Keur Baay aussi, Baay a une science certaine, comme beaucoup de
tradi-praticiens. Mais je ne pense pas que sa science puisse conduire à
la guérison de Madjigéen, à cause de son isolement.
Madjigéen était à Keur Baay, loin de sa famille, loin de
ses amis, loin de ses soeurs, et dans cette deuxième partie à
aucun moment on ne montre la visite d'un parent. Personne n'est venu la
voir ! Non seulement elle est folle, mais maintenant elle est
devenue dangereuse parce qu'elle a assassiné Tanti. On l'a donc
isolée et on a coupé les liens. Non seulement elle est
là-bas, mais personne ne va la voir. Parce qu'on veut peut-être
couper les liens du sang pour qu'elle oublie même qu'elle était
originaire de Tchida et qu'elle a une mère qui pense à elle,
qu'elle a un père qui pense à elle, qu'elle a des soeurs. Elle
n'a plus personne, sauf Maty-Thiès, la folle avec qui elle partage sa
chambre et les autres fous. Et dans cette communauté-là aussi, le
message ne passe pas. Les fous ne communiquent pas entre eux. Ils ne
s'entraident pas parce que chacun a, au fond de lui-même, toute une
histoire, tout un ensemble de peines, de difficultés avec lesquelles chacun se bat
de son côté, et même parfois ridiculise un autre fou et se
prétend plus lucide que lui.
Baay fait tout ce qu'il peut pour ses malades ; il les amène faire des
sacrifices dans le baobab sacré, il leur donne le bain du matin ; mais
ce n'est pas comme ça que la malade mentale va guérir.
Sa famille a employé la médecine traditionnelle, Madjigéen
a aussi été à l'hôpital de Fann, mais la
médecine moderne ne l'a pas guérie non plus. Elle n'est pas
guérie parce que les médicaments servaient seulement à la
droguer.
Moi, je pense que guérir une personne malade mentale est possible. C'est
une chose possible, mais il faut allier la médecine et la communication.
La médecine et l'amour. La médecine et la solidarité. La
médecine et le dialogue. L'isolement, la marginalisation, les
frustrations, l'enchaînement, l'emprisonnement ne peuvent pas s'allier
avec des médicaments pour guérir quelqu'un. Il faudrait que ces
traitements soient plus humains, que cette malade mentale
évolue dans sa maison et dans sa famille avec le psychiatre de Fann ou
avec le tradi-praticien. Il faut cet amour familial, cette aide des autres. Il
faut qu'on lui tende la main pour qu'elle sorte de l'abîme. Rien qu'avec
les sacrifices, la kola, le lait caillé ou avec l'Aldhol et le Nozinan
du psychiatre, elle ne pourra jamais vraiment guérir si elle n'a pas
l'aide et l'appui de la famille. Et ça, c'est vraiment ma conviction.
Est-ce que vous pensez qu'une femme devenue folle représente quelque chose de différent d'un homme devenu fou, pour la société,
pour la famille ?
Je ne sais pas vraiment. On pourrait peut-être demander ça
à un psychiatre mais je ne me suis pas tellement
intéressée à cela dans mon roman. Peut-être qu'en
me basant sur mon expérience personnelle je pourrais m'aventurer
à parler de ça, mais sans beaucoup de certitude.
Disons que dans nos sociétés, les familles
sénégalaises placent beaucoup, beaucoup d'espoir en la femme,
en la fille, surtout quand elle est l'aînée d'une famille. Je
suis l'aînée de ma famille et Madjigéen est
l'aînée de sa famille et je sais ce que cela veut dire :
être l'aînée et être fille. Alors on lui demande de
réussir, et on voit cela clairement dans la scène du Chant
des ténèbres qui décrit le retour de la mère et
ce qu'elle dit lorsque Tanti avoue qu'elle a donné une potion à
Madjigéen. La mère répond : "Ah, tu as
ruiné mon espoir ! Tu as rendu folle la fille aînée qui
devait me bâtir une maison, qui devait m'amener à la Mecque, qui
était toute ma fierté !" Dans notre société
la fille doit non seulement réussir ses études, sa vie
professionnelle, et devenir riche, mais aussi bien se marier, c'est-à-dire trouver un mari d'une bonne famille. Dès le plus jeune âge, quand
elle va à l'école - à partir de 5 ou 6 ans - on fait une
prière "Je prie que pour que demain, tu trouves un bon mari, que
tu aies un bon travail, pour que tu m'emmènes à la Mecque"
et tout cela. Moi, j'ai grandi comme ça. L'aînée est
porteuse d'espoir et parfois c'est trop lourd sur ses épaules et
ça s'écroule. Mais le garçon, mon Dieu, ce n'est pas cela
! On lui donne plus de temps. On dit que c'est un garçon jusqu'à
40 ans... il peut se marier jusqu'à 40 ans même. Il a sa vie ! Il
fait de longues études - mais à la femme, quand elle étudie,
on lui dit : "Ne fais pas des longues études, il faut que tu
t'arrêtes tôt, il faut que tu travailles tôt." On
n'exige jamais cela de l'homme.
Quand la fille devient folle, une malade mentale, c'est tout un espoir qui
s'écroule comme ça, d'un coup. Elle a très, très
mal. Justement parce que ça fait mal ; la fille était l'espoir de
sa mère, de son père. Quand elle est folle, on court pour la
guérir, très vite, avec le guérisseur, avec les
médicaments. Et si en deux mois, trois mois ça ne marche pas, on
l'isole, on l'emmène ailleurs pour que les gens ne viennent pas la
regarder, parce qu'on a honte, parce que "notre fille qui devait faire
ça pour nous, qui devait être tout cela est devenue folle."
Quand une fille est folle, ça veut dire qu'elle a raté
sa vie et ça se retourne contre sa mère. C'est comme quand une
fille devient fille-mère ou prostituée ou une femme de rue ; on
dit : "Ah! C'est la faute de la mère, ça. C'est
la faute de sa mère parce qu'elle n'a pas bien travaillé dans la
maison ou parce qu'elle n'a pas trop respecté le père",
des choses comme cela. Chez nous, chaque fois qu'il y a un échec dans la
famille, on l'attribue à la mère ou au père.
L'échec de la fille est encore plus difficile à supporter que
celui de l'homme.
Madjigéen est une héroïne unique parce que bien que
"folle", elle jette un regard très lucide sur sa folie.
Elle devient une amie pour le lecteur à qui elle s'adresse en employant
le pronom "tu". Elle expose ses expériences et toutes
ses émotions et à la fin du récit, elle parle même
au lecteur hors du récit. Expliquez-nous votre opinion sur la relation
entre un personnage littéraire et le lecteur.
Dans ce roman, c'est l'aboutissement d'une recherche de style et j'avoue
que quand j'écrivais le premier manuscrit du Chant des
ténèbres, - je dis le premier manuscrit parce que j'en ai fait
trois - je n'avais pas choisi de raconter l'histoire de Madjigéen
à la première personne. J'en parlais à la troisième
personne. Mais je me suis rendue compte que ça n'exprimait pas ce que je
voulais dire. Il fallait que Madjigéen aille elle-même au fond de
sa personne pour en ressortir ses pensées. C'est un roman qui devient
une forme de discours. Ce roman est un long discours parce que quand on fait un
discours, on parle forcément à quelqu'un. Pour Madjigéen,
il était plus facile de parler à un ami inconnu qu'à ses
proches avec qui elle n'arrivait pas à parler. Elle devait chercher
ailleurs.
Dans les premières pages du roman, dans sa chambre, dans le
débarras où on stockait autrefois la paille du bétail,
elle se rend compte qu'elle est condamnée à vivre dans ce lieu ;
elle est poussée à animer sa vie, à recréer le
monde, à recréer des amis. Et à Keur Baay aussi, elle a
des boîtes de "Soca" et chaque boîte
représente quelque chose : l'Université, là où elle
n'a pas pu aller ; la maison à Keuri-Kaw avec sa mère, son
père, ses soeurs ; le cimetière où était
enterré son grand-père, à Thô-Thô. Tout le
temps, tout au long de son épreuve, elle essaie de repeupler son
environnement avec son entourage. En parlant à quelqu'un, au lecteur,
elle peut parler de son isolement, elle peut communiquer. C'est pour cela que
j'ai choisi ce discours direct. Elle s'adresse à ce
personnage-là, à son lecteur, et elle le tutoie, donc, dès
que tu ouvres le roman, il n'y a pas doute, tu sais que Madjigéen
s'adresse à toi, à ce nouvel ami qu'elle vient de se faire avec
ce roman.
Alors le personnage littéraire et le lecteur... je ne suis pas
très, très forte dans les définitions, les personnages
littéraires, le pacte narratif et tout ça, parce que tout
simplement, comme on dit, je l'ai écrit comme je l'ai senti. Ce que j'ai
vu, c'est que pour faire passer le message de Madjigéen, il fallait que
ça soit un discours direct - c'est tout. Qu'elle parle à quelqu'un
car c'est vraiment dans ce cadre qu'on peut faire connaissance avec le
personnage.
Je trouve aussi que les changements du style illustrent bien la quête
de Madjigéen. La manière dont elle joue avec sa propre narration
est vraiment frappante. Par exemple, lorsqu'elle devient conteuse, qu'elle
raconte certaines scènes et qu'elle insère dans son propre
récit des contes connus, des légendes, etc.
Tout à fait. Dans ce roman, Madjigéen joue le rôle,
et elle raconte le rôle en même temps. Madjigéen se croit au
cinéma et elle joue un rôle. Pour elle, le monde est une grande
farce. Elle regarde les gens qui ont l'air fous, qui ne comprennent rien du
tout, qui se croient intelligents. Et elle, dans son isolation, elle a un peu
de recul pour analyser la situation. Elle nous dit des choses, elle nous
raconte des histoires et elle se joue de nous. Une journaliste qui avait fait
une émission sur moi m'avait dit : "Fama, j'en ai voulu un peu
à Madjigéen parce qu'elle s'est jouée de moi."
Elle faisait allusion à l'épisode où Madjigéen
raconte que dans son jardin, elle voit subitement une délégation
de voleurs et elle dit : "Ah ! C'est vous qui volez donc mes laitues !
C'est vous qui volez mes choux comme si vous les aviez cultivés ! Je
vais vous corriger et la prochaine fois vous ne volerez rien de cela,
délégation de voleurs !" Durant quatre pages elle nous joue
cette scène des voleurs mais ce n'est qu'à la fin qu'elle nous dit qui
sont ces voleurs : "Les moutons appartenant à un professeur de
droit n'ont pas le droit de ne pas connaître le droit !" Elle se
joue de nous, de notre compréhension. Elle est en train de jouer un
rôle comme au cinéma puisqu'on dit qu'elle est folle, mais à ce
moment, elle n'est pas folle du tout.
C'est vrai, il y a ces changements de style mais ce qui est intéressant,
c'est qu'on les retrouve dans la maladie elle-même. A aucun moment il ne
faut oublier que Madjigéen est folle. Et le fou, même s'il a des
moments de lucidité, n'est pas toujours lucide. J'ai eu l'occasion de
les écouter ; on se rend compte qu'ils semblent lucides pendant quelques
secondes et la minute après, ils disent des choses absolument
insensées. C'est comme une bougie : ça s'allume, ça
s'éteint. La flamme vacille. C'est comme ça dans la folie.
Madjigéen nage dans la folie, elle en ressort et elle y replonge. Elle
suit les vagues de ce style : de la folie, à la raison, à la folie ;
de la lumière, aux ténèbres, à la lumière.
Il est évident que vos expériences ont inspiré un peu
ce roman. Selon plusieurs écrivains, un personnage fictif reflète
inévitablement l'esprit de son créateur ou de sa créatrice.
Comment est-ce que vous définiriez la relation entre le personnage de
Madjigéen et vous ?
Le personnage de Madjigéen et moi ? Il y aura d'autres gens mieux
qualifiés que moi pour parler de cette relation parce qu'on est
tellement proche de ce qu'on a créé que c'est difficile de savoir
en parler. En général, les gens lisent le roman sans
connaître l'auteur, mais dès qu'ils le connaissent, ils
essaient de faire des parallèles entre le personnage et l'auteur. C'est comme
ça qu'ils m'apprennent que j'ai mis une partie de moi dans
Madjigéen. Mais quand j'ai créé ce personnage, je ne
voulais pas me mettre dedans... je l'ai créée comme ça.
Alors un professeur m'a dit : "Fama, Madjigéen est une fille
aînée comme vous." Et j'ai dit : "Oui, mais c'est
vous qui me l'apprenez !" (rires) Avec Madjigéen, je
n'étais pas dans cette perspective. Donc, comme ça, en
rencontrant les gens qui me connaissaient, qui ont lu le roman, ils ont dit
qu'il y avait beaucoup de ressemblances. Tout ce que les gens vous disent,
c'est vrai ! Et puis il y a d'autres ressemblances entre ce personnage et
moi-même... Il y a des moments de notre vie qui arrive dans le roman
comme ça et nous épousons la personnalité de ce personnage
sans vraiment le faire exprès. Et certainement vous, par exemple, en
relisant Le Chant des ténèbres vous pourriez dire :
"Ah, oui ! C'est Fama !"
Une autre remarque. Cheikh Aliou Ndao a dit que la littérature
était "une sorte de recherche de soi à travers le mot."[3] Qu'est-ce que vous en
pensez?
C'est comme cela : quand on prend sa plume pour écrire, c'est un moment
très fort, très intime. Moi, par exemple, quand je veux
écrire, c'est parce que je suis bouleversée ; il y a une forte
émotion qui m'a bouleversée et souvent qui m'a fait très
mal. Je cherche des solutions, je regarde, je ne comprends pas mais je souffre
au fond de moi-même et je trouve refuge dans l'écriture. Comme
avant, quand je souffrais dans mon enfance, je trouvais refuge dans les
livres. J'allais lire pour me retrouver. Mon écriture, c'est une
quête de savoir mais c'est en écrivant, en dialoguant avec un
personnage que je parviens à construire, pierre à pierre, un chemin vers la solution. Mais
c'est difficile... quand tout va bien, quand ça marche, je me laisse
souvent aller, j'écris doucement. Mais quand j'ai une émotion
très forte, je ressors ce qui est au fond de moi-même et c'est
après que je me rends compte qu'en écrivant j'ai essayé de
trouver des solutions à mes propres maux, à ma propre
misère, à mon propre mal. On se cherche à travers ce qu'on
fait. Parfois on se trouve, parfois on ne se trouve pas mais, ce qu'on fait, est une
quête, très intime et continue, de soi.
Au sujet de votre processus d'écriture, j'aimerais vous poser
quelques questions. Vivez-vous seule ou dans une maison très
animée? Quand et où écrivez-vous? Ecrivez-vous vos
manuscrits à la main? A la machine à écrire? Avez-vous un
ordinateur?
J'ai vécu seule pendant un moment, entre '92 et '94. C'était mon
premier poste d'enseignante dans le village de Nguérigne au
Sénégal et j'avais la mer et c'était superbe pour
écrire ! Mais en Afrique ce sont des rêves qui ne peuvent jamais
durer longtemps parce qu'on vit dans de grandes maisons. Et actuellement je
vis dans une grande maison avec ma mère, mes soeurs, mes frères,
mes fils et mon mari, donc il y a plein de monde autour de moi. Mais on se
crée des moments de solitude. Durant les vacances on s'installe quelque
part où il y a du silence et de la tranquillité parce que
l'écriture est un acte solitaire et on a besoin d'un coin de solitude
pour arriver à écrire. Pour Le Chant des
ténèbres, je l'ai écrit à la main et au crayon.
Quand j'écris un manuscrit, j'accepte difficilement les ratures. Et
parfois il m'est arrivé de pleurer en écrivant Le chant des
ténèbres parce que j'avais perdu quelques feuilles du
manuscrit pendant mes voyages et c'était difficile de les
récrire. Heureusement qu'avec mon ordinateur, pour mon deuxième
roman, c'est beaucoup plus facile, je ne perds jamais une feuille ! Mais par
contre, je me suis rendue compte que quand j'écris avec la main, je suis
beaucoup plus proche de ce que j'écris. C'est plus direct. Alors, ce que
je fais maintenant ? J'écris à la main et puis je saisis
ça dans la machine pour le conserver.
Quels sont vos auteurs préférés ? Les écrivains
qui vous ont inspirée ?
Au fait, si vous me l'aviez demandé l'année dernière, ma
réponse aurait été différente. Je suis
assoiffée de lecture et d'écriture ! Je lis, je lis et chaque
jour je découvre des auteurs merveilleux ! Je suis séduite par
les auteurs que je viens de découvrir cette année. Par exemple
Sylviane Roche, une romancière suisse. Je sens une vie et une franchise
poignante sous sa plume. Comme le personnage de Madjigéen, ses
personnages sont ouverts. J'aime aussi le style d'écriture de Boubacar
Boris Diop et de Cheikh Hamidou Kane. Et dernièrement je viens de relire
Les Misérables de Hugo et là aussi, j'ai beaucoup
aimé les analyses psychologiques des personnages.
Je donne une grande importance à la lecture ! Quand on écrit, il faut lire les autres.
Ce n'est pas pour être à leur école, mais ce sont des
formes originales de l'écriture qui peuvent aider à un certain
moment à comprendre l'évolution des scènes et de la
manière dont on les écrit.
Votre littérature, dites-vous, est "une littérature
d'engagement". Quelles sont les grandes causes auxquelles les femmes
écrivains se doivent de prêter leur plume aujourd'hui, au
Sénégal et ailleurs ? Est-ce qu'il y a des causes
spécifiques aux femmes écrivains au Sénégal,
en Afrique et ailleurs ?
Je ne pense pas qu'il existe des causes spécifiques aux femmes,
mais je me rends compte qu'il y a des causes mieux développées
par les femmes et qu'elles gagnent beaucoup à faire passer leur
message elles-même. Ici, comme je me trouve dans
les milieux séréers, on pourrait par exemple mentionner le statut et la place de la femme dans la
société, la place de la femme dans le mariage, dans le veuvage ou
dans la prise en charge du problème social. C'est la femme - puisqu'elle est femme et
puisqu'elle est appelée à vivre ces situations - qui rend le mieux
ces situations. Le roman de Mariama Bâ [Une si longue lettre] est
un exemple. Il constitue aujourd'hui un chef-d'oeuvre sur la place même
de la femme dans la société. Il me semble qu'il y a des
thèmes qui sont mieux présentés par les femmes. Les hommes
en parlent mais quand une femme en parle, il y a une émotion
particulière ; l'intuition féminine dont nous parlons qui est en
nous et qui fait que la femme est mieux placée pour parler de ces
émotions car elle a vécu cela et elle est appelée
à le vivre. En Afrique et ailleurs.
Par exemple dans le livre Emancipation Féminine qui est un essai
sur la situation économique et la littérature, l'auteur s'est
rendu compte que la femme occidentale, la femme américaine, la femme
africaine ont certes des éducations différentes, des races
différentes, des cultures différentes, mais au delà de
cela, on se rend compte que les problèmes de la femme sont des
problèmes identiques partout dans le monde. Cette facilité
d'organisation, cette perception, cette émotion, cette intuition, cette
sensibilité de la femme lui permettent d'aborder tous les sujets de la
littérature et de les aborder bien et de les traiter bien. Il suffit
seulement qu'elle ait l'envie et l'ambition de parler d'un thème. Je
pense que la femme a tous les atouts nécessaires.
Quels sont les sujets à aborder aujourd'hui, les problèmes que les
femmes vivent ?
Ils y en a beaucoup, vraiment, ils sont très nombreux. Il y a le
thème de l'encadrement de la femme, de sa souffrance quotidienne, de
l'éducation, de l'alphabétisation. Il est inacceptable aujourd'hui
qu'à ce moment de développement de l'humanité, il y ait
encore dans le monde des gens analphabètes qui ne savent ni lire ni
écrire même dans leur propre dialecte. Il y a aussi le travail des
enfants, aujourd'hui dans les familles on vous présente une fille
à tout faire qui a onze ans, douze ans...c'est l'exploitation de ces
enfants. Il faut qu'elles aillent à l'école.
Parfois on écrit et on se demande pourquoi on écrit. Est-ce que
ça peut changer grand chose ? Pour moi ce sont des thèmes
importants, des thèmes de réflexion autour de la façon de
voir le monde, la façon d'éduquer même nos élites
intellectuelles. C'est oser faire des récits sur ça, de proposer
une réflexion, de proposer des solutions, de proposer des brassages des
différents côtés de la société pour
constituer une grande chaîne de solidarité !
Vous avez gagné le prix du Président pour les lettres en 1997.
Une autre femme écrivain, Sokhna Benga, l'a gagné en 2000. Les
romancières africaines semblent beaucoup plus
prolifiques qu'avant et elles sont, récemment, mieux reconnues. Comment voyez-vous l'avenir de l'écriture des femmes africaines ?
Avec beaucoup d'optimisme. Enormément d'optimisme ! Ça fait
vraiment plaisir de voir que les femmes se battent et croient à leur
combat. Se battre, tout le monde doit se battre. Mais croire à ce combat
c'est ça le plus difficile ! Aujourd'hui, les romancières
africaines croient à leur écriture et elles
persévèrent. Et c'est dans cette persévérance
qu'aujourd'hui elles écrivent des oeuvres reconnues et elles obtiennent
des grands prix littéraires ! On ne dit plus, "Ah! Elle a le
grand prix parce qu'elle est femme." Elle obtient le prix parce qu'elle
l'a mérité ! Ça fait grandement plaisir.
L'année où j'ai eu le grand prix, 1997, c'était une
année de consécration des femmes ! Il y a eu des
basketteuses, championnes d'Afrique ; il y a eu un grand prix à
Thiès obtenu par des femmes artisanes. Donc, on s'est rendu compte que
les femmes sont en train d'émerger dans plusieurs secteurs, et non
seulement au Sénégal mais ailleurs. On s'est battu depuis
longtemps au Sénégal, mais aujourd'hui la femme est en train
d'être reconnue et elle gagne la place qu'elle mérite. Je pense
que de plus en plus maintenant, les femmes peuvent occuper les postes
importants. Elles peuvent se faire entendre à travers la
littérature. Il n'y a plus de complexes d'être femme. C'est une
fierté. C'est vraiment un nouvel élan que nous sommes en train de
vivre au Sénégal et peut-être même ailleurs.
Parlez-nous un peu de votre vie et de votre métier. Depuis combien de
temps enseignez-vous à Thiès?
J'enseigne depuis 1992 dans la région de Thiès parce
qu'après le Baccalauréat j'ai fait le concours d'entrée
de l'Ecole normale de jeunes filles Germaine le Goff et j'ai fait quatre
années de formation. Je suis sortie en 1992 et à ma sortie j'ai
fait une spécialisation en Education à l'environnement en
France. A mon retour, j'ai enseigné à l'école
élémentaire en tant qu'institutrice et maintenant, depuis
l'année dernière, je suis au collège Mour II comme professeur de
lettres, d'histoire et de géographie. J'ai des
classes de sixième et de cinquième.
J'imagine que Thiès compte plusieurs écoles ?
Il y a un seul lycée mais plusieurs collèges. Bien sûr, un
seul lycée ne suffit pas pour tous les élèves, mais il est
obligé de les accueillir. Et chaque année le lycée est
fermé au moins pour deux mois à cause des grèves. Chaque
année ! C'est un lycée avec cette réputation : un lycée gréviste. Nous avons d'autres lycées
dans la région parce qu'il y a trois départements : Mbour,
Tivaouane et Thiès. Il y a un autre lycée à Tivaouane,
mais la ville de Thiès est une grande ville - c'est la capitale de la
région et la plus grande ville après Dakar - et nous n'avons qu'un
seul lycée!
Que peut-on dire de l'encadrement des jeunes, aujourd'hui? La plupart des jeunes sont-ils au chômage? Doivent-ils
aller à Dakar ou plus loin encore pour trouver du travail? Quel genre de
travail obtient-on quand on va au lycée à Thiès et quand
on n'y va pas?
La situation de Thiès n'est pas différente de celle des
autres villes du Sénégal. Dans la ville de Thiès il y a
déjà des difficultés pour les études secondaires.
Toute la ville de Thiès n'a qu'un seul lycée, le lycée
Malick Sy, où il y a trop de monde, donc, il y a souvent des
problèmes de grèves, de soulèvement. Donc,
déjà sur le plan de l'encadrement, il y a des difficultés.
Sur le plan de l'enseignement aussi parce qu'il y a un manque de professeurs.
Après le lycée on est obligé d'aller à Dakar ou
à St-Louis où il y a des universités. Donc, la ville de
Thiès se dépeuple de ces gens de 18 ans qui vont partir
ailleurs pour poursuivre leurs études universitaires. Après ces
études, il y a la recherche de travail... mais au Sénégal,
comme dans plusieurs pays d'Afrique, il y a le chômage. Il y a plusieurs
infrastructures à Dakar où tout est concentré, mais dans
nos régions, malheureusement, il n'y a pas beaucoup
d'opportunités pour trouver du travail. Par exemple, à
Thiès il y a deux usines seulement : la société de chemins
de fer et puis la société de textile et c'est tout ! Donc, plus
de 60% des jeunes partent de Thiès pour aller à Dakar ou ailleurs
pour travailler. Il y a ce problème de migration et encore ils ne
peuvent souvent rien trouver. Nous assistons de plus en plus à
l'immigration des jeunes Sénégalais hors du pays en Europe, aux
Etats-Unis. J'étais en Guinée et les jeunes du
Sénégal ont de la chance parce qu'au niveau des études, il y
a quand même une très bonne formation ici, mais dans l'insertion
des jeunes, il y a des problèmes. En Guinée, par exemple, dans
les sous-régions, il y a beaucoup de travail mais eux, ils ont des
problèmes de formation justement.
Est-ce que tous les enfants, filles et garçons, vont à
l'école ?
Oui, parce qu'avec l'ancien gouvernement, il y a dix ans, on avait eu le
programme mettant l'accent sur la scolarisation des jeunes filles. Alors c'était
vraiment une éducation à une prise de conscience des
familles : il faut envoyer les filles à l'école. Mais dans un
passé très récent, on a remarqué que dans les
familles on dit : "Moussa va à l'école ; Fatou lave les
assiettes à la maison." C'est comme ça que les enfants
étaient éduqués : le garçon, il pouvait aller
à l'école, mais la fille, elle était destinée aux
travaux ménagers, on la forme pour être mère de famille,
épouse, etc. Quelques années après l'indépendance,
on s'est rendu compte qu'il fallait donner aux filles les mêmes chances
qu'aux garçons et leur permettre d'aller à l'école.
Heureusement, il y a maintenant des masses de filles qui nous arrivent à
l'école.
Au cours de mes huit années d'expérience dans l'école
élémentaire j'ai remarqué ceci : au début les
filles venaient et elles étaient nombreuses et même parfois il y
avait plus de filles que de garçons ! Malheureusement il y a encore des
mariages précoces au Sénégal et à l'âge de
douze ou treize ans, alors que des filles préparent leurs examens de
sortie de l'école élémentaire, il y a d'autres filles qui
sortent de l'école : on les marie. Ou bien, les familles les sortent
parce qu'elles vont les marier plus tard. Les familles ont peur de les laisser
faire le concours d'entrée au collège parce que si elles
réussissent, elles veulent terminer leurs études. Donc il y a des
calculs mesquins comme ça ! Beaucoup de filles encore échappent
à l'instruction.
De quoi rêve un écolier/lycéen (ou une
écolière/lycéenne) de Thiès en 2001?
Ah, il y a beaucoup de choses ! C'est bizarre quand même parce que les
lycéens de 2000-2001 ne sont pas de la même
génération que moi. J'étais au lycée les
années 80. Moi, j'ai rêvé d'autre chose. Aujourd'hui, la
majeure partie des lycéens veut obtenir le bac pour aller à
l'étranger. Certains y vont pour faire des études et d'autres
pour échapper à la misère ou pour travailler.
C'est vrai qu'à partir du bac, les horizons sont bouchés pour ces
jeunes. Au Sénégal, il y a deux universités seulement :
à Dakar et à St-Louis. Les conditions de vie pour les
étudiants sont extrêmement difficiles. Déjà pour
s'inscrire, c'est tout un problème. A l'inscription, on n'a pas toujours
la bourse. Les étudiants ne sont pas tous de Dakar ou de
St-Louis. Ceux du dehors doivent se loger, se nourrir. Tous doivent payer leurs études,
leurs livres ... et tout cela coûte très
cher. Donc, quand ils ont le bac, ils sortent du Sénégal. Et
c'est une fuite des cerveaux ; une fuite de plus en plus nette. Quand ils sont
en Europe ou aux Etats-Unis ils ont le temps de trouver d'autres
opportunités et on se rend compte que c'est irréel de dire
qu'après leurs études à l'étranger, ils reviendront
travailler au Sénégal parce que de plus en plus il n'y a pas
d'horizons.
A partir du baccalauréat on pourrait insérer au
Sénégal d'autres systèmes, d'autres écoles de
formations, améliorer les conditions à l'université. Et
puis penser à l'insertion après l'université.
Peut-être que comme ça, le Sénégal pourrait montrer
aux jeunes qu'il y a de l'espoir pour qu'ils puissent rester ici et pour qu'ils
puissent avoir confiance en leur pays.
Notes
[1] Sene, Fama Diagne. Le Chant des
ténèbres. Dakar. N.E.A.S., 1997.
[2] Kane, Cheikh Hamidou. L'Aventure
ambiguë. Paris. Julliard, 1961.
[3] Ndao, Cheikh Aliou. Propos recueillis au
cours de la conférence "Femmes en création."
Dakar, Sénégal. 13-22 avril, 2001.
Julie Van Dam
A L'ECOUTE DE FAMA DIAGNE SENE
Un entretien
avec la romancière sénégalaise Fama Diagne Sène.
Thiès, Sénégal

**
L'entretien qui suit explore l'univers de la folie, un thème qui est au centre du premier roman de Fama Diagne Sène,
Le Chant des ténèbres (Nouvelles Editions Africaines du Sénégal, Dakar, 1997 - Prix du Président de la République Sénégalaise, 1997). Cet entretien éclaire de manière indirecte la "Fuite des cerveaux" qui est au centre de ce numéro de "Mots Pluriels". Il en évoque les causes en soulignant les difficultés mais aussi les espoirs d'une génération en butte à des conditions de vie souvent très précaires.
Email : Fama Diagne Sène [[email protected]]
Thiès, Sénégal
 Julie Christine Van Dam
est une jeune américaine fascinée par la
littérature francophone. En 1997, elle obtient une licence en langue
française de l'Université de San Francisco. Elle rallie le
CIEF et en 2000, participe au congrès annuel du CIEF en Tunisie. Un fort
intérêt pour la production littéraire de la nouvelle
génération de femmes africaines l'a conduite à s'inscrire
pour l'année académique 2000-2001 à l'Université de
Cheikh Anta Diop de Dakar pour passer une Maîtrise en lettres modernes.
Durant ce séjour enrichissant, elle a poursuivi parallèlement ses
recherches et effectué cette interview de Fama Diagne Sène, une
romancière sénégalaise dont le roman Le Chant des
ténèbres constitue son thème de mémoire de
maîtrise : La Voix audacieuse de la femme folle. Julie Christine Van Dam
est une jeune américaine fascinée par la
littérature francophone. En 1997, elle obtient une licence en langue
française de l'Université de San Francisco. Elle rallie le
CIEF et en 2000, participe au congrès annuel du CIEF en Tunisie. Un fort
intérêt pour la production littéraire de la nouvelle
génération de femmes africaines l'a conduite à s'inscrire
pour l'année académique 2000-2001 à l'Université de
Cheikh Anta Diop de Dakar pour passer une Maîtrise en lettres modernes.
Durant ce séjour enrichissant, elle a poursuivi parallèlement ses
recherches et effectué cette interview de Fama Diagne Sène, une
romancière sénégalaise dont le roman Le Chant des
ténèbres constitue son thème de mémoire de
maîtrise : La Voix audacieuse de la femme folle. Dès son retour aux Etats-Unis, Julie Van Dam compte poursuivre ses études littéraires francophones post-coloniales au niveau du Doctorat à UCLA. |
[La page de Fama Diague Sène sur le Internet] | [Sommaire du numéro 20 de MOTS PLURIELS]