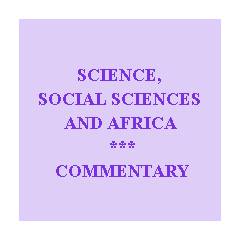no 24. juin 2003.
https://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP2403edito1.html
© Jean-Marie Volet
Jean-Marie Volet
University of Western Australia
|
|

Personne ne doute de l'influence de la science
sur les choix de société, d'où l'importance de la relation entre les
sciences 'exactes' et les sciences sociales, en Afrique comme ailleurs. On trouvera dans le
présent numéro les textes d'une quinzaine de collègues d'horizons
différents ayant réagi à l'article que le Professeur ![]() , éminent chimiste et romancier, a bien voulu soumettre à
Mots Pluriels pour lancer le débat. Nous remercions chaleureusement
Monsieur Dongala et tous les collègues qui nous ont fait l'honneur de
participer à cet échange.
, éminent chimiste et romancier, a bien voulu soumettre à
Mots Pluriels pour lancer le débat. Nous remercions chaleureusement
Monsieur Dongala et tous les collègues qui nous ont fait l'honneur de
participer à cet échange.
Depuis les indépendances, les élites intellectuelles africaines s'interrogent à intervalles réguliers sur ce qui leur arrive. Elles essaient de déterminer les raisons d'une dérive qui n'en finit pas de se prolonger, et elles tentent d'expliquer la crise de la science et des instruments de la connaissance dans le contexte de l'Afrique. De Mudimbé à Tévoédjrè, en passant par Boulaga, Obenga, Essome, Ewane, Bilolo, Diakité Mubabinge, Towa, Hountondji, Njoh-Mouelle, Traoré, Diouf, Mfounou et bien d'autres, une multitude d'intellectuels africains ont essayé de sortir les sciences humaines et sociales africaines du carcan occidental où elles se sont engluées en proposant un autre discours sur l'Afrique. L'impression que les sciences humaines et sociales africaines se trouvent dans un état léthargique absolu traduit donc moins l'absence d'une conscience discursive structurant une nouvelle vision de l'Africain par lui-même, que l'étendue de la désillusion de l'observateur face aux rêves chimériques proposés par l'Occident moderne, son matérialisme, sa science et son manque d'humanité. Nous avons beau continuer à dire que nous voulons être et vivre comme vivent les peuples d'Occident dans leurs valeurs aujourd'hui mondialisées, dit Kä Mana, nous avons beau déserter nos pays pour aller vivre dans les leurs, nous sentons au fond de nous-mêmes que l'Occident n'a plus grand chose à nous apporter, qu'il est temps de rompre et de nous lancer dans un projet d'humanité qui nous soit propre, de tourner la page et d'embrasser toutes les possibilités d'un monde post-occidental et post-capitaliste.
Les Sciences ne sont ni neutres ni amorales et aucun discours scientifique n'échappe à l'idéologie qui l'a vu naître. De plus, les pratiques et les théories scientifiques ne sont sans doute, jamais transférables directement. Elles doivent toujours se plier, dans une certaine mesure, aux besoins locaux et aux paramètres culturels où l'on tente de les implanter ; d'où l'importance de l'idée de métissage qui permet une réappropriation du savoir. Une réappropriation qui met l'accent sur la subjectivité transculturelle et qui se démarque de la nouvelle hégémonie imaginée et imposée par les USA et ses agents auxiliaires. De fait, le message de métissage proposé en son temps par Senghor montre que l'idée de globalisation n'est pas nouvelle et qu'elle exprime un long et complexe processus d'interactions entre nations. D'où la nécessité d'évaluer de manière critique les concepts de "globalisation" de "démocratie", de "modernité" et de "modernisation" - pour ne reprendre que quelques uns des termes mis en évidence par Dongala dans son essai - qui vont au coeur des préoccupations et des analyses politiques, économiques, culturelles et sociales de l'Afrique contemporaine. Là se situe la tâche la plus importante des sciences sociales. Mais les grandes idées ont besoin d'un terrain propice pour se développer et un débat sur la science et le développement de l'Afrique n'a de sens que s'il s'appuie sur une vision de la modernisation et de la modernité qui sous entend l'accès à l'eau potable, à l'électricité, à l'éducation et à la santé par tous ceux qui vivent dans les différents ensembles politiques ou géographiques que l'on appelle aujourd'hui l'Afrique. Il est également important de reconnaître que la modernité est un concept dissonant qui ne signifie pas la même chose partout et pour tout le monde. La modernité ne signifie pas une adhérence systématique et aveugle à la Macdonaldisation de la planète. Il ne s'agit donc pas de savoir dans quelle mesure la notion d'universalité est - ou n'est pas - universelle, mais plutôt de s'inspirer des exemples concrets et probants d'un syncrétisme culturel, politique, religieux et économique. Les grandes idées et les grands thèmes circulent sans cesse entre les cultures, les endroits, et les époques différentes de l'Histoire, alors que les recherches chimériques du principe d'authenticité ne font que nous distraire de l'essentiel.
Comment imaginer des raisons d'espérer quand le futur se réduit à la nécessité de faire face aux urgences du jour et que demain n'existe pas ? Comment réaliser les choses les plus simples dans un univers chaotique ? Le pouvoir de changement et de transformation auquel l'Afrique aspire échappe à la science, aux diplômés et aux élites qui modernisent sans modernité. Il se trouve au niveau des actions individuelles, de tous ceux qui font ce qu'ils peuvent faire, changent ce qu'ils peuvent changer et transforment ce qu'ils peuvent transformer en ayant pour idéal la dignité humaine. Le pouvoir de faire changer les choses appartient aux hommes et aux femmes éduqués plutôt qu'instruits, c'est-à-dire à ceux et celles qui, se sentant responsables, ont pris conscience de l'importance de leur propre rôle au service de la communauté. Cette prise de conscience reste toutefois extrêmement aléatoire car mille forces destructives s'acharnent contre celui ou celle qui essaie de se démarquer de la pensée unique, mille frontières intérieures imprévues et mille barrières se dressent sur le chemin de qui cherche à échapper aux machinations du maître du jour. Vivre devient un exploit, affirmer une vérité autre, une quasi impossibilité. Le maigre impact de l'Afrique dans le domaine scientifique et son acceptation d'un modèle scientifique occidental unique est en partie le fruit de cet état de crise perpétuelle. Toutefois, il n'est pas certain qu'une plus grande contribution de l'Afrique au monde scientifique occidental eût amélioré son lot, car cet apport n'aurait pas nécessairement permis au Continent d'exprimer ses propres "ressources intérieures », celles-là même, dit Boni, qui nous donnent aujourd'hui encore des raisons d'espérer. Le moment est en tous cas venu d'admettre que la science, comme la culture, est diverse, de proposer de nouvelles conceptions qui permettent à la pensée d'échapper au cartésianisme où l'Occident l'a enfermée. Il est temps de renouer avec une vue du monde différente qui échappe à la politique politicienne, au culte de l'accumulation et aux acrobaties criminelles qui entendent justifier l'action des "voyous" qui mènent le monde avec notre complicité.
La géographie propose l'étude de l'espace des sociétés en prenant "le terrain" comme élément de vérification. Comme toutes les sciences - qu'elles soient "exactes" ou "humaines" - la géographie s'est fixée ses méthodes et ses buts, mais elle offre aussi une grille de lecture des problèmes africains et des rapports science/sciences humaines qui soulignent la complémentarité et la complexité des interactions aussi bien entre les disciplines académiques qu'entre la nature et la culture, entre l'idéal et le biologique. Toute identité est plurielle, évolutive et relationnelle. Dès lors, tenter d'enfermer les disciplines - et les sociétés que ces dernières entendent expliquer - dans des mondes figés et antagonistes revient à falsifier plusieurs décennies d'études qui montrent que les frontières sont tout autant des lieux de rencontre, d'échange et de métissage que de rupture. Si tout le monde s'entend pour dire que la science n'est pas en elle-même capable de résoudre les problèmes de l'humanité, une démarche scientifique, elle, peut offrir un moyen de mieux comprendre le social et faire tomber bon nombre d'idées reçues. Les frontières disciplinaires héritées du 19ème siècle entre sciences de la nature et sciences de la société se révèlent inopérantes aujourd'hui et la portée des mesures économétriques a souvent été surévaluée. Comment ces dernières pourraient-elles par exemple témoigner du bien-être collectif d'une société, de la valeur de la parole ou de l'esprit de solidarité africain? D'autres formes de raisonnements sont nécessaires. Ils se font jour, parfois plus inductifs, toujours plus complexes : les travaux récents de nombreux géographes en témoignent.
La science étant une manière d'appréhender les choses et non pas une chose tangible dotée de pouvoirs indépendants, la méthode scientifique ne représente qu'un outil permettant parfois à l'esprit curieux d'apporter une réponse aux questions qu'il se pose. Le problème de la science ne se trouve donc pas au niveau de ses méthodes mais de la manière dont les individus les utilisent et interprètent les résultats obtenus. L'économie offre un bon exemple : un étudiant de première année verra immédiatement que les directives du FMI imposée aux LDC sont contraires au bon sens si l'on s'appuie sur les résultats scientifiques disponibles, du moins si l'on part du principe que ces directives devraient aider les pays en voie de développement. Ce sont les économistes du FMI et leurs directives - et non pas la science - qui font que le "développement" de l'Afrique se traduit par une accélération du pillage du continent par de puissantes multinationales plutôt que par une amélioration des conditions de vie des Africains. La science est incapable de changer le cours des choses, seule la volonté des individus peut y parvenir, une volonté d'agir et d'imposer une vision d'un monde plus équitable pour tous. Une nouvelle donne peut paraître utopique, certes, mais la science peut-être mise au service de l'utopie comme elle peut l'être au service de l'oppression. Elle peut être mise au service du FMI comme au service d'une Afrique unie, démocratique et libre de se développer d'une manière conduisant au bien être du plus grand nombre. Et ce n'est pas la compréhension théorique ou pratique de l'action à entreprendre qui fait défaut, mais la volonté de passer à l'action.
Sciences et techniques sont en constante évolution. Les sciences exactes et les sciences sociales sont interdépendantes depuis des siècles et c'est leur interaction constante qui conduit à la formulation des "vérités" exprimant les connaissances et les projets d'une époque et d'une civilisation avant d'en relever les limites, la fausseté ou les effets pervers à l'époque suivante. Le rôle de la recherche scientifique en Afrique - mais aussi en Occident à l'orée du troisième millénaire - ne se dessine pas de manière très claire. Il n'est pas facile d'échapper à l'influence insidieuse de "la bibliothèque coloniale" où se sont engluées la France et l'Afrique et il est difficile de percevoir un "frémissement dans le renouvellement de la pensée" tant au Nord, qui déplorent l'émiettement et la crise des sciences sociales à la suite de la disparition des grands penseurs du 20ème siècle, qu'au Sud qui est en proie à un "afro-pessimisme" destructeur. Toutefois, s'il est difficile de discerner ce qui se passe en période de gestation, certains signes semblent montrer qu'on assiste aujourd'hui à une phase extrêmement active d'une culture en train de se faire, fécondée de syncrétistes et de métissages, y compris dans ses drames. Pour Coquery-Vidrovitch, lorsqu'on tente de faire l'analyse des situations, il est important de différencier les appréciations à court terme des éventualités à plus long terme. La situation actuelle de l'Afrique est le résultat d'une histoire longue et très lourde où se mêlent des facteurs internes et des facteurs externes prégnants. L'avenir exige une ouverture au monde qui permettra de relativiser les référentiels occidentaux, de redéfinir les idéaux démocratiques, de permettre aux femmes de redéfinir leur place dans la société et de faire évoluer la relation des différents acteurs associés à la recherche africaine en francophonie, afin qu'ils placent en tête de leurs préoccupations le respect des valeurs de l'autre.
L'enjeu essentiel de l'appropriation des sciences en Afrique se situe en marge de la spécificité des sciences exactes et des sciences sociales dans la mesure où toutes deux devraient livrer le même combat et chercher à doter le continent d'hommes et de femmes de science qui mettent la main à la pâte et aident les sociétés africaines à transformer leur environnement de manière concrète et satisfaisante. L'appropriation du savoir occidental par l'intermédiaire de l'école coloniale et plus récemment par la course au diplôme universitaire à l'étranger s'est révélée un leurre. Loin d'ouvrir les portes du savoir aux Africains, cette appropriation a au contraire limité leur pouvoir en leur imposant une image débilitante d'eux-mêmes; elle a universalisé le mythe de la supériorité du colon blanc qui est inscrite au coeur même de toute l'entreprise sociale, éducative, économique et scientifique de l'Occident. Aujourd'hui, comme hier, le colonisateur euroaméricain se considère comme le centre du monde et il a besoin de cannibaliser la périphérie pour survivre. Dès lors, il est urgent que les scientifiques africains prennent du recul par rapport à l'enseignement qu'ils ont reçu, qu'ils redressent la tête et qu'il réaffirment leur propre valeur ; il est temps, dit Kom, qu'ils remettent en question la représentation qu'à travers son regard, son école et son administration, l'Euramérique leur a donné d'eux-mêmes. Il est temps pour l'Afrique d'élaborer soigneusement un projet volontariste de subversion si elle veut vaincre l'hégémonie de l'Euramérique et avoir voix au chapitre.
En Inde tout comme en Afrique, le système d'éducation colonial introduit par les Britanniques était basé sur la présomption que l'Occident était la source de tous les savoirs et que l'Empire était responsable de déterminer les normes propres à chaque discipline. Même dans le domaine de la littérature, qui possédait pourtant un riche héritage aux Indes, les modèles qui s'imposèrent graduellement furent les modèles européens. La valorisation du "roman" au cours de la deuxième moitié du 19ème siècle n'est qu'un exemple. Les long textes narratifs existaient sous diverses formes dans la plupart des langues pratiquées aux Indes, mais c'est la nouvelle forme, appelée "roman", dont le mode réaliste était sensé définir le genre en Europe, qui s'imposa. Bien d'autres genres et concepts théoriques on été importés depuis lors : depuis plusieurs décades, pour prendre un autre exemple, les étudiants indiens sont appelé à étudier le structuralisme, le post-structuralisme, la psychanalyse, la déconstruction, la phénoménologie, la sémiotique et bien d'autres outils d'analyse proposant des clés de lecture de tous les textes. Toutefois, l'adéquation de ces concepts à travers les cultures est rarement discutée, et les retours occasionnels à une théorie esthétique précoloniale, souvent hors contexte, n'offre pas une alternative satisfaisante. Choisir de manière systématique ce qui est "local" en préférence à ce qui est "global" n'est d'ailleurs pas sans danger. L'Occident est solidement implanté parmi nous, dit Mukherjee, et l'on peut se demander si nous avons vraiment le loisir de choisir notre propre voie dans un monde où toutes les décisions importantes sont prises par l'économie de marchés? Comment faire pour que les travaux proposés par les sciences sociales - souvent très pertinents et originaux - puissent déboucher sur une action sociale significative. L'Inde peut se targuer de posséder de nombreux chercheurs exceptionnels - en sociologie, en économie, en science politique, etc. - qui ont accomplit un travail considérable sur le terrain, mais cette exubérante production intellectuelle d'une section de la société n'a pas eu, pour l'instant, un très grand impact sur la vie de la grande majorité de la population.
La science peut être considérée comme un système social au sein duquel certains individus essaient d'observer des phénomènes et de résoudre des problèmes. Toutefois, la nature de ces phénomènes et des problèmes à résoudre n'existe pas en elle-même. Phénomènes et problèmes sont déterminés par la manière dont l'observateur les perçoit et les construit, par les contraintes sociales, culturelles ou biologiques qui sont indissociables de toute activité humaine. Les études littéraires n'échappent pas à cette règle et, affirme Schmidt, seule l'adoption de nouvelles méthodologies permettrait une comparaison systématique des recherches empiriques entreprises par différents acteurs associés à la recherche littéraire. Une évaluation "intersubjective" de leurs travaux est nécessaire, car dans ce domaine, comme dans les autres, tout relève de la construction et rien ne va de soi. La question ne se situe pas au niveau d'une opposition des sciences exactes et des sciences sociales mais dans la supériorité d'une méthode scientifique par rapport à une approche non scientifique qui ne prend pas de recul par rapport aux méthodes utilisées tant pour définir un problème que pour le résoudre. La méthode scientifique exige des stratégies et des procédures opérationnelles explicites, systématiques et susceptibles d'être reproduites afin de permettent à une communauté de chercheurs de collaborer et d'évaluer la validité des solutions proposées. La science exige du chercheur de se faire l'observateur de son propre discours lorsqu'il entend observer et décrire un phénomène. La même distanciation vis-à-vis de sa discipline devrait être au coeur de la critique littéraire qui ne parle pas d'un "objet naturel" appelé "littérature" mais de problèmes propres à un environnement socioculturel dans lequel certains individus sont confrontés à un phénomène appelé "littérature".
L'Afrique reste un terre occupée et son problème n'est ni celui de son rapport à la science ni celui de son aptitude au développement. Son problème, c'est d'être considérée, par ceux qui la dévorent, comme une excroissance - taillable et corvéable à merci - du monde occidental. L'heure n'est plus aux redressements ou aux ajustements structuraux mais à un retour aux sources, à soi-même, à une conscience historique et identitaire qui permettrait aux individus et aux collectivités de retrouver leur âme. L'avenir serait dans une Afrique forte et unie, mais, dit Obiang, face à un continent plus que jamais divisé, peut-être est-il temps d'admettre que l'Afrique est arrivée au terme de sa chute, moribonde, déjà morte, peut-être. Tout le monde "s'est fait la malle ou rêve de le faire" dit-il. Plutôt que de nous laisser aller à ressasser notre désespoir, peut-être le temps est-il venu d'admettre que le destin de l'Afrique se jouant en Occident, il convient que nous redevenions les rebelles du conte, ceux par qui la vie affirme sa volonté de changement. A nous de peser de tout notre poids sur l'Occident en y exportant nos valeurs, nos savoirs et nos pensées afin de faire obstacle à la décadence et à la barbarie et de devenir le symbole d'une révolte contre la déshumanisation de l'Europe marchande capitaliste.
Deux types de forces contrôlent le discours, des forces extérieures et des forces internes. Dans le champ africain, l'irruption de l'Etat-nation au 19ème siècle a été accompagnée d'un bouleversement des structures et des dispositifs communicationnels qui s'est poursuivi tout au long du 20ème siècle. Dès lors, pour comprendre les processus d'ajustement qui secouent la notion de savoir en Afrique, les correspondances homologiques entre plusieurs modes de classement de la connaissance, la nature des liens sociaux - et par là le pouvoir -, il convient de s'attacher aux structures et aux manières de définir les catégories de l'intelligible plutôt que de s'acharner sur l'histoire des contenus. La compréhension des phénomènes est moins liée à une comparaison des caractéristiques intrinsèques d'une discipline qu'aux modalités de formation d'objets discursifs différents au Nord et au Sud. L'ordre des discours africains qui avaient privilégié la norme ou la règle a été confronté à un appareil de savoir occidental organisé en fonction de la loi et du droit. Et c'est la rencontre de deux taxinomies divergentes qui provoque la crise langagière associée aujourd'hui au rapport des sciences exactes et des sciences humaines dans le contexte africain.
L'idée que "la méthode scientifique trouve son efficacité en disjoignant sa pratique de toute conscience éthique" et qu'elle "n'intègre pas la subjectivité du sujet pensant" ne prouve pas pour autant que le chercheur appliquant une telle méthode soit plus indépendant que celui s'appuyant sur d'autres paradigmes de recherche. Le chercheur, quel que soit son domaine, reste un agent social qui doit forcément opérer des choix existentiels et stratégiques qui déterminent les questions qui peuvent être posées et celles qui sont exclues, "le pensable et l'impensable". Dès lors les chercheurs des sciences "dures" et ceux des sciences humaines sont mis à la même enseigne et leur responsabilité est identique : la défense de l'humain et des valeurs qui lui sont associées. La construction sociale de la réalité s'inscrit dans une succession de ruptures et de permanence. Elle s'appuie sur une production endogène de la modernité africaine où s'exprime une logique sociale endogène caractérisée par le primat du groupe et de la parenté et une logique exogène caractérisée par le primat de l'individu. Le travail réflexif du chercheur africain consiste dès lors moins à offrir de nouveaux paradigmes qu'à utiliser les concepts opératoires vieux et nouveaux qui sont à sa disposition. Son rôle est d'évaluer la production endogène de la modernité politique en Afrique et d'établir les bases sur lesquelles les penseurs du politique et de la démocratie pourraient évaluer le vécu des individus, redéfinir le principe d'un "vouloir-vivre ensemble" et reconfigurer un présent tumultueux où l'espace public politique est le fruit de la combinaison des espaces individuels, communautaires et familiaux où se déploient les stratégies individuelles mobilisant les ressources matérielles et symboliques disponibles.
En Afrique où de nombreux problèmes de base sont encore non résolus, le rôle des sciences dites pures, aussi bien que la mission des sciences humaines, est d'ordre pratique : les chercheurs, quelle que soit leur discipline, cherchent les moyens d'améliorer les conditions de vie de la populations en matière d'eau potable, d'hygiène, d'éducation, etc. Dès lors, l'opposition entre Sciences et Lettres est moins due à la valeur des activités des uns et des autres qu'à la perception de leur pouvoir face à un avenir incertain. Le présent est dominé par l'idée que "l'avenir appartient aux sciences" alors que les Lettres sont accusées d'être incapables d'apporter une solution pratique aux problèmes du moment. Cette confiance aveugle octroyée aux sciences exactes par la plupart des gouvernements africains, au détriment des Lettres, a eu plusieurs effets négatifs pour tout le monde et pour les femmes en particulier. Le premier de ces effets, dit Bassolé, est d'avoir marginalisé les sciences humaines qui accueillaient plus de femmes que les sciences exactes dans les facultés et d'avoir dévalué le prestige des filières préférées par les femmes. Ce déséquilibre en faveur des sciences a aussi eu pour effet de pousser les jeunes à entreprendre des études scientifiques pour lesquelles ils n'étaient pas faits et pour lesquels il n'y avait pas d'emplois, d'où l'explosion du chômage et des problèmes sociaux. Face à ce fiasco, le succès de quelques femmes a été monté en épingle par les Africains eux-mêmes pour se donner bonne conscience et nier que dans l'Afrique "moderne", les traditions et la pratique légitiment aujourd'hui encore le statut inégalitaire des femmes. Les Africaines elles-mêmes portent d'ailleurs une part de responsabilité dans la mesure où celles qui ont poursuivit des études et qui s'en sont sorti oublient trop souvent les besoins et les aspirations de leurs soeurs du village et profitent de "la modernisation" pour s'enrichir. Faire appel à la science pour moderniser l'économie ne sert à rien si une telle modernisation n'est pas guidée par l'idée de solidarité et qu'elle ne contribue pas à une éradication des injustices et des inégalités dont sont victimes bien des hommes, certes, mais plus encore les femmes.
La colonisation des Indes par l'Occident a conduit à une dépréciation progressive des savoirs traditionnels (e.g. médecines Ayurveda, Unani, Siddha) et à la marginalisation des systèmes philosophiques locaux basés sur une conception holistique du monde, la non-violence et le respect de la vie sous toutes ses formes - végétale, animale et humaine. L'idée que le rôle de la science consiste avant tout à forger l'intellect d'un individu à la recherche de la sagesse fait place à la conviction que toute connaissance débouche naturellement sur des applications pratiques et sur la nécessité de maîtriser la Nature. L'arrivée d'une éducation de type britannique aux Indes il y a deux siècles marque le début de cette nouvelle approche de la connaissance. De nombreux intellectuels - au nombre desquels ont peut compter Gandhi, Jinnah, Sennannayake, Nehru, etc. - sont le produit de cette éducation. Mais si ces grands leaders étaient ouverts à l'idée de technologie et d'utilitarisme scientifique, ils ont aussi su conserver une excellente appréciation des traditions et ne semblent avoir souffert d'aucune 'angst' existentielle. Il n'en demeure pas moins que les savoirs locaux ont été de plus en plus marginalisé au nom d'une sagesse scientifique réductionniste promettant le développement de la Nation, l'augmentation de la production alimentaire, la réduction de la mortalité et l'allongement des espérances de vie. De plus, la tentation des jeunes d'être "moderne" ou "dans le vent" et l'anxiété de la bureaucratie qui craignait d'être accusée de ne pas être à la hauteur, conduisit le pays à ignorer ou à refuser de prendre en compte ce qui pouvait être utile dans les valeurs traditionnelles. La modernisation a souvent été introduite aux Indes sans l'idée de modernité à laquelle Dongala fait allusion et une approche synthétique de l'ancien et du nouveau reste à faire. L'Inde se trouve à l'heure actuelle au coeur d'une vaste expérimentation sociologique. Sciences et technologie sont utilisées pour améliorer la vie de milliards de personnes et ces dernières embrassent l'idée de la modernité avec enthousiasme. Seul l'avenir dira si, au terme de cette grande expérience qui agite les Indes, le rêve d'un avenir meilleur pour tous est devenu une réalité.
L'heure n'est pas à un retour aux anciens thèmes mille fois ressassés depuis les indépendances, mais à un projet intellectuel original qui offrirait à la jeunesse une pensée originale lui permettant de se forger un solide esprit critique, de gérer ses connaissances, d'agir avec des finalités précises et de s'ancrer dans sa société et sa culture tout en s'ouvrant au monde. A l'heure de l'interdisciplinarité, discuter de la primauté d'une discipline par rapport à une autre conduit au ressassement et aux anciennes dichotomies. Le problème qui se pose à l'heure actuelle a son origine dans le hiatus qui sépare les besoins concrets de la population et la valeur imaginaire attribuée au diplôme universitaire par les élites africaines qui manquent de confiance en eux-mêmes et qui tournent à vide (colloques, articles savants, discussions byzantines, reconstruction du monde dans les salons). L'Afrique doit reprendre possession de ses langues et de ses cultures et retrouver l'indépendance de son discours. L'heure n'est plus aux débats oiseux qui nous empêchent d'aller à l'essentiel. C'est un luxe inutile. Le moment est venu de fournir à l'Afrique, dans "Mots Pluriels" comme ailleurs, des informations utiles et pratiques dont le continent a besoin.
 Jean-Marie
Volet est Chargé de Recherche (ARC QEII Fellow) à l'Université
de Western Australia, Perth. Il partage son temps entre sa recherche
sur la lecture, Mots
Pluriels et la mise à jour du site Lire les femmes écrivains
et la littérature africaine francophone. Quelques articles récents : Jean-Marie
Volet est Chargé de Recherche (ARC QEII Fellow) à l'Université
de Western Australia, Perth. Il partage son temps entre sa recherche
sur la lecture, Mots
Pluriels et la mise à jour du site Lire les femmes écrivains
et la littérature africaine francophone. Quelques articles récents :  "Peut-on échapper
à son sexe et à ses origines? Le lecteur africain, australien
et européen face au texte littéraire", Nottingham French Studies
40-1 (2001), pp.3-12; "Peut-on échapper
à son sexe et à ses origines? Le lecteur africain, australien
et européen face au texte littéraire", Nottingham French Studies
40-1 (2001), pp.3-12;  "Du Palais de Foumbam au Village Ki-Yi: l'idée de spectacle total chez Rabiatou Njoya et Werewere Liking", Oeuvres & Critiques XXVI-1 (2001), pp.29-37;
"Du Palais de Foumbam au Village Ki-Yi: l'idée de spectacle total chez Rabiatou Njoya et Werewere Liking", Oeuvres & Critiques XXVI-1 (2001), pp.29-37;  "Francophone Women Writing in 1998-1999 and Beyond: A
Literary Feast in a Violent World", Research in African Literatures 32-4 (2001), 187-200;
"Francophone Women Writing in 1998-1999 and Beyond: A
Literary Feast in a Violent World", Research in African Literatures 32-4 (2001), 187-200;  (avec H. Jaccomard et P. Winn), "La littérature du Sida: genèse d'un corpus", The French Review 75-3 (2002), pp.528-539. (avec H. Jaccomard et P. Winn), "La littérature du Sida: genèse d'un corpus", The French Review 75-3 (2002), pp.528-539.  Imaginer la réalité :
Huit études sur la lecture des écrivaines africaines (sous presse). Imaginer la réalité :
Huit études sur la lecture des écrivaines africaines (sous presse).
|
Back to [the top of the page] [the contents of this issue of MOTS PLURIELS]