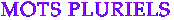
No. 17 April/avril 2001
https://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP1701edito.html
© Tim Unwin
[English version] [Version française]
***
'Je savais déjà, moi, à sept ans, que
j'étais exilé; les odeurs et les sons, le bruit de la pluie sur
les toits, les tremblements de la lumière, je les laissais glisser le
long de mon corps et tomber autour de moi; je savais qu'ils appartenaient aux
autres, et que je ne pourrais jamais en faire mes souvenirs'. (Oreste
dans Les Mouches de Jean-Paul Sartre)
Le thème de l'exil occupe une place centrale dans l'histoire de
l'écriture et l'on en trouve déjà la trace dans les textes
les plus anciens et les plus fondamentaux - pensons à Adam et Eve
chassés du Jardin d'Eden ou à Moïse errant dans le
désert avec son peuple. L'exil exprime avant tout le drame de
l'exclusion, la douleur de ne plus appartenir à un lieu donné.
Que ce lieu soit géographique, culturel ou spirituel importe peu. Ce qui
compte, c'est qu'il soit hors d'atteinte alors qu'il est encore perçu
comme indispensable à la survie par un individu ou une
collectivité. Cela conduit l'exilé à prendre conscience de
la profondeur du fossé qui sépare le présent du
passé et l'individu de ses origines, d'où une impression de
dérive et d'aliénation, souvent exacerbée par un sentiment
de culpabilité, de ressentiment ou de colère face à un
emprisonnement dans un milieu, une culture ou une langue
étrangère, et parfois même, dans les cas les plus
extrêmes, une expulsion ou une incarcération réelle. Mais
même dans les heures les plus sombres, l'exil n'est jamais loin du
rêve de retour à la Terre Promise. La douleur du
déracinement est indissociable de l'espoir d'une
réintégration.
Les littératures française et francophone ont déjà de riches
traditions dans ce domaine. De Du Bellay à Hugo et au-delà, les
échos de l'exil sont nombreux car maints auteurs des Lettres
françaises - souvent célèbres - ont connu cet état
: Troyat, Semprun, Sarraute, Wiesel, Bosquet, Gary et bien d'autres. Leurs
oeuvres témoignent des liens profonds qui rattachent leur
écriture aux perturbations associées à leur statut
d'exilé, même si l'expérience de chacun contribue à former
un faisceau d'expériences individuelles remarquables. La notion d'exil
débouche sur un univers large et varié de
relations vis-à-vis des autres et de soi-même qui va de ceux et
celles qui ont été bannis ou expulsés manu militari
de leur pays à ceux qui s'imposent l'épreuve d'un exil
volontaire avec, entre ces deux extrémités, les victimes
d'innombrables formes de dislocations culturelles ou spirituelles. Comment les
écrivains expriment-ils leur réaction face à l'exil ?
C'est l'une des questions centrales à laquelle les études
présentées ici entendent apporter l'amorce d'une réponse.
On mettra surtout l'accent sur les auteurs d'expression française mais y
figureront aussi, entre autres, des textes espagnols, roumains, dominicains...
car le concept d'exil est toujours associé à l'idée de
multiplicité et il empiète toujours sur deux cultures ou plus.
Les analyses proposées dans ce numéro témoignent de cette
diversité et montrent toute l'étendue du sujet, tant au niveau de
la géographie que des thèmes abordés ou encore de la
relation de l'exil à l'écriture.
Ecrire l'exil permet de franchir les profondeurs abyssales de la
séparation afin d'assurer une certaine présence au coeur même
des régions les plus inaccessibles; de plus, l'écriture
délimite aussi le lieu où se déroule le combat que se
livre l'exilé contre soi-même avant que de se battre contre les
autres. La première oeuvre de deux jeunes écrivains francophones,
Jean-Luc Raharimana de Madagascar et Abdourahman Waberi de Djibouti,
reflète une des manières dont l'écriture permet d'exprimer
Dans certains cas, cependant, l'exil représente un état que
l'auteur accepte - ou même choisit personnellement en prenant par rapport
à ses origines et à sa langue une certaine distance qui,
pense-t-il, est favorable à la création ou encore qui lui offre
la possibilité de s'ouvrir à un nouveau public. Un des cas les
plus célèbres d'exil culturel et linguistique est celui de Samuel
Beckett, examiné dans ce numéro par Helen Astbury. Le fait de
quitter sa patrie et d'écrire en français peut laisser croire que
Beckett avait tout simplement décidé de rejeter sa culture
d'origine. Rien n'est moins sûr, suggère Astbury. Contrairement
aux apparences, il semble plutôt que sa décision d'écrire
en français lui ait fourni l'occasion de prendre du recul par rapport
à l'Irlande et à se repositionner par rapport à ses
origines. L'Algérienne Assia Djebar offre un autre exemple,
exploré par Katarina
Melic, d'exil linguistique assumé
volontairement par l'auteur. L'étude de Melic prend comme point de
départ L'Amour, la fantasia publié par Djebar en 1985.
Ce roman explore les modalités et les limites de la
représentation identitaire du colonisé dans la langue du
colonisateur. Dans un premier temps, la décision d'écrire en
français offre à Djebar un sentiment de libération, un
moyen d'échapper à son milieu. Elle lui permet de laisser jaillir
une voix intérieure étouffée depuis longtemps, mais, peu
à peu, elle se rend compte que la langue de "l'Autre" a ses limites et
qu'elle ne lui permet pas d'exprimer ses désirs et ses émotions
les plus intimes, pas plus qu'elle ne lui permet de faire revivre son
héritage culturel basé sur la tradition orale. Située
à l'intersection de trois cultures et de trois langues - arabe,
berbère et française - Djebar cherche donc sa propre voix, son
propre style et de nouveaux moyens de moduler cette multiplicité qui lui
permettront d'exprimer tout à la fois sa propre histoire et l'histoire
collective de la femme algérienne.
Dans son analyse de Julia Alvarez, Odile Ferly souligne quant à elle le
rôle important joué par l'émigration pour les femmes
d'origine antillaise et le pouvoir libérateur de l'exil pour certaines
d'entre elles. Quitter leur pays, suggère-t-elle, offre à
certaines écrivaines la possibilité d'échapper aux
restrictions imposées aux femmes dans les petites sociétés
traditionnelles dominées par les hommes. Les exilées se sentent
du coup moins impuissantes car en trouvant un trait d'union entre deux cultures
elles occupent désormais un espace privilégié entre
les deux. Dans ce cadre, l'exilée volontaire qui embrasse une seconde
culture a la possibilité de choisir les aspects de son héritage
qu'elle désire préserver et de rejeter ceux qu'elle
considère comme encombrants. Néanmoins, l'heureux exil de
l'écrivain ou de l'artiste en quête de libération n'est
jamais dénué d'ironie ou contradictions. Pour Odile Gannier,
Tahiti a souvent été présenté comme une copie
conforme du Jardin d'Eden, un mythe, un paradis exotique situé aux
antipodes des sociétés industrielles occidentales. Mais tant les
oeuvres littéraires dues à des auteurs polynésiens que
celles d'écrivains d'origine européenne démentent cette
représentation hédoniste de Tahiti. Le ressassement de son statut
Le sentiment d'aliénation qui accompagne la condition d'étranger
et d'exilé débouche souvent sur une forme bien documentée de "double exil" où le
sujet se sent aliéné de sa culture d'origine et de sa culture
d'adoption. Dans cet ordre d'idées, l'étude consacrée
à l'écriture francophone africaine proposée par Aedin Ni
Loingsigh met en évidence le cheminement qui a conduit l'Afrique des
colonies à se sentir en exil non seulement en France, mais aussi sur son
propre continent. Elle montre comment "vivre à Paris" - haut lieu de
l'aliénation et de l'émancipation - a pris l'allure d'un mythe.
De manière plus générale, l'article souligne la place
centrale de l'exil dans l'écriture africaine. S'il est possible de
relever un certain nombre de caractéristiques "universelles", il faut
souligner que dans son ensemble, l'exil africain est lié à des
conditions propres à l'Histoire de l'Afrique coloniale et
post-coloniale; raison pour laquelle, dit Ni Loingsigh, un des thèmes
saillants associés à l'exil touche à l'identité, sa
relation à l'écriture, et le rôle de la langue d'emprunt.
Le poids d'un "double exil" reste souvent très difficile à porter
par la deuxième génération d'immigrants en quête
d'identité. Le cas des Beurs - c'est-à-dire des Français
d'origine maghrébine nés en France - en offre un exemple bien
documenté. Coupés de la culture de leurs parents, les Beurs se
sentent aussi exclus de la société dans laquelle ils vivent car
ils sont encore considérés comme des immigrants et des
étrangers. Les Beurs représentent donc une
génération exilée dans le pays d'accueil où ils
sont nés et maintenus en marge de leur héritage culturel. Deux
études complémentaires proposées ici explorent cette
question. La première de Dayna Oscherwitz analyse la
représentation de l'identité beure dans le roman de Paul Smail,
Vivre me tue (1997). Retraçant l'expérience typique d'un
"double exil", ce roman documente le sentiment de désespoir et
d'isolement vécu par les Français d'origine arabe vivant en
France pour qui il est impossible de s'intégrer à l'un ou l'autre
univers. Toutefois, comme le montre Kathryn Lay-Chenchabi, l'auteur de la
deuxième étude, les réponses apportées à une
situation d'exil peuvent diverger de manière sensible. Son article met
en relief l'expérience de trois écrivains: Azouz Begag, Ahmed
Kalouaz et Leila Houari (une 'beurette' d'origine belge). Si tous trois font
face aux mêmes préoccupations, la voie empruntée par chacun
d'entre eux afin de mieux comprendre d'où ils viennent et où ils
vont est différente. Houari et Kalouaz cherchent à s'affirmer en
se tournant vers leur culture d'origine, alors que Begag est surtout
préoccupé par la place qu'il occupe dans la société
française.
Le cas des auteurs israéliens d'expression roumaine proposé par
Hubert
Padiou offre lui aussi un exemple de ce phénomène.
Incapables de s'exprimer de manière tout à fait satisfaisante en
hébreu, plusieurs écrivains juifs d'origine roumaine ont choisi
de continuer à écrire en roumain après leur arrivée
en Israël - créant même une Association israélienne
des écrivains d'expression roumaine en 1973. L'intéressant survol
de leurs oeuvres proposé par Padiou montre que - comme on l'a
souligné pour la littérature beure - les questions identitaires
sont essentielles, mais dans ce cas, elles débouchent sur une
problématique nouvelle: où se trouve le pays d'accueil et le pays
d'origine par rapport à la situation d'exil? S'agit-il d'un double exil
ou d'un exil à rebours? Il est certain qu'il s'agit là d'une
littérature de transition, mais qui n'en propose pas moins un
aperçu fascinant de la manière dont l'exil peut être
résolu par l'écriture. Il ne fait aucun doute que
l'émergence d'une nouvelle génération, comme c'est le cas
pour les Beurs, sera accompagnée d'un changement des données
actuelles.
Depuis le milieu du vingtième siècle où elles ont pris une
ampleur considérable, les questions ayant trait à l'exil sont
indubitablement liées aux idées de race, d'ethnicité et de
diaspora. Reste que les problèmes de l'errance, des flux migratoires et
de l'exil n'en sont pas pour autant absents de la littérature du
dix-neuvième siècle, comme le montre John
Whittaker dans son
étude de Toussaint Louverture, une pièce de
théâtre évoquant la grande personnalité noire
haïtienne, disparue en 1803. Cette pièce de Lamartine,
écrite au moment où la lutte contre la Traite gagnait en
popularité, reflète les préoccupations de l'époque
et souligne que l'idée de dépossession est au coeur des conflits
raciaux. Arrachés à leur terre natale, les esclaves haïtiens
vivaient dans des conditions inhumaines déplorables et l'injustice de
leur sort reposait sur des préjugés raciaux qui leur refusaient
humanité, épanouissement personnel et espoir de retour.
Que reste-t-il de ce pays abandonné derrière soi? Comment
l'auteur exilé ou exprimant sa condition d'exilé s'y prend-il
pour permettre au rêve de la Terre Promise de survivre? Comment
représente-t-il un retour imaginaire ou réel vers ces horizons lointains?
La métaphore du jardin - et par association du jardin d'Eden - est un
trope qui revient fréquemment dans la littérature de l'exil. Mais
ce jardin n'est pas toujours un Paradis terrestre d'où l'individu a
été arraché; il représente aussi parfois un espace
bien plus modeste
Pour Martha, l'exil sera sans retour mais pour d'autres personnages ou
écrivains, le retour "chez soi" s'accomplit, souvent accompagné
d'une profonde désillusion qui renforce la condition d'exilé du
voyageur. Michèle Bacholle analyse la démarche de deux auteurs
ayant délibérément pris la décision de retourner
aux pays de leur enfance : Marie Cardinal qui est d'origine algérienne
et pied-noir, et Kim Lefèvre qui est d'origine vietnamienne. Bacholle
analyse les raisons qui poussent ces deux écrivaines d'origine
très différente à retourner au pays de leur enfance et
à documenter ce retour de manière littéraire, Cardinal
dans Au pays de mes racines (1980) et Lefèvre dans Retour
à la saison des pluies (1995). Ce retour se solde dans les deux cas
par une sorte de réconciliation, ou tout au moins de compromis. Dans
d'autres cas, au contraire, le retour aux sources se solde par un échec
et provoque un flot d'images et de souvenirs largement contradictoires. Marie-Paule Ha examine ce phénomène dans une étude
de l'écrivain francophone vietnamien Nguyen-Manh-Toung. Dans son roman
Sourires et larmes d'une jeunesse, Nguyen-Manh-Toung raconte l'histoire
d'un certain nombre de personnages vietnamiens expatriés. Certains
d'entre eux choisissent de rester en France alors que d'autres décident
de retourner en Indochine au terme d'un très long séjour à
Paris. Le roman exprime l'expérience traumatisante qui accompagne
souvent la tentative de renouer avec sa culture d'origine.
S'en retourner vers un passé mythique est toujours précaire et le
voyage est encore plus incertain si au départ l'exil avait
été imposé par la guerre ou le terrorisme politique.
Ricard Ripoll Villanueva propose le cas d'Agustín Gómez-Arcos
qui, comme bien d'autres auteurs espagnols, a été conduit
à écrire en français pour des raisons politiques (son
départ vers la France lui fut imposé par la guerre civile
espagnole). Le roman Ana Non raconte l'histoire d'une femme andalouse
qui, à l'automne de sa vie, traverse l'Espagne en direction du Nord afin
de revoir son fils retenu en prison. L'histoire du personnage devient dans un
sens l'histoire de l'écrivain lui-même, exilé pour des
raisons politiques, et la narration souligne toute l'angoisse associée
à une incursion dans le passé lorsque l'individu a
été amené à assumer une nouvelle culture, une
nouvelle langue et une nouvelle identité.
Il est clair que pour bon nombre d'écrivains et d'artistes, il est
possible de trouver un équilibre précaire et de puiser dans
l'exil une puissante force créatrice. Le sentiment de perte et
d'éloignement et le fait même d'écrire de manière
compensatoire réunit paradoxalement certaines des conditions
nécessaires à un acte d'écriture littéraire qui ne
s'appuie sur la réalité que pour la transcender. Le fait
d'écrire alimente ici les exigences fondamentales de l'expression
littéraire et face à cette circularité, il n'est
guère surprenant que les "retours d'exil" soient si souvent
décevants. Certains affirmeront même qu'à un certain
niveau, l'exil est indissociable du processus de création artistique.
Pour Camus, par exemple, "exil" et "royaume" sont deux notions symbiotiques et
le lien entre le concept d'exil et celui de créativité a
été, on s'en souviendra, explorée de manière
magistrale dans sa nouvelle "Jonas ou la vie d'artiste". Une étude
considérant les liens qui rattachent le travail de l'artiste et l'objet
d'art qu'il produit est proposée ici par Caroline Sheaffer-Jones.
Analysant le chemin qui conduit le peintre de Camus à s'exiler
progressivement de la vie et de la société qui l'entourent,
Schaeffer-Jones montre toute l'ambivalence de ce retrait de l'artiste en
lui-même. Comme la fin de l'histoire le montre, il est tout à la
fois "solitaire" et "solidaire", c'est-à-dire seul mais
intégré malgré tout au monde qui l'entoure. Pourtant, le
paradoxe veut qu'en étant à fois l'un et l'autre, on n'est aussi
ni l'un ni l'autre, comme tous les artistes, peut-être.
La collection d'essais proposés dans ce numéro de Mots
Pluriels montre que le thème de l'exil est à la fois riche et
varié. Il touche à d'innombrables problèmes non seulement
en termes de définition - quelle condition particulière
appartient ou n'appartient pas à l'exil? - mais aussi en termes de
relation et d'écriture. Est-il vraiment possible d'écrire l'exil?
L'idée d'exil, exprimée de mille manières, est-elle
vraiment une constante de l'écriture? Est-elle le moteur de
l'inspiration créatrice? Qu'est-ce que l'exil nous apprend sur les
littératures issues de l'immigration, sur l'éthnicité, les
minorités, les expatriés, les réfugiés,
l'idée de voyage et d'écriture? sur les notions d'exotisme et de
diversités culturelles? Les études de ce numéro, tout en
proposant de nombreuses pistes d'enquête et de débat, montrent
aussi que l'exil reste un sujet problématique d'une portée
considérable dans le domaine littéraire. Plutôt que
d'apporter des réponses définitives à toutes ces
questions, ces textes nous invitent à poursuivre nos recherches dans un
univers riche et douloureux qui offre un champ illimité de
possibilités.
Tim Unwin
'Je savais déjà, moi, à sept ans, que
j'étais exilé; les odeurs et les sons, le bruit de la pluie sur
les toits, les tremblements de la lumière, je les laissais glisser le
long de mon corps et tomber autour de moi; je savais qu'ils appartenaient aux
autres, et que je ne pourrais jamais en faire mes souvenirs'. (Oreste in
Jean-Paul Sartre's Les Mouches)
The theme of exile has a central place in the history of writing, and is
present in some of the earliest and most fundamental texts. Adam and Eve are
banished from the Garden of Eden, and Moses wanders in the desert with his
people. Exile is above all about the drama of no longer belonging, or of being
excluded from some place - spiritual, cultural or geographical - which is
essential to the identity of a group or an individual. The awareness of a gulf
between self and homeland, present and past, and an accompanying sense of rift
or alienation, are key components. These feelings may be added to by the guilt
or anger of expulsion, by the ordeal of imprisonment within a foreign culture,
or indeed by the nightmare of real incarceration that sometimes accompanies
exile in its more extreme forms. Yet the myth of exile is never far from that
of return to the Promised Land, and feelings of suffering or displacement go
hand in hand with dreams of reintegration.
French and Francophone literatures have rich traditions in this area. From Du
Bellay through to Hugo and beyond, the resonances of the writer's exile have
been repeatedly explored and expressed. Many leading modern French writers are,
or were, exiles - Troyat, Semprun, Sarraute, Wiesel, Bosquet, Gary and others -
and thus bear witness to the profound links that exist between the upheavals of
displacement and the processes of creative writing. Yet the notion of exile
extends across an entire spectrum. At one extreme there is the objective exile
of the banished; at the other extreme is the more subjective exile of spiritual
or cultural dislocation, or perhaps the self-imposed exile of the cultural
refugee. How writers respond to or express the sense of exile is the subject of
the present collection of essays which, while focusing predominantly on French
and Francophone literatures worldwide, include studies of Iberian, Spanish
Caribbean and Romanian-language writings. For, by definition, the theme of
exile is 'interdisciplinary': it embraces two or more cultures. The range of
contributions here will no doubt give a sense of the vastness - both thematic
and geographical - of the subject.
These studies will also show that the relationship between writing and exile is
never less than complex, and nothing if not multi-faceted. If writing signals
the power of words to cross the divide, or to achieve continuity despite
separation, it can itself be the locus and the expression of exile. Two
parallel cases where writing formally re-enacts the dislocations of exile are
analysed by Guillaume Cingal, who discusses the first works of the young
Francophone writers Jean-Luc Raharimana from Madagascar and Abdourahman Waberi
from Djibouti. Each writer finds himself in France, traumatically separated
from his homeland. The response is a form of writing which is deeply
schismatic, reproducing the divide between the writer and the world he
perceives. By its self-conscious fragmentation of both linguistic and
narrative structures, writing recreates a sense of the lost homeland -
predominantly nostalgic for Waberi, but apocalyptic and desperate for
Raharimana. And similar processes might be seen in the case of Monique Bosco,
whose 1989 novel Babel-Opéra is studied here by Catherine
Khordoc. Bosco's physical exile (an Austrian Jew, she first goes to France
in the 1930s, then subsequently to Canada) is mirrored in the text's formal
techniques, for it is generically heterogeneous and self-consciously
fragmentary, containing both narrative and poetic passages. Exile cannot be
evoked directly, such is the suffering that accompanies it, and writing itself
becomes, as it is for the writers studied by Cingal, the expression of
disjunction and discontinuity.
In some cases, however, exile is a condition that the writer either seeks out
voluntarily or accepts - perhaps because it allows creative distance from the
home culture or mother tongue, or because it offers the chance to reach a new
audience. One of the most renowned examples of a self-imposed cultural and
linguistic exile is that of Samuel Beckett, examined here by Helen
Astbury. In one sense, it might appear that Beckett's decision to leave his
native land and to write in French was a rejection of his 'home' culture, a
classic case of separation. Yet contrary to initial appearances, it emerges
that this is not the case, and that the decision to write in French allows a
certain distance or repositioning which reconciles Beckett with his native
Ireland. Another form of self-imposed linguistic and physical exile has been
adopted by the Algerian writer Assia Djebar, discussed by Katarina
Melic. Melic's study focuses on Djebar's 1985 novel L'Amour, la
fantasia, in which the attempt to redefine personal identity is carried out
in the language of the French coloniser. At first, Djebar's decision to write
in French is liberating and allows her to find the voice which she had felt to
be stifled for so long. But she soon realises that the language of the other is
insufficient when she tries to express emotions and desires, or to revive the
oral traditions of her heritage. At the crossroads of three cultures and three
languages - Arabic, Berber and French - Djebar thus seeks out her own voice and
style, discovering new combinations that enable her to express both her own
story and the collective story of Algerian women.
In an analysis of the liberating power of exile for Caribbean writers such as
Julia Alvarez, Odile Ferly stresses the important role of emigration for
women writers in Caribbean societies. Such writers, she argues, are able to
escape the limitations of small, traditional, male-dominated communities. They
can be empowered by 'hyphenated identity', or the idea that exiles inhabit a
privileged space between two cultures. In such a state, the voluntary exile who
embraces a second culture is able to select those aspects of a cultural
inheritance that she wishes to preserve, rejecting what is burdensome. Yet the
happy exile of the artist or writer who seeks liberation will always have its
ironies and contradictions. For Odile Gannier, Tahiti has often been
viewed as the modern world's answer to Eden, the very image of the exotic, a
place of myth which is entirely at odds with the industrialised Western
societies. But it emerges that writers of both Polynesian and European origin
have struggled with the representation of Tahiti. To present it as a land of
exotic myth condemns the writer to sterile repetition, yet to write about it in
other terms is to destroy an image which both satisfies and delights. If Tahiti
as a place of the exotic par exellence, this label is never less
than ambivalent. Nonetheless, Gannier argues, the island is certainly capable
of finding its own voice and of overcoming that 'otherness' with which it is so
often associated.
Beyond that sense of alienation of the foreigner which so often accompanies the
condition of exile, there is the well-known condition of 'double exile' in
which the subject feels in some way alienated from both the original and the
adopted culture. In a study of Francophone African writing, Aedin Ni
Loingsigh describes how colonised Africans came to feel exiled both in
their own country and in France, and how life in Paris became a myth feeding on
both alienation and emancipation. More generally, she points out, the
literature of Francophone Africa gives a central place to the question of
exile. But while certain 'universal' characteristics of exile tend to recur,
exile is also linked to the specific historical conditions of colonial and
postcolonial Africa, and becomes a crucial element in the debate about modern
African identity through writing.
This sense of a double exile is also strongly felt among minority ethnic
groups of the second generation. One well-documented case is that of the Beurs,
or French of Maghrebi descent born in France. The Beurs find themselves not
only separated from the culture of their parents, but also excluded from full
participation in the adopted society because they continue to be categorised as
immigrants and foreigners. The Beur generations are thus exiled from their
heritage, yet they are also exiles at home. Two complementary studies in the
present collection explore this problem. Dayna Oscherwitz analyses the
representation of Beur identity in Paul Smaïl's 1997 novel, Vivre me
tue. Chronicling the experience of double exile, this novel documents the
sense of desperation and isolation lived by French of Arabic descent in
contemporary France, unable to integrate fully into either tradition. Yet, as
Kathryn Lay-Chenchabi shows, the responses to cultural and ethnic exile
in the adopted homeland can also be widely divergent. Her chapter focuses on
three Beur writers: Azouz Begag, Ahmed Kalouaz and Leila Houari (a Belgian
Beur). Each of them, while dealing with essentially the same preoccupations,
follows a different path to self-discovery. Houari and Kalouaz seek their
identity in an attempt to bond with the original culture, whereas Begag shows
an increasing preoccupation with his place in French society.
Another interesting case of a minority group is discussed by Hubert
Padiou in a study of Romanian-language Israeli writing. Unable to write in
Hebrew, many Romanian Jews continued to write in Romanian, and in 1973 formed
an Israeli Association of Romanian Language Writers. Padiou here proposes an
important survey of that body of literary works they have produced. Problems of
identity are, of course, paramount, just as they are for the Beur writers. But
is this a case of exile at home, or exile abroad? Is it double exile, or exile
in reverse? The rise of the younger generation, as is the case with Beur
literature, will no doubt change the parameters further. In both cases it is
clear that the literature produced is a literature of transition, and as such,
offers a crucial case-study of how exile is negotiated through writing. It also
shows that the question of exile is indissolubly linked to that of races,
diasporas and ethnicities, a subject which has had a high profile since the
mid-twentieth century in particular. But the question of migrant communities
was no stranger to the literature of the nineteenth century either, as John
Whittaker reminds us in a study of Lamartine's Toussaint Louverture,
a play about the black Haitian statesman who died in 1803. Lamartine's play,
clearly catching the mood of the times as momentum gathered for the abolition
of slavery, underlines that racial conflict is the very basis of dispossession.
The Haitian slaves are far from their native land, diseased, sick, and
disempowered through their condition of slavery. Racial injustice is the source
of the exile or exclusion of human beings from peace and self-fulfilment.
Yet what of the homeland that has been left behind? How do writers in exile, or
writers of exile, recreate or deal with that dream of the Promised Land? How do
they negotiate either their real or their imagined return to it? Among
discourses of exile in literature, the image of the garden, recalling the myth
of Eden, frequently returns. The garden may be a paradise from which the
subject is exiled, but there are also those more modest gardens created in or
out of exile - like the one cultivated by Candide and his fellow-labourers at
the end of Voltaire's famous work. Agnès Hafez-Ergaut argues that
such gardens can also be the place where a lost paradise is remembered, or
where hope is rekindled. Such is the case, she points out, in a story by
Gabrielle Roy entitled Un jardin au bout du monde, evoking the life of Martha
Yaramko, a Ukrainian women who has lived for thirty years in the West of
Canada. Her garden becomes the symbolic space of both the failures and the
unrealised hopes of her existence, yet it is also a paradoxical refuge: not the
Promised Land, but a land of promise at least.
For Martha, there will be no return, yet for other literary characters or
writers, the return to the homeland, often accompanied by crushing
disappointments, itself becomes a component of the exile's condition. Two
writers who have deliberately set out to record the return to a lost home are
Marie Cardinal, of Algerian Pied-Noir origins, and the Vietnamese writer
Kim Lefèvre. Michèle Bacholle looks at how these two
writers of very different backgrounds decide to return to the place of their
childhood. Cardinal records her return in Au pays de mes racines (1980),
and Lefèvre documents her own homecoming in Retour à la saison
des pluies (1995). The journey results in both cases in a return to the
adopted homeland and a sense of reconciliation or at least of compromise. In
other cases, the return 'home' has produced an experience vastly at odds with
the memory of the past. Marie-Paule Ha assesses this phenomenon in a
study of the Francophone Vietnamese writer, Nguyen-Manh-Toung. In a work
entitled Sourires et larmes d'une jeunesse, Nguyen-Manh-Toung tells the
stories of a number of expatriated Vietnamese characters who either elect to
stay in France or return to Indochina after an extended period of residence in
Paris. The work explores the often traumatic re-encounter with the culture of
origin. Yet the myth of return to the past, always fragile, can be especially
precarious when exile has been imposed through acts of war or political
terrorism. Ricard Ripoll Villanueva looks at the case of Agustín
Gómez-Arcos who, like other Spanish writers, has chosen to write in
French for political reasons - in this case as a result of the political
emigration caused by the Spanish Civil War. Gómez-Arcos's 1977 novel,
Ana Non, tells the story of an Andalusian woman who travels north
through Spain to see her imprisoned son before she dies. The story of the
character becomes, in a sense, the story of the writer himself, exiled for
political reasons, and examines the anguish of revisiting the past when a new
culture and a new language have been assumed.
It is clear that there are many writers and artists who achieve an ambiguous
self-discovery through exile, or for whom exile becomes a mainspring of
creativity. The sense of loss or a rift, as well as leading to writing by way
of compensation, can indeed be deepened and made more real by the act of
writing itself. Writing thus produces the very thing upon which it is dependent
for its existence, and it is small wonder that the return from exile is
sometimes so disappointing. Many would maintain that exile, at some level, is
indissociable from the processes of artistic creativity. For Camus, 'exile' and
the 'kingdom' were symbiotic notions. The link between exile and artistic
creativity was, indeed, memorably explored by him in a short story entitled
'Jonas ou la vie d'artiste'. In a study which considers the links between the
artist's work and the artefact that he produces, Caroline Sheaffer-Jones examines this story about a painter who progressively
withdraws from the life and society around him. The nature of the exile into
which Jonas retreats is deeply ambivalent. As the ending of the work shows, he
is both 'solitaire' and 'solidaire': in a state of solitude and of solidarity
with his community. He remains both and neither, divided from himself and
others, perhaps like all artists and writers.
The collection of essays presented in this special number of Mots
Pluriels shows that the theme of exile is rich and multi-faceted. It
engages with a wide spectrum of issues and problems, not only in terms of what
exile is or can be, but also in terms of the relationship of exile to writing.
Is it, indeed, possible to 'write' exile? Is exile, in its various forms, one
of the constants or one of the mainsprings of creative writing? What does the
theme of exile tell us about literatures of emigration, about ethnicities and
minority groupings, about expatriates and refugees, about travel and writing,
about notions of the exotic or about cultural identities? The essays here
provide a range of explorations of such questions, and show both collectively
and individually that exile is a far-reaching and deeply problematic topic in
literature. They do not, of course, claim to provide all the answers or to
close off this crucial area of study. On the contrary, they show that it
contains a host of possibilities for further investigation.
Tim Unwin
les dislocations liées à l'exil. Guillaume
Cingal en fait l'analyse et montre que les deux auteurs en question doivent
affronter la douleur de la séparation lorsqu'ils se retrouvent en
France. Leur réponse s'exprime sous la forme de textes dominés
par l'idée de rupture. Ils recréent sous forme littéraire
le fossé qui sépare l'auteur de sa perception du monde qui
l'entoure. En s'appuyant délibérément sur la fragmentation
des structures narratives et langagières, l'écriture
recrée l'impression de perte associée au souvenir de la terre
natale, impression empreinte de nostalgie chez Waberi et de désespoir
apocalyptique chez Raharimana. Un cheminement littéraire similaire peut
être relevé chez Monique Bosco dont le "roman"
Babel-Opéra publié en 1989 est analysé par
Catherine Khordoc. L'exil physique de Bosco (elle est juive d'origine
autrichienne, arrive en France dans les années 1930 et elle finit par
s'installer au Canada beaucoup plus tard) se retrouve dans les techniques
littéraires et le style adoptés par l'auteur qui choisit de
manière délibérée
l'hétérogénéité, la fragmentation et un
mélange des genres où se côtoient prose, poésie,
versets bibliques et autres formes. Comme dans les textes analysés par
Cingal, l'exil représente ici une expérience si douloureuse
qu'elle ne peut être présentée d'une manière directe
et il appartient aux formes utilisées d'en faire ressortir indirectement
tout le pathos. paradisiaque condamne l'écrivain aux
répétitions stériles mais il n'est pas facile de remplacer
une image ayant acquis la dimension d'un mythe. Si Tahiti est encore
perçu comme le lieu de l'exotisme par excellence, cette étiquette
n'en est pas moins extrêmement ambivalente et Gannier suggère que
l'Ile est en mesure de trouver sa propre voix et de définir sa
singularité. qui rappelle plutôt le jardin
cultivé par Candide et ses compagnons à la fin du
célèbre texte de Voltaire. Comme le suggère Agnès Hafez-Ergaut, de tels jardins peuvent être le lieu
privilégié du souvenir d'où rejaillit parfois l'espoir.
Tel est le cas, dit Hafez-Ergaut, de l'histoire de Gabrielle Roy, Un jardin
au bout du monde, qui évoque la vie de Martha Yaramko, une femme
d'origine ukrainienne ayant vécu depuis trente ans dans l'ouest du
Canada. Son jardin devient l'espace symbolique de ses échecs, de ses
vaines attentes et de ses espérances déçues, mais il lui
offre aussi, paradoxalement, un refuge qui, même s'il n'a rien
d'édénique, lui permet de se retrouver.
Professeur de langue et littérature françaises
Université de Bristol
https://www.bris.ac.uk/Depts/French/unwin.html
[Haut de la page] / [Table
des matières de ce numéro de MOTS PLURIELS]
Professor of French Language and Literature
The University of Bristol
https://www.bris.ac.uk/Depts/French/unwin.html
[Top] / [Back to contents]