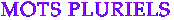
no 17. avril 2001.
https://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP1701gc.html
© Guillaume Cingal
| RESUME |
Guillaume Cingal
Université de Paris-10-Nanterre / Université de Dijon
Dans son délire irénique il s'était
souvenu de la
légende de l'ogresse, celle qui donne et reprend la vie
;
n'était-elle pas seule comme lui sur cette rive
indéterminée ?
Elle avait l'océan pour frontière et le ciel pour unique
univers.
(A. Waberi Le Pays sans ombre 'L'Ogresse des origines', p.34)
Le Malgache Jean-Luc Raharimanana et le Djiboutien Abdourahman Waberi ont commencé à publier leurs premiers textes au Serpent à plumes dans les années 1990.[1] Nés respectivement en 1967 et en 1965, ils appartiennent à une même génération d'écrivains africains exilés en France. En dépit des différences importantes qui séparent ces deux oeuvres, j'aimerais m'attacher à ce qui les lie : dans les deux cas, le traumatisme de l'exil se donne à lire de façon fragmentée. La fragmentation n'est pas seulement formelle, même si c'est là le trait le plus déterminant à première lecture. Elle touche aussi, entre autres, la représentation des corps, de l'histoire (contemporaine ou non), témoignant ainsi d'une génération désillusionnée et résolument pessimiste.
| Modalités formelles de la fragmentation |
En 1992, le grand romancier somalien anglophone Nuruddin Farah, aîné et modèle de Waberi, écrivait :
-
My current obsession is one in which, as though in a reflected vision,
I see the rest of the world in a broken mirror and discern the distorted truth
of the things which I behold. Then I spot the fractured quality of the souls
deflected in the lookingglass ; I see amputated limbs and am consequently
overwhelmed with images suggesting Guernica.[2]
Cette vision fragmentée dont Farah attribue la cause au statut d'exilé, Waberi et Raharimanana l'assument ; mais, tandis que Nuruddin Farah, qui appartient à la première génération des écrivains post-coloniaux, cherche à reconstituer un monde fictionnel cohérent dans ses romans, les deux jeunes écrivains francophones parient, eux, sur la dissémination du sens, comme si le seul mode d'écriture de l'exil était la dislocation même des formes littéraires. En se situant sur le "seuil" de l'exil, l'écrivain exilé est sollicité de tous côtés, c'est-à-dire par son pays d'origine, lointain et quasiment perdu, et par la condition même d'exilé[3]. A cette sollicitation multiple correspond une "parole en archipel", ou plutôt, des archipels de paroles.
Les textes de Raharimanana sont rythmés par des chants, éclats âpres et brefs, comme la 'Chanson de la meute' (Rêves, p.113) ou le 'Chant de la femme' (Rêves sous le linceul, p.61). Ceux de Waberi sont constellés de citations ou de références intertextuelles :
-
On me jette à la figure que j'ai lu La Femme mystifiée de
Betty Friedman et Femmes d'Alger dans leur appartement de
l'Algérienne Assia Djebar, que j'ai eu vent d'Angela Davis, de la
Beauvoir ou d'Angela Carter. Qu'est-ce que ce chapelet de noms étrangers
peut bien aviver chez moi? Confidence pour confidence: j'ai aussi lu
Aqoondarro Wa Uu Nacab Jacayl du Somalien Farah M. J. Cawl, La
Répudiation de l'Algérien Rachid Boudjedra ou Femmes en
guerre du Nigérian Chinua Achebe, et alors? (Cahier nomade,
p.56)
Le Pays sans ombre compte pas moins de quatorze épigraphes disséminées dans le livre et qui révèlent un vrai dialogue des cultures et des continents : Shakespeare, Evelyn Waugh, Hugo, Paul Nizan, Assia Djebar, Nuruddin Farah, Beckett, Rimbaud, Calaferte, Tchicaya U'Tamsi, Kateb Yacine, Rachid Mimouni, Baudelaire, Soyinka.
Il s'agit là d'un premier mode de dissémination. L'ouverture sur le chant, extérieur à la diégèse proprement dite, ou sur l'écriture des autres, est un signe évident de déplacement : l'auteur exilé ne peut assumer la fonction centrale qui est traditionnellement la sienne. En ce sens, Waberi et Raharimanana sont des écrivains post-modernes, pour qui l'exil est une figure parmi d'autres.
Un autre mode de dissémination est la fragmentation des énoncés, notamment dans le cas de Raharimanana. Les deux recueils de l'écrivain malgache se caractérisent par la prolifération des phrases courtes, nominales, exclamatives, ainsi que par l'abondance des blancs typographiques et la brièveté des paragraphes :
-
Tu vomis. Lourd de ma succulence.
Tu vomis. Repu de ma chair.
Tu vomis. Ivre de mon sang.
Tu rampes. Tu te relèves. Tu pars. Tu promets de me tuer. Je plane. Je suis loin de tout cela.
Dzamala est mon nom. Dzamala. Dzamala. (Rêves sous le linceul, p.96)
A ces effets de rupture s'ajoute une poétique fondée sur l'itération. Dans les rares cas où la phrase se développe, l'apposition et la parataxe l'emportent :
-
Hurle, enfant de malheur !
Un coup de feu.
Un des soldats a tiré.
Tire ! Tire ! Mitraille ! Les corps qui sont tombés, les gosses qui ont hurlé, les mots qui se sont noués et qui ont étranglé, les mots qui se sont tus, mots-tuerie, mots-massacre que l'on inscrit sur les pierres incolores, les pierres les plus dures, les plus lumineuses, les plus mystérieuses, mots redits en mendiant le silence, mots redits en mendiant la lâcheté.
Hurle donc ! (Lucarne, p.82)
Même si Waberi préfère des formulations moins véhémentes, les phrases nominales jouent, dans sa prose, un rôle essentiel :
-
Jours de fête. Ripaille. Ramadan renvoyé aux calendes grecques.
Rêves en forme de gazelle boucanée. Fous rires du fou. Furieux
coup d'ailes. Effet du khât. Qât. Tchatt. Tchin-tchin. Ciel ouvert
sur le crépuscule. Les étoiles narguent les brouteurs. Les
feuilles se répartissent au hasard sur la ramure vert olive. Lancinante
transe. Forcément humaine. Mémoire nomade. Caravanes de mots.
Semés au gré des attractions. Affinités électives
dues aux sons. Poésie erratique. Parchemin des songes. (Cahier
nomade, p.148)
Comme on le voit dans l'extrait ci-dessus, Waberi se réclame d'une esthétique nomade pour redonner un sens à sa "dérive" stylistique : la fragmentation est l'effet de l'influence des formes orales traditionnelles somalies.
| Modalités formelles de la fragmentation |
Toutefois, c'est sans doute, pour les deux écrivains, le choix du mode narratif (la nouvelle) qui exprime le mieux l'archipélisation du discours.
Le Pays sans ombre se présente comme un diptyque : "Détour. Pages arrachées au roman de l'imaginaire" est une suite de huit nouvelles et "Retour. Pages arrachées au pays sans ombre" une suite de neuf nouvelles. Certaines nouvelles sont elles-mêmes fragmentées, comme si l'éclatement n'avait pas de limites. Ainsi, 'Vortex' se décompose en huit brefs paragraphes d'une demi-page chacun ; chacun de ces paragraphes s'accompagne d'un extrait de journal. La nouvelle intitulée 'Fragments intimes et colossaux' déroule, sur cinq petites pages, une série de six fragments, ce qui ne manque pas de souligner le caractère ironique du titre : ici, c'est la miniaturisation qui est, en quelque sorte, "colossale".
Cahier nomade repose sur une structure similaire. Les six nouvelles de "Traces" et les sept nouvelles de "Trames" forment une fois encore un diptyque. Une fois encore, les nouvelles 'Août 1966' et 'Gens de D.' sont faites de fragments.
Même observation à la lecture des deux recueils de Raharimanana. Si Lucarne est une suite linéaire de nouvelles, qu'il soit permis de citer in extenso la table des matières de Rêves sous le linceul, telle qu'elle figure en fin de volume, à la page 137 :
-
I - DERIVES
Le Canapé
Terreur en terre tiers (1ère époque)
Des peuples
L'Ondine lumineuse
Comme un abîme éternel
Les Conquérants
Terreur en terre tiers (2ème époque)
Le Vent migrateur
Fahavalo
Le Canapé (Retour en terre opulente)
II - VOLUTES
Dzamala
Le Maître des décombres
La Meute
III - EPILOGUE
| L'écriture en état de rupture |
La dislocation ne touche pas seulement le texte, mais jusqu'aux corps et aux lieux que décrit l'exilé. Il en est ainsi de la dérive des cadavres dans la première nouvelle de Cahier nomade :
-
Quelques yeux dûment accompagnés de leurs cadavres mafflus
dérivaient en suivant le courant. D'ici peu la terre retrouvera son
aspect de vieille carne. Elle grouillera de mille milliards de paires d'yeux,
de paires de jambes et d'autant de bras ondoyant sur les eaux calamiteuses et
par-dessus tout dormantes. Des eaux qui se refuseront à suivre le cours
de l'Histoire. [...]
Tout dérivait alentour: des placentas dorés, des foetus de sept jours, les seins d'ossuaire d'une nomade qui semblait vouloir noyer son rejeton dans le glacier mobile, un miniaturiste aux moustaches de titan, une tête monumentale, poreuse ainsi qu'une éponge molle, etc. (pp.14-16)
Ce qui s'exprime ici sous la plume de Waberi, c'est le cauchemar qui hante chaque page dans les textes de Raharimanana. Ainsi, la nouvelle intitulée 'Sorcière' montre le viol à mort d'une jeune fille et l'assassinat d'un homme issu des milieux populaires par des jeunes nantis :
-
On la traîna, on la jeta dans le canal nauséabond. Le corps flotta
au milieu des nénuphars, au milieu des voiles de cellophane pourris, des
excréments qui émergeaient. Le corps flotta auprès des
morceaux de bois et des détritus décomposés. Nous, on s'en
est allés rejoindre la Range. Tâtons l'asphalte zenfants de la
patrie. Le mec baignait dans son sang. On l'a laissé là. Il est
bien, là ! (Lucarne, p.71)
A la corruption totale et infâme des jeunes nantis correspond la putréfaction des corps, ainsi qu'une description sans fards des événements les plus sordides. Pour l'exilé, l'Afrique, qu'il s'agisse de Madagascar ou du Rwanda,[5] n'est pas un paradis perdu, mais un lieu de carnage et de désolation.
Dans de telles circonstances, l'exil, s'il est vécu comme une véritable tragédie, n'en demeure pas moins une solution de survie : "Il me tarde de ne plus me heurter à tous ces peuples infâmes (à tête de chien, à la peau visqueuse et au sang noir) qui se nourrissent de serpents, de mouches, de cadavres, de foetus ou d'embryons." (Rêves sous le linceul. p.30). Si tragédie il y a, c'est que, même en exil, l'écrivain ne peut oublier le cauchemar qui vient le hanter constamment, jusque sur son canapé, "en terre opulente" (p.79) :
-
On est bien ici. Vaste canapé qui s'illumine de pourpre lueur et qui
vient couvrir les immenses étendues de verdâtres cadavres, de
pavés, de cailloux, de barres de fer et de sales chenilles. Pourpre
lumière et ondée de soleil. Goutte de lune et tombée
d'astres. Une aspirine. Une aspirine. 12 heures.
L'enfant bout sur la moquette de mouches et l'effervescence de sa faim rampe vers mon canapé. Brûlure. Brûlure. La coupe de tête crame. Et les mouches. Et les caillots de sang. Et les veines raides du cou. (Rêves sous le linceul, p.19)
L'on est bien ici. Une tête coupée à la machette. Qui, sèche, roule contre le canapé. Sèche. Pas de sang dégoulinant, pas de cervelle qui s'écoule. L'on voit pourtant la trace de rouille de l'outil qui l'a taillée. L'on voit pourtant que l'oeil crevé a laissé filer tout son jus. Je la ramasse et me l'enfouis sous la housse. (ibid., pp.81-82)
Le canapé de Raharimanana est la figure la plus emblématique de la situation de l'exilé : ni tout à fait en France ni tout à fait en Afrique, il possède le don tragique de l'ubiquité et ne peut jamais arracher de son esprit le lieu originel. On pourrait donc appliquer à Raharimanana ce que Soyinka dit du poète zimbabwéen Dambudzo Marechera, mort en 1988 :
- Dambudzo
Marechera made no efforts to come to terms with exile. [...] Exile was a
provider, but not one that should be treated as a willing partner ; it had to
be a relationship of forcible extraction."[6]
Un des moyens d'échapper à la dissémination infinie du sens que l'exil marque de son sceau pourrait bien être l'exil inverse que suggère Waberi au sujet de Marwo, "jeune usagée de la ville" qui quitte le bidonville pour regagner la campagne (Le Pays sans ombre, pp.103-109). Dans 'Feu mon père, reviens', le locuteur (Waberi?) expose le point de vue de son père sur l'exil, sans dire s'il se reconnaît ou non dans cette affirmation :
-
Où que tu ailles, quoi que tu fasses, tu emporteras ton pays sur ton dos
et n'en déplaise à ceux qui veulent te persuader du contraire, on
ne peut s'exiler de soi-même. C'était ton credo, je
t'écoutais. Quel que soit le nombre d'années passées
à l'étranger et les charmes de l'exil, la nostalgie te tisonnera
et l'appel du pays est plus fort que les tentations du tout-monde.
Séduit et confit, je buvais tes mots. (Cahier nomade, p.121)
Les propos du père ne figurent ni en italiques ni entre guillemets : la parole du père est entremêlée au récit du fils. Ce détail typographique marque, tout comme le canapé de Raharimanana mais de façon moins tragique, la condition impossible de l'exilé : l'exilé, c'est celui qui n'arrive pas à décider si la nostalgie du pays originel est plus forte que le désir de l'ailleurs. Cette incertitude est son fardeau.
Pour Raharimanana, en revanche, l'exil a ceci de tragique qu'il n'est pas une solution. En effet, où qu'on se tourne, c'est la désolation qui attend : "M'éloigner, ô Salam ! M'éloigner enfin ! Pouvoir me tourner sur ces rivages où une foule en merde se tasse, se bronze et se décompose sous la lourde chaleur..." (Lucarne, p.127). Comment choisir entre les massacres en terre africaine et la "merde" en terre européenne ?
Ainsi, la fragmentation des énoncés et des structures narratives, mime partiellement une description du pays d'origine qui est nostalgique dans le cas de Waberi, post-apocalyptique et désespérée dans le cas de Raharimanana. Dans les deux cas, l'exilé appelle de ses voeux des lendemains qui chantent. Rêves sous le linceul s'achève sur un appel de l'écrivain :
-
Mon amour, je te raconte l'histoire d'un massacre. Je te raconte l'histoire
d'une purification. A Toi qui gis encore sur l'asphalte sanglant et qui n'as pu
nous accompagner sur ce fleuve qui mène jusqu'à la mer de sang...
[...]
Je dis.
République. nation souveraine. Démocratie. Union nationale et bain ethnique. Longue marche. Oubli. Odeur. Solidarité. Aide humanitaire. Paix. Silence. Oubli encore. Oubli. La terre craquelée et l'âme contaminée. Sécheresse. Oubli. Oubli toujours...
Je dis et plaise à Dieu que des oreilles se tendent. (p.134)
Abdourahman Waberi, lui, rappelle les événements d'août 1966 et place son récit des atrocités coloniales sous le signe du devoir de mémoire :
-
Khalif, Nasr et Mahdi s'abîmèrent dans un soliloque sans fin. Le
gouverneur avait pratiqué une lobotomie sur tous les hommes pour qu'ils
n'aient plus jamais à chuchoter les secrets douloureux de cet août
1966. Pour son grand malheur, il avait oublié les bébés --
promesse et menace d'un futur. J'avais un an. (Cahier nomade, p.32)
Pour que l'histoire collective des Africains et l'histoire individuelle des exilés échappent au "soliloque", au ressassement, à la fragmentation totale, l'ouverture sur l'extérieur, c'est-à-dire à la fois sur un lecteur hypothétique et sur un avenir incertain, est plus que jamais nécessaire. Comme l'a bien noté Bernard Mouralis il y a quelques années, l'exil est une arme à double tranchant :
-
Le déplacement permet d'échapper à
l'immédiateté (et à l'inconscience) de l'imaginaire et de
découvrir les médiations qui rendent possibles cette distance du
sujet par rapport à lui-même sans laquelle il ne peut y avoir
d'écriture.[7]
Notes
[1] Abdourahman Waberi. Le Pays sans ombre. Paris: Le Serpent
à plumes, 1994; Cahier nomade. Paris: Le Serpent à plumes,
1994.
Raharimanana. Lucarne. Paris: Le Serpent à plumes, 1996;
Rêves sous le linceul. Paris: Le Serpent à plumes, 1998.
Toutes les références de pagination de l'article font
référence à ces éditions.
[2] Nuruddin Farah. "A Country in Exile" in Transition. no. 57, 1992, p.6.
[3] Voir à ce propos l'allocution de Wole Soyinka. "Thresholds of Loss and Identity" in Seuils - Thresholds. Numéro spécial de la revue Anglophonia. no. 7, Presses Universitaires du Mirail, 2000, pp.61-70.
[4] Cf Mohamed Abdillahi Rirache. "Somali Poetry: the Case of the Miniature Genres" in Ufahamu. vol. 17, no. 2, 1989, pp.23-30.
[5] Rêves sous le linceul est placé sous le signe du génocide rwandais, comme l'indique la dédicace : "Rwanda et dépendances..." (p.9).
[6] art. cit.. p.65. Italiques ajoutés.
[7] Bernard Mouralis "Les 'chemins océans' des écrivains africains et antillais" in Najib Zakka. Littératures et cultures d'exil: terre perdue, langue sauvée. Lille: Presses Universitaires de Lille, 1993, p.229.
Guillaume Cingal
agrégé d'anglais et ancien élève
de l'Ecole Normale
Supérieure (Ulm-Sèvres). Il est Allocataire-Moniteur à
l'Université de
Paris-10-Nanterre et prépare actuellement une thèse sur Nuruddin
Farah sous
la direction de M. le Professeur Jean-Pierre Durix à Dijon. Il a
publié
divers articles sur Olaudah Equiano, Breyten Breytenbach, Nuruddin Farah. Il
administre également
The Nuruddin Farah page.
Back to [the top of the page] [the contents of this issue of MOTS PLURIELS]