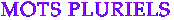
no 17. avril 2001.
https://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP1701og.html
© Odile Gannier
| RESUME |
Odile Gannier
Université de la Polynésie Française
Tahiti! Ce nom évoque-t-il quelque chose pour vous? Pour moi, il
possède une saveur unique, fruit d'une association de pensées qui
n'ont aucun rapport les unes avec les autres; essences des Mers du Sud,
où se mêlent toutes les choses imaginées il y a au moins
quarante ans, sorte de mélange d'Herman Melville et du Capitaine Cook,
de l'Opéra français et de Pierre Loti. Bien sûr, je
m'attendais à quelque chose de différent de ce que j'ai
trouvé, cependant, la réalité se modèle tant bien
que mal sur la fiction.
(Henry Adams, 1891)[1]
Si un lieu au monde transpire l'exotisme, depuis l'annonce de son existence, c'est bien Tahiti. L'Europe s'est prise d'engouement pour les îles de Polynésie. Nouvelle-Cythère, Utopie, jardin d'Eden, les qualificatifs les plus élogieux leur ont été décernés; de sorte que la littérature originaire des îles, elle-même, entretient l'image miraculeuse: une part de la littérature "locale", qu'elle soit écrite par des Polynésiens ou par des "étrangers" résidents, tient de "l'exotico-romantisme", parfois mièvre, d'autant plus que nombre de publications, étant des mémoires, baignent souvent dans la nostalgie du bon vieux temps:
-
Je me demande si personne, qui les connaisse bien, écrira quelque chose
sur les mers du Sud. J'imagine que non. Et c'est tant mieux. Pourquoi
démolir si vous n'avez rien de mieux à mettre à la
place?[2]
Les comptes rendus du voyage de Bougainville auraient créé, dans l'esprit français, le mythe de Tahiti. Effectivement, tous les éléments sont mis en place: la beauté du paysage, disposé pour le plaisir de l'oeil; l'uberté naturelle, qui laisse imaginer, comme les Antilles le faisaient pour Colomb, la possibilité d'un ravitaillement infini pour les navires de passage; l'accueil généralement chaleureux des insulaires; et surtout, pour des hommes nourris autant par les représentations de la Bible que par les Bucoliques ou la littérature utopique[4], une combinaison originale, intellectuellement et esthétiquement captivante. Tahiti relève ainsi pleinement de la topique édénique. La publicité faite autour de cette "découverte", le faisceau de témoignages concordants à la même époque, comme celui des voyages de Cook, a suscité de nombreuses reprises du thème[5]. L'Américain Henry Adams réécrit à sa façon, en 1890-91, les développements de Bougainville:
-
Si le Paradis est fait de paysages et d'atmosphère, il est ici. La
population entière me tient compagnie en ne faisant rien. La houle
frappe laborieusement, nuit et jour, le récif corallien, et les palmes
des cocotiers bruissent dans l'alizé. Mais, à ces exceptions
près, la nature se montre aussi indolente que l'homme. Je regarde la
mer, mais je ne vois jamais une voile. Je suis réduit à lire
l'Odyssée, et à l'annoter d'après ma propre
expérience au milieu d'un peuple qui lui ressemble.[6]
Cette vision rousseauiste des insulaires reflète cependant fort mal les nombreuses difficultés auxquelles les populations du Pacifique ont dû faire face lors de l'arrivée des Européens. Le contact a été chèrement payé: les maladies, sur le plan démographique, les missionnaires, dans l'ordre religieux et social, les visites nombreuses, au niveau des échanges, ont considérablement modifié l'équilibre de la civilisation ma'ohi. Si la langue a finalement résisté, elle devient le fleuron de "traditions" variées, qui plus que des héritages culturels véritables, peut-être, sont le signe de résistances discrètes de l'identité.
On comprend ainsi la double fascination: celle des "étrangers" -pour l'île essentiellement, il faut le reconnaître, ses couleurs, son climat, son lagon, sa situation, et ce qu'elle représente, de manière atemporelle; celle des Polynésiens eux-mêmes pour leur île - mais surtout pour leur culture. Si le mythe vient à se disloquer, les sentiments sont modulés à l'infini entre ces deux positions extrêmes: l'attraction ne serait-elle pas essentiellement spatiale, dans un cas, et historique dans l'autre?
Une fois posé l'attrait de Tahiti, comme archétype de l'exotisme, a-t-on encore le droit d'avouer sa déception? C'est la question que posent, dès le XIXe siècle, plusieurs écrits célèbres sur l'Océanie: la confrontation avec la réalité peut décevoir le visiteur aveuglément crédule aux images des autres, à moins que le désenchantement n'altère son rêve insensiblement. Outre les lettres, comme celles d'Adams ou de Fletcher, Le Mariage de Loti, les Immémoriaux , au premier chef, proposent de la Polynésie une vision mitigée, "fin de siècle"; Vasco, de Chadourne, en 1927, Touriste de bananes, de Simenon, en 1938, ou même le Solitaire du lagon, publié par René Charnay en 1979, montrent la force du mirage et le risque de la déchéance promise au "Blanc" partant pour les îles à la poursuite de son rêve. Romain Gary propose, lui, dans la Tête coupable (1968) une caricature du "paria des îles" tout en montrant sarcastiquement l'usage mercantile du personnage de Gauguin, et plus généralement, du "Mythe tahitien".
Ce mythe s'est bâti sur une "composition exotique"[7], savante combinaison de motifs récurrents, comme l'insularité, la nature "luxuriante", associées à l'image de la vahine qui génère de faciles amours exotiques - autant dire que l'Océanie paraît un fantasme essentiellement masculin. Nombre de romans utilisent ce filon sans souci de création originale. Certains, comme la Tête coupable, en jouent:
-
L'île ne tenait pas ses promesses de son mythe dans le monde. Les
vahinés faisaient de leur mieux, mais l'âge moyen de la
majorité des visiteurs se situait autour de soixante-cinq ans et les
"heures enchanteresses sur le sable blanc au clair de lune",
dont parlaient discrètement les dépliants, se heurtaient
là à certaines limites.[8]
Lorsque le texte prétend renvoyer à un présent, la lassitude du quotidien peut l'emporter:
-
Que pouvait-il, lui, attendre de mieux de la vie que cette euphorie, cette
douceur de la vie inépuisablement renouvelée, ces miracles de
lumière chaque jour accomplis? [...] "Dans l'air, pas encore de menace
mais parfois une sorte de fatigue qui m'enveloppait comme l'entêtement
d'un parfum trop tenace, une indécollable langueur, une torpeur
amnésique qui me gagnait. Mais quelle anesthésie! Et je pensais:
euthanasie, petite mort douce et parfumée. Ah! Dieu, non, ce n'est pas
un pays pour progresser! Et qui sait? Peut-être m'y serais-je fait...
Jouir! Il n'était là-bas que de jouir... Mais, savoir jouir, tout
est là..."[10]
-
Où que tu ailles, Vasco, tu trouveras aux gens et aux choses un visage
quotidien, une figure de nécessité et aussi la
nécessité de vivre, de gagner ta vie... Je ne te parle pas de
toi-même que tu retrouveras identique, inchangeable partout où tu
iras.[12]
-
Ce ne sont pas les insulaires qui souffrent de l'isolement, mais le voyageur
qui s'installe, le continental que la réduction de l'espace rend,
à la longue, claustrophobe.[13]
-
Dans mes premiers jours ici, c'était un bruit dont je ne me lassais pas,
il me faisait penser à une respiration de l'Océan. Aujourd'hui,
je le subis, et pendant mes insomnies il y a des moments où j'ai envie
de crier contre ce grondement éternellement recommencé et
qu'aucune puissance ne pourrait faire cesser. Le récif même, dont
chaque matin depuis l'appontement j'interrogeais l'ampleur de la frange
d'écume, il a pris l'aspect d'une sorte de barrière qui
définit à la fois ma prison et ma liberté.[14]
-
Vous verrez, continua-t-il, avec l'absence des saisons de nos pays d'Europe, un
soleil à peu près immuable, tout s'écoule dans une
fluidité trompeuse. Les jours paraissent se succéder sans laisser
de traces. Et avec l'éloignement, la lenteur des communications, les
nouvelles de France arrivent tellement décolorées qu'on finit par
s'en désintéresser. Et insensiblement la notion de temps devient
différente.[15]
Cet affaiblissement des repères génère des sentiments contradictoires chez le visiteur de passage, rarement l'humour: "Tahiti est un lieu où rien ne passe que le temps, et chacun se tient aussi tranquille que possible pour ne pas gêner son passage[16]"; ou encore, chez Adams:
-
J'y vois une exquise réussite de cimetière. L'on aimerait
être enterré ici. Tout est plus ou moins mort. Papeete a un petit
air des plus drôles de ville perdue de province française. Le
reste de l'île est comme un village indien déserté par ses
habitants. L'impression de mort n'est pas pénible ici, mais seulement un
peu triste et ensoleillée, sauf aujourd'hui où la pluie tombe
à jets continus.
-
Prenez une fille sortie des salons de beauté parisiens ou
américains et transportez-la au paradis terrestre: elle perd
immédiatement ses couleurs, s'éteint, s'efface, disparaît,
devient du blanc, du délavé et du décoloré. La
splendeur exotique des peaux et des formes, des visages et des cheveux des
Tahitiennes et le paysage tout entier, éclatant de couleur, la
réduisent par contraste à l'état de sous-produit
industriel mal en point.[18]
-
Peut-il, impunément, abandonner tout ce qui fut jusqu'alors sa raison
d'être? S'arracher sans vergogne à son passé? Et vivre
à Tahiti, sans esprit de retour? Je ne le crois pas. J'ai vu trop
d'épaves...[19]
L'étranger qui s'installe peut en effet adopter deux attitudes. Soit il s'adapte au rythme de l'Océanie, en accepte les conditions au point de ne pouvoir repartir:
-
Ne croyez pas qu'un jour précis j'ai décidé de rester,
simplement je ne suis jamais reparti. Cela s'est fait insidieusement avec la
complicité d'un climat trop doux, sans même que j'en prenne tout
à fait conscience. Jour après jour ma volonté a
été grignotée de l'intérieur de façon
invisible...[20]
L'exil peut donc naître d'un pourrissement de l'exotisme: l'heureux sentiment du "Divers pur" explicité par Segalen s'affadit à la longue, voire tourne à cette impression oppressante que prévalent dans ce lieu des références et des lois auxquelles on ne peut adhérer. La culture n'est plus que folklore, la vie trop lente. On se sent seul insatisfait, dans un monde apparemment content de ce que l'on considère comme insuffisant ou brusquement intolérable. Si l'exotisme pimente le goût du départ, l'exil rend amer le désir du retour:
-
Le nouveau venu, comme pris dans un piège et cherchant une issue,
regarde du côté, regarde du côté du récif
où se brisent les lames: il voudrait repartir.[21]
Mais le mal-être n'est pas l'apanage des "étrangers". La situation est difficile aussi pour les insulaires, dépossédés de leurs repères et réduits au silence. La transmission orale de leur culture risque l'essoufflement ou la rupture. L'oubli des noms anciens est bien l'argument des Immémoriaux de Segalen. L'imposition d'une religion et d'une culture par le livre est un bouleversement qui ne peut se racheter que par l'appropriation de l'écriture. Face à une littérature si bavarde, les Polynésiens ont une parole à prendre pour conjurer l'exil intérieur. Face à une présence européenne souvent déroutante, comme l'explique le poète Henri Hiro, le Polynésien hésite: "Si tu étais venu chez nous, nous t'aurions accueilli à bras ouverts. Mais tu es venu ici chez toi, et on ne sait comment t'accueillir chez toi".[22] L'incertitude existentielle se traduit peut-être par le "fiu," cette intense et brusque lassitude, qu'Adams décrit ainsi:
-
Je n'ai jamais vu un peuple dont l'ennui éclatât aussi
désespérément que celui des Tahitiens. Les
étrangers qui résident ici le clament avec une vigueur inutile,
et les indigènes le portent dans les yeux et l'expriment dans toute leur
attitude. Le rhum est la seule distraction que la civilisation et la religion
leur aient laissée.[23]
-
Mon séjour dans l'ensemble est un désappointement. Pourtant,
partout les habitants montrent pour moi une gentillesse extrême. [...] Je
découvre chez eux ce que je n'ai pu voir nulle part ailleurs, le type
des parfaits Polynésiens d'autrefois que je me suis plu tant de fois
à imaginer. [...] Mon désappointement provient de la
méfiance des indigènes envers moi. [...] J'ai voulu me renseigner
sur leurs ancêtres et sur le passé de l'île: ils ont tous
observé un mutisme absolu. Ils ne savent plus rien, disent-ils. [...]
Ils m'ont affirmé ne plus connaître que des chants religieux et
prétendu avoir tout oublié. Je me doute bien que cette
barrière et ce mutisme absolu proviennent d'une consigne religieuse.
Peut-être aurais-je pu la forcer si j'avais séjourné plus
longtemps parmi eux.[24]
-
Dans le livre des anciens, tu cherches les légendes que tu as
écoutées sur la plage, près du feu où grillaient
les hava'e. Dans les livres des anciens, tu cherches les histoires vraies qu'on
ne t'a pas racontées, celles des grands guerriers, celles des grands
voyageurs, celles des grandes histoires d'amour de ton peuple et celles de tes
dieux.[25]
Chanter les riches heures d'une civilisation indûment dérangée dans sa quiétude fait figure de poncif revendicatif. A défaut, on loue encore la beauté de son île et le bonheur qui lui est indissolublement lié. Pourtant, ce légitime attachement ne peut, souvent, se garder d'une certaine convention, à l'image de l'"exotico-romantisme" ou "exotico-symbolisme", que le mouvement de la Négritude aux Antilles a dénoncé en son temps: la différence d'inspiration ne semble pas fondamentale entre Daniel Thaly:
-
Je suis né dans une île amoureuse du vent
Où l'air a des senteurs de sucre et de vanille
Et que berce au soleil du Tropique mouvant
Le flot tiède et bleu de la mer des Antilles.[28]
-
Mon île est une fleur qui s'épanouit au soleil.[29]
-
La Polynésie d'Alain Gerbault s'est éteinte, dans beaucoup de cas
pour le bien des Polynésiens qui ont pris leurs destinées en
main, revendiqué une culture, une identité qui leur appartiennent
en propre, juste comme il le souhaitait. Un paradis est mort, mais un paradis
perdu, paradis de chimère qui fut aussi celui de Segalen, de Loti ou de
Paul Gauguin.[31]
Cependant, il serait illusoire et malsain de déclarer des monopoles d'écriture, de réserver aux seuls Polynésiens "de souche" le droit de parler de leurs îles: s'il est juste et heureux que cette écriture se libère, elle ne doit pas interdire aux autres communautés de s'exprimer. Les résidents de longue date connaissant souvent bien leur monde d'adoption, peuvent continuer à faire partager, eux aussi, l'expérience inverse de la culture de l'Autre. Les "demis" représentent une entité plus floue: issus de mariages mixtes, ils sont toujours en recherche d'eux-mêmes, tiraillés, selon les circonstances, entre deux groupes et héritant de leur double ascendance des modes de vie et de pensée individuels et fluctuants. La communauté d'origine chinoise, elle aussi, sait parler de l'exil:
-
Hakka je le suis, Hakka je le resterai toute ma vie. Ballotté au
gré des vagues d'exode ou des identités d'emprunt, éternel
invité dans d'autres cultures, hôte bienvenu ou parasite
indésirable, c'est selon. Jamais une terre à soi, jamais quelque
chose en propre, toujours en transit vers nulle part, ou en illusoire
revendication et vaine recherche d'une identité qu'on n'a plus, [...] en
étant devenu plus rien qui n'a plus de nom dans aucune langue, victime
de sa propre imprévoyance, de son renoncement et de son ignorance du
sens de sa destinée.[35]
Pour tous, la problématique est bien la même: la sauvegarde ou la détermination de leur identité. Les Polynésiens doivent exprimer leur vision des choses avec leurs mots, pour échapper à ce sentiment de dépossession ou d'exil intérieur, qu'a constitué une forme d'oblitération de la parole face à une littérature si foisonnante qui a parlé des îles sur le mode de l'objectal. Déjà en 1842, le Révérend Orsmond soulignait:
-
Comme il est essentiel de préserver la littérature tahitienne
dans son style propre et sa simplicité primitive qui constituent son
plus grand charme, j'ai recueilli toute ma documentation telle qu'elle
m'était donnée de vive voix par les prêtres et les
conteurs, et j'ai été surpris de la beauté du langage et
de la richesse des mots et des tournures de phrases (métaphores).[36]
Cent cinquante ans plus tard, Flora Aurima-Devatine, dans les Tergiversations et Rêveries de l'Ecriture Orale, interroge l'acte d'écrire, à travers son propre "trac" d'écrivain issu d'une culture orale et imprégnée de sa langue maternelle. Elle admet que son livre :
-
peut sembler hermétique et déroutant à des personnes de
culture occidentale qui ne se représentent pas les difficultés
des Polynésiens face à l'écriture. Il est construit comme
un discours en tahitien. Mais finalement, c'est aux Polynésiens qu'il
s'adresse.[37]
-
D'écrire en français, serait-ce une atteinte à la
personnalité "ma'ohi", quelque chose comme un désaveu, une
transgression ou une trahison? / Pourquoi [...], dans la revendication de son
identité "ma'ohi", à tout crin, à tout cran, serait-il mal
venu, inadéquat, voire mal vu, peut-être interdit, pour un
Polynésien, d'écrire dans la langue vécue, jusque
là, comme étant celle de l'Autre?[38]
-
Le drame que vivent nos écrivains africains de langue française,
du fait de la dissemblance irréductible de deux langages dont aucun ne
peut les exprimer pleinement, se transporte sur le plan de la création
poétique. Les langues autochtones s'accordent avec tout ce que
l'Africain d'aujourd'hui porte en lui-même à son insu, les voix de
la terre, du ciel, et les voix mortes qui commandent depuis l'au-delà.
Le français met à leur disposition toutes les ressources mais
tout le charnel et le spirituel de la langue lui demeurant dans une grande
mesure étranger, l'Africain ne peut guère user de la langue
française que comme d'un outil purement intellectuel. [...] On
n'abordera à l'île solitaire, à l'étoile qui
sommeille au coeur du continent africain, ni par le jeu de la pensée
analytique, ni par les simulacres de la pensée descriptive.[39]
-
Un roman polynésien doit-être [sic] une création totalement
originale de l'esprit humain. Stevenson a tenté de faire de la
poésie avec Rahero: [...] je sens que le résultat n'est
pas en rapport avec tout le travail que cela a dû lui donner. Cependant
le sujet est bon, et les situations forcent l'attention. Je n'arrive pas
à trouver quelle erreur il a pu commettre dans son récit. Alors
où est le défaut?[41]
-
A parau!
A papa'i!
Ahani na!
Tei hea atura 'oe?
(Parle! Ecris! Voyons! Où en es-tu?)[42]
-
La littérature, aujourd'hui, est en elle-même un exil permanent.
Nul n'écrit parce qu'il se sent à sa place, mais, plutôt,
parce qu'il se sent déplacé. En écrivant, l'illusion de la
conquête d'un territoire devient présente, le territoire
lui-même devient présent; tout ce qui était avec soi dans
le lieu primitif est récupéré, tout ce qui était
loin retourne à sa place [...] Nous écrivons parce que nous avons
abandonné un pays primordial que nous ne pourrons jamais vraiment
récupérer.[43]
Notes
[1] Henry Adams. Lettres des mers du Sud, 1890-1891. Paris: Société des Océanistes, 1974, p.239.
[2] Robert James Fletcher. Lettres des mers du Sud. [Isles of Illusion. 1923] Paris; Minerve, 1989, p.203.
[3] Segalen. Essai sur l'Exotisme. OC, t.1, Paris: Bouquins Laffont, 1995, p.753.
[4] Voir O. Gannier. "D'Haïti à Tahiti: Amérindiens et Polynésiens", Miroirs de textes. Intertextualité et récits de voyage. Nice: Pub. Faculté des Lettres, 1998, pp.323-339.
[5] La Bibliographie de Tahiti et de la Polynésie Française établie par O'Reilly et Reitman (Société des Océanistes, 1967) a recensé plus de 10000 titres jusqu'en 1966, dont 1849 récits de voyage et 712 textes littéraires.
[6] Adams, p.285.
[7] Daniel Margueron. Tahiti dans toute sa littérature. Paris: L'Harmattan, 1989, pp.46-47.
[8] Romain Gary. La Tête coupable. Paris: Gallimard, 1968, p.33.
[9] Adams, p. 310.
[10] Marc Chadourne. Vasco. [1927], Polynésie, les Archipels du rêve. Paris: Omnibus, 1996, pp.753-754.
[11] Segalen rappelle dès son projet d' Essai sur l'Exotisme. [1918]: "L'exotisme est volontiers "tropical". Cocotiers et ciels torrides. Peu d'exotisme polaire". p.746.
[12] Chadourne. Vasco, p.709.
[13] Margueron, p.39.
[14] René Charnay [alias Claude Ener]. Le Solitaire du lagon Ed. France-Empire, 1979, p.46.
[15] Charnay, p.17.
[16] Adams, p.375, puis 349.
[17] Jean-Jo Scemla. Le Voyage en Polynésie. Anthologie des voyageurs occidentaux de Cook à Segalen. Paris: Bouquins Laffont, 1994; Max Radiguet pour les Marquises par exemple, dans les Derniers Sauvages, 1842-1857 ou Stevenson, Dans les mers du Sud évoquent aussi cette complaisance à l'idée de la mort.
[18] Gary, p.176.
[19] Renée Hamon. Aux îles de lumière. Paris: Flammarion, 1939, p.55.
[20] Charnay, p.45.
[21] Jean Reverzy, le Passage. [1954] Paris: Points Seuil, 1996, p.20.
[22] Henri Hiro. Entretien au magazine I Mua. 1980.
[23] Adams, p. 246.
[24] Alain Gerbault. Un paradis se meurt [1939], Paris, Hoëbeke, 1994. Eric Vibart justifie dans la préface cette figure encore controversée: "Les efforts d'Alain Gerbault furent avant tout consacrés à obtenir la reconnaissance de l'ancienne civilisation polynésienne, pour prouver en Europe que la Polynésie était autre chose qu'une anecdote tropicale." Des réformes similaires à celles qu'il proposait ont été instituées après guerre: "attribution de la citoyenneté française aux insulaires, pouvoirs locaux décentralisés aux mains des Polynésiens, enseignement du tahitien et de l'histoire océanienne dans les écoles des archipels et création d'une chaire de tahitien en France, renaissance des arts traditionnels, création d'une académie veillant à la pureté et l'évolution de la langue, habitat mieux adapté au climat, sauvegarde des sites anciens, [...] Gerbault à travers ce livre a pensé trente ans en avance dans le sens de l'histoire polynésienne." (p.18)
[25] Michou Chaze. Vai, la rivière au ciel sans nuage. Cobalt/Tupuna, 1990, p.11.
[26] Référence de toutes les reconstitutions mythologiques et culturelles; c'est l'oeuvre d'un missionnaire de la célèbre London Missionary Society. Société des Océanistes, 1993.
[27] Rui a Mapuhi. Lettre à Poutaveri. [nom tahitianisé de Bougainville]. Traduit du tahitien par Louise Peltzer. Papeete: Scoop, 1995. O'Reilly signale d'ailleurs déjà le même titre: il s'agirait ainsi d'une double réécriture.
[28] Daniel Thaly. Le Jardin des Tropiques, 1911.
[29] "Te tiare o te fenua" (Fleurs du pays) Tama, 1991.
[30] Poète et pasteur (1945-1990), il a beaucoup oeuvré pour le renouveau culturel et la revendication identitaire des Polynésiens, comme Alan Duff en Nouvelle-Zélande ou Albert Wendt aux Samoa.
[31] Vibart, préface à Un Paradis se meurt, p.19.
[32] pito : nombril.
[33] Comme Taaria Walker. Rurutu, mémoires d'avenir d'une île australe. Haere Po, 1999.
[34] fenua : territoire. Extraits de "Dans quelle langue écrire?" de Flora Devatine. Dixit. 1997, pp.146-150.
[35] Jimmy Ly. Hakka en Polynésie. Association Wen Fa, 1996, p.118. Il analyse aussi, dans d'autres textes romanesques, le statut de cette communauté chinoise, dont les premiers représentants sont arrivés au début du siècle pour travailler dans les plantations.
[36] Tahiti aux temps anciens, p.7, préface de 1848.
[37] Les Nouvelles de Tahiti, 17 novembre 1998.
[38] Flora Devatine. "Dans quelle langue écrire?", pp.146-150.
[39] Jean Amrouche, poète algérien, 1943, cité par Patrick Renaudot, "Ce lieu d'exil, la langue française" Magazine littéraire. no. 221, La littérature et l'exil. juillet-août 1985, p.37.
[40] Comme celle qu'écrit aussi Michou Chaze, par exemple, dans Vai.
[41] Adams, p. 261.
[42] Flora Devatine. Tergiversations et Rêveries de l'Ecriture Orale. Papeete: Au vent des îles, 1998, p.139.
[43] Mario Goloboff, écrivain argentin, petit-fils d'immigrants, exilé en France. Entretien Magazine littéraire. no. 221, La littérature et l'exil, p. 45.
Odile Gannier est Maître de conférences en littérature française et
comparée à l'Université
de la Polynésie Française. Elle est membre du laboratoire de recherche I'A
(langues,
littératures, cultures) et poursuit ses recherches
essentiellement autour de la littérature francophone et de la littérature de voyage (théorie du
genre avec
un ouvrage à paraître aux Editions Ellipses: La
Littérature de voyage).
Sur des thèmes voisins de l'Exil, quelques articles en particulier
portent
sur "l'île voyageuse" (D'Île en Île Pacifique coll. sous
la dir. de S.
Dunis, Klincksieck, 1999), sur un parallèle "d'Haïti à
Tahiti: Amérindiens
et Polynésiens" (Miroirs de textes réunis par S. Linon-Chipon,
V.
Magri-Mourgues, S. Moussa, Pub. Fac Lettres Nice,1998), et plusieurs
articles sur la représentation de l'Autre, (en particulier des
Caraïbes à
la Renaissance: sur Colomb en 1998, sur Léry en 1999 dans
L'Information littéraire etc.) On relèvera aussi "Les manuscrits retrouvés dans de vieilles malles peuvent-ils encore être authentiques ? Le cas des Cahiers de Le Golif, dit Borgnefesse, capitaine de la flibuste". En ligne. Fabula (2001).
Back to [the top of the page] [the contents of this issue of MOTS PLURIELS]