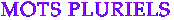
No. 13 - April 2000.
https://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP1300edito.html
[Version française] [English version]
***
New African Perspectives
This issue of Mots pluriels is the first to appear in the new
millennium. Many African and other world cultures, of course, measure time in
ways different than batches of 1,000 years beginning from the inauguration of
the Christian era. However, the articles presented here cover a wide breadth of
disciplines and themes across a range of African countries and together take
stock of African scholarship at this important crossroads. The contributions are
united in their common focus on contemporary issues and thus provide
considerable insight into the problems and prospects of Africans at the present
and in the immediate future.
Nearly all the articles were delivered at the International Conference on New
African Perspectives: Africa, Australasia, and the Wider World at the End
of the 20th Century, held in Australia in November 1999 under the auspices
of the African Studies Association of Australasia and the Pacific, and
attracting papers from some 35 countries. Among the authors included in our
issue, more than 12 countries are represented, the majority of them based in
Africa. The articles are arranged in two main sections -- "Literatures &
Languages" and "Society, Globalization, and Transformation" -- within which
there are sub-sections treating different themes.
Whilst the articles of this section are arranged in three parts -- Francophone
Literatures; Image, Conflict and Tyranny; South African Literatures &
Languages -- they have common themes, among which the issues of identity,
oppression, protest, liberation, and reconciliation are prominent.
The group of South African-oriented articles focus on the literatures and
languages of "the New South Africa", yet the issues they raise often also are
relevant to the rest of the continent. William Bostock, in his article "South
Africa's Language policy", shows how languages are linked to government
management of what he calls a "collective mental state". The important
relationship of languages and identity that he addresses is a matter also
debated in many places in Africa today. Sue Kossew entitles her piece
"Something Terrible Happened". An acknowledgement of this "terrible happening"
has led contemporary authors to be "concerned with issues of guilt, punishment,
retribution, confession and violence". Her article deals with the politics of
violence and recovery in The House Gun by Nadine Gordimer, but these
themes extend beyond the work of only one author. It is a feature that cuts
across race, class and gender as shown by Kristof Haavik's article titled "A
view from the ground: the new South Africa in its own literature". Blacks,
women and other 'minorities' have been hard done by and "ghosts cannot be
exorcised by ignoring them", Haavik argues.
Such themes are also to be found in Angèle Bassole's feminist analysis
of the condition of African women. Luc Renders, in "The Depiction of Khoisan in
contemporary Afrikaans historical novels", analyses a similar issue, asking the
question: 'How to deal with Afrikaner history in contemporary Afrikaans
literature?'. In addition, how should we "negotiate" the history of people who
have been, in the words of Pippa Skotness, cast out of time, out of politics
and out of history?
This question echoes preoccupations common to the whole of Africa and indeed
the world. What is required is nothing short of a thorough revision of the
still dominant "master-narrative history", its myths of colonial conquest, its
silences and its distortions. Peter Mwikisa's debunking of Western
interpretations of "Conrad's Image of Africa" in Heart of Darkness
belongs to this enterprise. So too does Solà Adéyemi's "Dictating
currents and the questioning of Tyranny in Africa", in which he seeks to
give voice to Fémi Osófisan's call for "a new generation with a
vibrant and restorative ideology". This preoccupation is echoed by Mbuyamba
Kankolongo in his article devoted to Congolese short stories written by the
authors Maliza and Yoka who "stress their desire to fight for a vision of the
world that calls for fundamental changes in their society's values".
Isabel Moutinho examines how contemporary Portuguese fiction set in Angola,
Mozambique and Guinea-Bissau still evokes the memory of colonial wars,
rejecting Portuguese colonialism and -- particularly in the case of novels
written by women -- an attitude of openness to the African otherness, and of
sympathy for black victims of colonialism. Such fiction, she argues, is the
literary expression of a will for reconciliation between coloniser and
colonised.
Whereas the majority of articles in this section seem to be concerned with a
dichotomic view of the world inhabited by an "other" that is difficult to
handle, in contrast, Sylvie Kandé's "Jazz and littérature
africaine" proposes a kind of "syncretic complementarity". Her study
investigates "the intimate relationship between jazz and francophone literature
that expresses the human condition, black until the 1960s, metisse since
postcolonial time".
June Bam provides a case study of the suppression of historical consciousness
in schools as manifested in curricula and relates this to the politics of
negotiation, reconciliation and globalisation. Her own involvement in efforts
by black writers to break out of the domination by white-owned publishing adds
fascinating insights, and is relevant to future trends in the teaching and
writing of history in South Africa. Kwasi Darko-Ampem also addresses the fate
of African publishers. He argues that "the book industry is the bedrock in the
promotion of literacy and education in African countries", and details advances
made across Africa in schemes such as national book development councils, the
Noma Award, and the African Book Collective. He warns that multinational
publishers threaten the local book industry and urges the creation of national
book policies. Camille Ekomo Engolo also discusses globalisation and education,
but offers instead a continent-wide analysis of the dilemmas of African
universities today. They remain trapped in the paradigm of modernity at a time
when globalisation seeks to construct a new social contract centred on
"hyper-competivity".
Despite the claims of its proponents, globalisation is contested the world
over, as seen vividly in the disputes at Seattle in late 1999. Michael Meyer
explains when, why and how the ANC government of South Africa came to embrace
neo-liberalism, and how globalisation has altered alliances and brought grim
social, political, economic and environmental consequences. Also writing on the
ANC, Phil Mtimkulu describes how it has, since winning the first democratic
elections in 1994, been frustrated in its attempts to overcome the inequalities
of apartheid. He argues that the ANC, after the second election in 1999, wishes
to speed up transformation but its dominance also means that there is a danger
that democratic values may be eroded.
Globalisation has also impacted upon the labour and investment markets. Wim
Pelupessy argues that the need to operate in global markets has accelerated
industrial restructuring in post-apartheid South Africa. He provides a detailed
case study of the LekoaVaal industrial area that suffers economic stagnation
and bleak job prospects for township dwellers, and makes concrete proposals to
overcome these problems. Elsabé Loots analyses and accounts for recent
trends in foreign direct investment flows to African countries, which have
dropped substantially over the past two decades, and examines future prospects
for these flows to Africa.
Keith Beavon, in an article well illustrated with photographs and maps, lays bare the
changing urban geography of Africa's richest city, Johannesburg. Under
apartheid, black people were excluded from enjoying the fruits of what was for
white people a genuinely world-class central city district. Yet now they have
inherited little more than a steel and concrete shell, whilst the rich northern
suburbs resemble a neo-apartheid enclave: which may jeopardise the long-term
social stability of post-apartheid society.
As we read Mots pluriels on a computer screen, some of us may wonder
what the Internet really means in Africa today? Darrell Parsons and T.Z. Nkgau
investigate the use of the Internet for development in Botswana. At the
millennium, major problems in the deployment and effective use of information
technology in Africa still severely restrict its benefits. Botswana has
politico-economic advantages over many African countries, yet it shares with
them problems of a general lack of technical knowledge within organizations and
the wider community.
The New African Perspectives conference was held in Australia and it is
perhaps appropriate that the last (but no means least) chapter deals with
African-Australian relations. Gary Mersham investigates, against a backdrop of
increasing globalisation, how Australians and South Africans share not only
common regional imperatives and problems of multiculturalism and identity, but
also strategic areas of discord and contested terrain. He argues that the two
countries will become increasingly linked through unfolding networks of trade
and geopolitical concerns in the Indian Ocean.
Following the papers, we include Professor Djibril Samb's speech accepting the
1999 Noma Award for Publishing in Africa for his book
L'interprétation des rêves dans la région
sénégambienne, held during the New African Perspectives
conference. This is followed by two interviews. The first was realised with Professor Djibril
Samb shortly after the ceremony organised in his honour in Perth. The second is an interview of Neurologist and Haitian author Jean Métellus proposed by Jean-Marie Salien.
Good reading!
Peter Limb and Jean-Marie Volet
[Top] / [Table of Contents of this issue of MOTS PLURIELS]
Les articles relatifs à l'univers sud-africain mettent l'accent sur "La Nouvelle Afrique du Sud". Ils soulignent les problèmes linguistiques et littéraires auxquels le pays doit faire face. Toutefois, les questions soulevées ne s'arrêtent pas aux frontières de l'Afrique du Sud et elles sont pertinentes à l'ensemble du continent. Dans son article "La politique linguistique de l'Afrique du Sud: contrôle et statut", William Bostock explore par exemple le rôle de la langue et les prérogatives de l'Etat dans les mécanismes identitaires. Cette problématique importante a été -- et est encore -- l'objet de discussions animées non seulement en Afrique du Sud mais dans l'Afrique toute entière. De même le titre de l'article de Sue Kossew "Something Terrible Happened"[Il s'est passé quelque chose de terrible] pourrait fort bien être appliqué à plusieurs pays africains. Dans son texte, Sue Kossew souligne que les auteurs sud africains contemporains sont souvent préoccupés par les thèmes de la culpabilité, de la punition, de la vengeance, de la confession et de la violence. Cette dernière, dit-elle dans un article qui analyse The House of Gun de Nadine Gordimer, n'est pas propre à une classe sociale donnée mais elle envahit tous les milieux. La violence devient une sorte d'expérience collective et traumatisante qui affecte aussi bien l'individu que la société. Kristof Haavik en arrive à un constat similaire dans son étude "A view from the ground: the new South Africa in its own literature". De plus, ajoute-t-il, les Noirs, les femmes et d'une manière générales les minorités ont été défavorisées et le fait d'ignorer les injustices passées ne permet pas d'en éloigner le spectre.
Dans son article "Les mémoires absentes! femmes, Afrique, parole et écriture", Angèle Bassole développe un thème similaire. Elle souligne l'invisibilité des femmes et relève "l'absence de mémoires féminines dans l'Histoire africaine". Luc Renders quant à lui, souligne la nécessité d'un re-cadrage de la littérature afrikaans et d'une approche critique des romans historiques contemporains . Prenant comme point d'appui les Khoisan et une exposition de Pippa Skotness, il souligne combien il est difficile de dire l'histoire d'un peuple qui a été systématiquement rejeté en marge du temps, de la politique et de l'histoire.
Une telle préoccupation se retrouve non seulement à l'échelle de toute l'Afrique, mais aussi à celle du monde. Elle exige une remise en question fondamentale des schémas historiques dominants, des mythes associés aux conquêtes coloniales, des silences et des distorsions dont elles se sont nourries. La relecture de l'oeuvre de Conrad, Heart of Darkness, proposée par Peter Mwikisa et l'article de Solà Adéyemi "Dictating currents and the questioning of Tyranny in Africa" participent à cette entreprise. L'oeuvre de Conrad vilipende la sensibilité des Africains, suggère Peter Mwikisa, et il est temps d'analyser dans une perspective africaine et de manière critique la signification de cet ouvrage qui est loin d'avoir l'aura dont on l'a parée. A l'inverse, suggère Adéyemi, l'oeuvre de Fémi Osófisan exprime une très grande affinité avec l'Afrique d'hier et d'aujourd'hui. Elle représente une lutte inlassable contre les tyrannies et propose une idéologie propre au renouveau. Des propos similaires conviendraient d'ailleurs assez bien à Maliza et Yoka, deux auteurs dont parle Mbuyamba Kankolongo dans son article sur la nouvelle en République démocratique du Congo et dont il dit: "tous deux se font les défenseurs d'une vision du monde faisant appel à un changement radical des valeurs de la société".
L'article d'Isabel Moutinho consacré à la littérature portugaise traitant de l'Angola, du Mozambique et de la Guinée-Bissau, examine la manière dont plusieurs romans contemporains évoquent le souvenir de l'époque coloniale en en rejetant les prémisses. Chez les auteurs femmes, dit-elle, on trouve, souvent une grande ouverture et une grande sensibilité vis à vis des populations noires victimes de la colonisation. Les romans analysés, poursuit-elle, expriment de manière indéniable une désir de réconciliation entre colonisés et colonisateurs.
Alors que la majorité des articles proposés dans cette section approchent l'altérité par le biais d'une dichotomie expliquant peu ou prou les difficultés de compréhension entre les individus, Sylvie Kandé envisage au contraire la question sous l'angle d'une "complémentarité syncrétique" des cultures et des arts qui dans leur souplesse favorisent les rencontres et le métissage. S'inspirant d'une note de Matisse accompagnant une planche de Jazz , son étude "Jazz et littérature francophone" analyse de manière élégante et érudite les processus créatifs/réceptifs qui résultent de la rencontre des hommes, des arts et des idées indissociables de la condition humaine.
L'article de June Bam souligne par exemple une perte de conscience des phénomènes historiques qui frappe les élèves sud-africains. Son étude de cas souligne l'impact d'une démarche politique dominée par l'idée de réconciliation, de négociation et de globalisation sur le plan d'études des lycées sud-africains. La participation de Bam aux efforts de libération des auteurs noirs face au carcan imposé par les maisons d'éditions blanches ajoute la force de l'expérience à sa manière de voir le futur de l'écriture et de l'enseignement de l'histoire en Afrique du Sud.
De son côté et d'une manière plus générale, Kwasi Darko-Ampem soulève les problèmes liés à l'édition et à l'industrie du livre en Afrique. Il relève nombre d'initiatives positives telles que les "National book development councils", le Prix Noma et l'"African Book Collective" mais il souligne également la menace que font peser les multinationales sur la viabilité des industries locales du livre et il souhaite la mise sur pied de politiques du livre nationales.
Les effets de la globalisation affectent tous les domaines d'activité humaine, y compris l'éducation et Camille Ekomo Engolo s'attache à montrer les dilemmes auxquelles l'Université africaine doit faire face aujourd'hui. Prise en tenailles entre le non fonctionnement et l'hyper-compétitivité , elle a peine à trouver sa voie. La relation de dépendance que lui impose l'Ouest limite son champ d'action et ne lui permet pas de réconcilier rationalité économique et missions traditionnelles.
Pour une écrasante majorité de la population du monde, la globalisation est loin d'avoir tenu ses promesses et il n'est guère étonnant qu'elle soit remise en cause non seulement en Afrique mais aussi ailleurs. A preuve, les récents événements qui se sont déroulés à Seattle à la fin de 1999. Dans son article Michael Meyer analyse les raisons qui ont poussé l'Afrique du sud à embrasser les idéaux néo-libéraux et les graves conséquences socio-politiques, économiques et environnementales qui en ont résulté. Phil Mtimkulu aborde le même sujet et évoque la frustration de l'ANC qui, après avoir gagné les premières élections démocratiques de 1994, a eu grand peine à réduire les inégalités née du régime d'apartheid. A la suite des élections de 1999, l'ANC entend accélérer les processus de transformation mais, suggère Mtimkulu, une telle accélération court de risque de limiter les valeurs démocratiques.
Qu'on le veuille ou non, la globalisation a eu un impact considérable sur le marché du travail et sur les investissements. S'appuyant sur une étude minutieuse de la région industrielle de LekoaVaal, Wim Pelupessy suggère que la nécessité d'opérer dans un marché global a accéléré les restructurations industrielles d'Afrique du Sud. Face à la stagnation économique de la région et à la précarité de l'emploi des habitants des Townships, il propose un certain nombre de mesures qui, selon lui, permettraient d'améliorer la situation. Dans un article intitulé "Foreign direct investment flows to African countries: Trends, determinants and future prospects", Elsabé Loots analyse la question sous l'angle de la diminution des investissements et des capitaux étrangers en Afrique, au cours de ces dix dernières années, et elle examine dans quelle mesure il semble possible d'inverser cette courbe descendante.
Agrémenté de plusieurs cartes et illustrations, l'article proposé par Keith Beavon analyse la géographie urbaine de Johannesburg -- la plus riche métropole d'Afrique -- et son évolution au cours du siècle. Alors qu'à l'époque de l'apartheid, les populations noires était exclues du Centre ville, elles héritent aujourd'hui d'une forêt de béton et d'acier alors que se développent dans les quartiers riches du nord, des enclaves d'opulence que l'on pourrait qualifier de neo-apartheid. A long terme, ce déplacement des richesses qui ne résout en rien les inégalités risque fort d'ébranler la stabilité de la société post-apartheid.
L'idée d'inégalités ne s'arrêtent d'ailleurs pas aux limites du logements ou du revenu. Il est aussi lié à l'accès au savoir et, de nos jours, à l'informatique. Les lecteurs de Mots pluriels consultant ce numéro sur l'écran de leur computer, se demanderont peut être le rôle que jouent les nouvelles technologies dans l'Afrique d'aujourd'hui. Darrell Parsons and T.Z. Nkgau font le point de la situation au Botswana et relatent les difficultés qui limitent l'usage des outils informatiques et d'Internet. Bien que le Botswana bénéficie de conditions politico-économiques enviables, le pays souffre néanmoins des maux commun à l'ensemble du continent et l'électronique reste tout à fait inaccessible à une large proportion des individus et des collectivités locales.
Le dernier article de ce numéro spécial, proposé par Gary Mersham, est particulièrement intéressant dans la mesure où il offre une image de l'Australie vue d'Afrique. Alors que la Conférence New African Perspectives se tenait à Perth et que les regards étaient résolument tournés vers l'Afrique, Mersham observe les relations de l'Afrique du Sud et de l'Australie d'un point de vue sud-africain. En dépit de de ce qui les sépare, dit-il, ces deux pays ont beaucoup en commun et les pressions d'ordre économique et géopolitique les rapprochent de manière inéluctable .
L'ensemble des articles est suivi d'une transcription du discours du Professeur Samb, lauréat du Prix Noma 1999 pour son ouvrage L'interprétation des rêves dans la région sénégambienne et de deux interviews. L'une de ces interviews proposée par Jean-Marie Salien a été réalisée à Paris avec Jean Métellus, neurologue et auteur d'origine haïtienne. La seconde a été réalisée avec le professeur Djibril Samb à l'occasion de son passage à Perth lors de la remise du Prix Noma.
Bonne lecture.
Peter Limb et Jean-Marie Volet
[Haut de la page] / [Table des matières de ce numéro de MOTS PLURIELS]