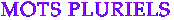
no 13 - April 2000.
https://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP1300syk.html
© Sylvie Kandé
Sylvie Kandé
New York University
J'aimerais placer en exergue de mon propos la première des notes de Matisse dans Jazz -- une série de vingt compositions faites de planches de couleur auxquelles sont apposées des pages d'écriture, publiée par Tériade aux lendemains de la seconde guerre mondiale. La voici:
-
Pourquoi après avoir écrit 'qui veut se donner à la
peinture doit commencer par se couper la langue' ai-je besoin d'employer
d'autres moyens que ceux qui me sont propres ? (9-10)
Cette interrogation génère d'ailleurs plusieurs réponses, offertes graduellement dans la suite des notes de Jazz par Matisse lui-même. Son immédiate impulsion, c'est d'annoncer qu'il a voulu créer un "rapport décoratif" en intercalant entre les planches de couleur, de l'écriture: "ces pages qui servent d'accompagnement à mes couleurs" écrit-il...[ont donc un rôle] purement spectaculaire" (18-21). Plus loin, Matisse suggère que l'écriture, non plus simple adjuvant à la couleur, est à comprendre comme un élément implicitement comparé dans un système métaphorique. On devine en effet que c'est le même geste, le même élan de la main ("découper dans la couleur", "dessiner avec des ciseaux") qui de l'informe et de l'indilué, fait surgir formes de papier et formes calligraphiées -- le double évidage de la matière créant des lignes intelligibles d'encre ou de papier. Enfin, dans le texte qui accompagne la composition nº 20, elle-même intitulée "Jazz", Matisse en arrive à un ultime degré d'interprétation ainsi formulé:
-
J'ai fait ces pages d'écriture pour apaiser les réactions
simultanées de mes improvisations chromatiques et rythmées, pages
formant comme un fond sonore qui les porte, les entoure et protège ainsi
leurs particularités. (142-145)
-
La toile a ses parties brillantes, ou peut-être, en langue de jazz, ses
parties hot opposées à un ensemble cool...
Opposition, si l'on veut, de parties 'sacrées' où règne
une effervescence et de parties 'profanes' -- les plus étendues --
où il ne se passe rien. (744)
De ces remarques préliminaires, deux points sont tout particulièrement à retenir. D'abord, l'intuition, partagée par Leiris, Matisse, d'autres peintres comme Stuart Davis ou Romare Bearden, que certains tableaux s'analysent mieux en référence aux intervalles de jazz. Cette idée trouve un écho dans la brillante formule de Yannick Sétié "A dire la peinture, les mots de la peinture (fond, aplat, monochrome, saturé) s'avèrent insuffisants"(12). Autre point d'importance: l'examen par approfondissements successifs que fait Matisse du rapport entre deux media dont il organise l'intersection -- juxtaposition, métaphore, synesthésie -- et qui lui arrache finalement le terme de "jazz". Ceci pourrait me servir de boussole pour l'exploration du thème "Jazz et littérature francophone": le jazz comme thème, comme métaphore et comme écriture.
Un caveat avant de m'y engager, et c'est encore Yannick Sétié qui me l'inspire:
-
Toujours et encore, du jazz et de la littérature, il faut d'abord
rappeler ceci: ils sont deux. Il y a le jazz. Il y a la littérature.
Inlassablement... Ce n'est qu'une fois que ce rappel a pris la puissance d'une
conviction qu'il devient possible d'admettre que les relations entre le jazz et
la littérature existent potentiellement en un nombre infini et se sont
de facto incarnées, au fil d'un siècle d'existence de cette
musique, de mille façons. (7)
Jazz et littérature francophone: le sujet n'est guère balisé, et c'est dans ce quasi-vacuum que s'inscrivent mes réflexions. En effet, je n'ai pu répertorier que trois articles sur la question:
- celui de El Hadj Amadou Ndoye dans Atlantiques, une revue
publiée par le centre Régional des lettres d'Aquitaine (1997) et
qui porte sur le recueil d'Emmanuel Dongala, Jazz et Vin de Palme.
- celui de Kathleen Gyssels dans un numéro spécial
d'Europe 1997, sur l'oeuvre de Daniel Maximin.
- celui de F. Nick Nesbitt dans Littéréalité (1998)
sur Maximin également.
En revanche, il existe quantité de textes qui examinent la relation entre jazz et littérature africaine-américaine, jazz et littérature française, et même jazz et littérature caribéenne anglophone. Vient immédiatement à l'esprit l'étude de Leroi Jones/Amiri Baraka, Blues people. The Negro experience in white America and the music that developed from it, qui traite du champ de forces historiques et sociales d'où émergent le blues et l'une de ses excroissances, le jazz. Dans Blues, Ideology and Afro-American Literature, Houston A. Baker, Jr imagine la combinaison des conditions matérielles liées à l'esclavage et les rythmes du blues comme une matrice vivante et protéiforme d'où surgit une puissante créativité, et dont la (re)connaissance est, dit l'auteur en substance, la condition de l'inscription des Afro-Américains dans les géographies de l'Amérique (4) ainsi que leur réinscription dans une histoire littéraire américaine reconfigurée.
En ce qui concerne la relation jazz/littérature française, on consultera avec profit le numéro spécial des Cahiers du Jazz sur la question (nº4, 1994). L'article de Philippe Fréchet, subdivisé en genres (Romans et essais. Poésie) répertorie les occurences du jazz, comme thème, dans la littérature française, depuis Scènes de moeurs et voyages dans le Nouveau Monde (Paris: Poulet-Malassis, 1862), un récit de voyage dans lequel Xavier Eyma décrit les processions funébres à la Nouvelle-Orléans -- à une époque où le mot jazz n'existait pas encore -- jusqu'à des textes très contemporains tels que ceux de Michel Boujut, Alain Gerber et Jacques Reda.
Je m'arrêterai un instant sur le long essai de Kamau Brathwaite "Jazz and the West Indian Novel", objet d'une double republication, après une parution initiale dans la revue BIM en 1967-68. C'est qu'il concerne une aire tout particulièrement multiphone, la Caraïbe, et dont chaque île, quelle qu'en soit la langue officielle, reste poreuse à ses voisinages linguistiques. Constatant l'absence de jazz dans une région qui a pourtant connu, comme les Etats-Unis, le système plantationnaire, Brathwaite dégage quelques-unes des conditions de possibilité de l'émergence de cette musique. Il cite l'étendue territoriale qui permet de longs déplacements, ponctués par des stations dans de larges centres urbains. Essentielle à la formation du jazz est aussi la présence turbulente d'une minorité au sein d'un groupe dominant. Le jazz, c'est encore le jeu entre mouvement et fixité, entre ordre et chaos; une musique qui se donne une fonction libératrice. "L'écrivain caribéen vient tout juste d'entrer dans sa Nouvelle-Orléans culturelle à lui" (R 63) écrit Brathwaite qui s'essaie à théoriser un shift au moment où il se produit, c'est à dire quand la littérature caribéenne semble prête à prendre en charge ce qui n'est pas assumé par la musique régionale, le calypso et le ska, notamment. Brathwaite s'attache ensuite à montrer dans des textes choisis (Brother Man de Roger Mais, par exemple) la connection, encore embryonnaire, "ou plutôt la correspondance entre le jazz (l'expression nègre américaine à base africaine) et l'expression nègre caribéenne à base africaine" (61). Il repère en particulier des effets littéraires calqués sur les techniques du jazz: improvisation, thème répété ou riff, structure antiphonale ou appel-répons.
Lectrice de Brathwaite, Kathleen Gyssels montre que c'est l'oeuvre de l'écrivain guadeloupéen Daniel Maximin qui réalise cet idéal le plus complètement, avec une présence du jazz et des musiques noires de plus en plus organiquement intégrée au texte, d'un roman à l'autre: L'Isolé Soleil (1981), Soufrières (1987) et L'Ile et une nuit (1995). Si, dans l'Isolé Soleil, le jazz et plus précisément "Body and Soul", le chef-d'oeuvre de Coleman Hawkins, sert de toile de fond à la rencontre de Simea et d'Ariel le musicien, dans Soufrières, le jazz deviendrait le principe structurel de l'écriture, à la manière de Toni Morrison dans... Jazz. Maximin fait ainsi usage de la citation en manière d'hommage, de la répétition traduite dans la dimension de l'espace ou dans celle du temps; le rythme est créé par une langue parlée, créolisée, syncopée, désyntaxée. L'appel à la participation du public et la polyphonie donnent au texte une structure antiphonale. Lorsque Gyssels conclut "Pour Maximin, il est clair que c'est par la musique que les Africains dispersés à travers le monde peuvent se tendre la main" (132), elle a suffisamment démontré que l'oeuvre (francophone) de Maximin participe de ce projet panafricain envisagé par Brathwaite. Ainsi s'explique le titre qu'elle a retenu pour son texte: "Le jazz dans le roman afro-antillais. Consonances de la diaspora noire dans l'oeuvre de Daniel Maximin".
Tout emblématique qu'elle paraisse de l'éventail des relations jazz/littérature -- thématique, métaphorique et stylistique -- l'oeuvre, remarquable, de Maximin n'est cependant pas unique de ce point de vue. Mais sérions. Dans le corpus africain et caribéen francophone, repérer le jazz comme thème est une tâche relativement aisée. On peut en effet isoler ici et là le profil d'un musicien, un lieu du jazz, l'éclat d'une trompette, voire la transcription des vers d'un blues. On s'en souvient, le jazz est discrètement présent, mais persistant, dans la poésie de Senghor. Le poète inscrit répétivement la nostalgie qui embrume son exil à Paris dans le cadre immense et tragique de l'exil collectif des Africains déportés puis mis en esclavage sur un sol étranger, double désastre dont témoigne indirectement le blues. Chants d'ombre bruisse de ce blues-là, de ce jazz-là -- termes plus ou moins équivalents dans le lexique senghorien -- qui sont évoqués en des vers devenus fameux: "le jazz orphelin qui sanglote sanglote sanglote sanglote" ("Joal");"Joue-moi la solitude, Duke, que je pleure jusqu'au sommeil ("Ndesse ou blues"), etc. Parfois Senghor entend le jazz comme une clameur de révolte en face de la division implacable de la société américaine -- du monde -- en deux raisons: celle de la blancheur, de l'aisance et de la stérilité, par opposition à celle de la Négritude, de la misère urbaine et de la créativité joyeuse (cf "Emeute à Harlem"[2]). Ses accents sont alors proches du lyrisme inquiet avec lequel Bernard Dadié relate Harlem dans son Patron de New York :
-
Voilà qu'enfin va sonner le glas du jazz, ce tapage que fait Harlem
pour tenir New York éveillée. Danse guerrière, danse
tropicale qui met tout le monde en transes, cris lugubres lancés dans la
nuit new yorkaise par ceux qu'on assassine à l'angle d'un bloc!
Harlem des church à entretenir l'espoir et des cafés pour tromper la faim...! Jazz de Harlem, jazz de protestation et de combat! Artistes de Harlem, hérauts de tous ceux qui sont disparus dans les océans de coton et de tabac! Filles de Harlem, filles montant la garde dans une immense rizière aux bas-fonds pleins de musique pour travailleurs de force. (149-150)
L'autre lieu privilégié du jazz en littérature, c'est le cabaret, la cave ou le bar, dont l'évocation suppose de la part du narrateur une attitude plus activement participatoire que les promenades méditatives de Senghor et de Dadié. C'est l'espace utopique et nocturne où l'homme bafoué se transforme en démiurge inspiré. Ainsi Art Wiggins, apparait dans l'anonymat d'une aube new-yorkaise à Richard Ndiaye Jefferson -- le narrateur principal du roman Mestizo d'Elizabeth Delaygues -- comme, confie ce dernier "... le nègre le plus laid que j'eusse jamais vu", de surcroît affligé d'une myopie extrême et d'"un instrument de musique en bandoulière, retenu par une ficelle"(30). Pourtant, ce saxophoniste introduira dans l'univers magique du jazz le même Richard, tout soudain exalté :
-
Cette musique me soulevait de mon siège. Les mains du pianiste me
fascinaient, les musiciens resplendissaient. Ils devinrent une source de joie
là où je n'attendais que misère, où le froid me
transperçait, où l'injustice et le mépris paraissaient sur
le point de m'anéantir. (30)
-
Chaque fois, elle s'était sentie moins à sa place dans ce temple
où l'on ne tolérait qu'une seule passion: la musique. Dans
l'odeur de la fumée et des alcools forts, les fidèles
étaient là à dodeliner de la tête, à battre
des mains en mesure, puis brusquement, comme saisis, à pousser des cris
aigus et à applaudir avec fièvre... En jouant [Stanley] avait
l'air de souffrir autant qu'un martyr. (79)
Passant des lieux aux figures du jazz, on pourrait procéder à un inventaire identique. Il suffira sans doute de mentionner quelques portraits littéraires de musiciens fictifs ou créés à partir d'individualités historiquement attestées. Par exemple, le Louis Amstrong de Jean-François Brière est célébré dans son recueil poétique, Sculptures de proue, à la fois comme dandy et messie, comme l'amant fougueux de sa trompette en tous cas. John Coltrane a inspiré à Emmanuel Dongala une nouvelle intitulée "A Love Supreme". Il s'agit d'une sorte de témoignage hagiographique autour d'un homme évoqué dans le texte par de simples initiales, J.C., qui contribuent à sacraliser le souvenir d'un musicien en perpétuelle quête d'un au-delà, en constant va-et-vient entre foi et désespoir. Lorsqu'il s'éteint, J.C./John Coltrane, figure de l'après-bop, tenté par le free-jazz, plus qu'Icare, grand mystique, emporte avec lui la lumière:
-
Il faudrait d'abord bien comprendre ce que JC et la musique signifiaient
désormais pour moi et mes amis. Le jazz était la chose, le lieu,
la galaxie autour de laquelle s'organisait notre vie, et au centre de cette
galaxie se trouvait comme un soleil, J.C. (150)
Le jazz, en tant que thème, est donc -comme d'autres -- présent dans la littérature francophone et l'on pourrait s'en tenir à cela, si on voulait considérer jazz et littérature francophone dans le rapport décoratif dont parlait initialement Matisse, quand il comparait:
-
Les pages qui servent d'accompagnement à mes couleurs à des
asters qui aident dans la composition d'un bouquet de fleurs d'une plus grande
importance. (18-21)
-
Le blues est une langue qui parle l'opacité et l'invisibilité du
corps noir, en exhibe et en cache (double entendre) la sexualité,
sublimation par laquelle le Noir américain s'est imposé dans la
culture de notre monde, donnant au passage sa facture à la musique
populaire d'aujourd'hui." (Dictionnaire 130)
-
C'est seulement lorsque [les mots] ont dégorgé leur blancheur qu'il les adopte,
C'est seulement lorsque [les notes
faisant de cette langue en ruine un superlangage solennel et sacré, la Poésie.
faisant de cette langue en ruine un superlangage solennel et sacré, le Jazz (xx)
Ce référent africain du jazz a été évalué différemment selon les époques et les intentions idéologiques. Le jazz, à son arrivée en France (vers 1917, date des premières performances du batteur Louis Mitchell, bientôt suivies par celles de James Reese Europe et d'autres orchestres de régiments africains-américains[3]) est compris comme une musique nègre, donc africaine. A l'égal de toute chose nègre, le jazz jouit à l'époque d'un engouement du public et de l'avant-garde, justifié ô combien ! et pourtant reposant sur une série de malentendus. Ainsi l'amalgame de l'art africain et océanien "découvert" par les cubistes, avec la danse nègre dont Joséphine Baker, star de la Revue Nègre, devient l'icône; et même avec une littérature nègre représentée par le Batouala, véritable roman nègre de René Maran, couronné par le prix Goncourt en 1921, et ultérieurement revendiqué par la Négritude comme un de ses textes fondateurs. Ainsi encore la conception du jazz comme remède aux plaies laissées par la guerre, comme exutoire au désir de "candeurs sauvages" et de possessions dont le site mythique est imaginé quelque part en Afrique, selon les propos de Leiris dans l'Age d'Homme:
-
Première manifestation des nègres, mythe des edens de couleur
qui devait me mener jusqu'en Afrique et par-delà l'Afrique,
jusqu'à l'ethnographie. (162)
-
La rumba était plus douce que le jazz, Celui-ci avait un charme et une
fascination qui se mesuraient en "kilowatts". Son vertige contagieux agssait
directement sur les nerfs à la manière d'un circuit
électrique tandis que la rumba trouvait des échos dans le coeur.
Le jazz déchaîné évoquait les avions bolides, la
ronde frénétique d'une hélice de transat. La rumba
évoquait une fille noire se balançant dans son hamac, à la
tombée des soirs, bercée par la complainte d'une guitare. (62)
S'engouffrant dans la trouée des années de l'entre-deux-guerres, tout en se désengageant radicalement de leur exotisme simplificateur, le mouvement de la Négritude élabore un contre-discours qui s'inspire beaucoup du jazz -- théâtralisation (pas nécessairement mercenaire) de la condition du Nègre dans le monde, exposée dans ce qu'elle a de plus désespéré, de plus moderne, vécue avec suprême élégance et ironie. Le principe d'équivalence métaphorique posé par Matisse qui dessine avec de l'encre comme il dessine avec des ciseaux, éclaire le topos littéraire qui émerge à l'époque, reposant sur l'échange possible de qualités implicitement comparées entre sujets, le musicien de blues/jazz à son instrument et le poète de la Négritude sur sa page. La nécessité d'exprimer une condition humaine résultant de circonstances historiques spécifiques dans un langage (le français ou la musique) qui veut transcender le particulier vers l'universel, donne à ces textes leur force révolutionnaire. Pour le poète de la Négritude, c'est le blues qui en vient à représenter cet idéal de conjonction entre universel et particulier, car il est
-
... une infinie répétition par laquelle l'homme s'interroge sur
lui-même dans un état d'âme, et d'esprit, et d'humeur, que
créent le doute de soi et la proximité sue, connue, voire
éprouvée de la mort. Et le blues est la résolution de cet
état, projetant avec les moyens du bord une vision du monde, une
philosophie qui le rend au moins provisoirement possible, et qui inscrit la
solitude dans l'universel. (Dictionnaire 130)
Sans surprise, la revue Présence Africaine, qui comptait le producteur et critique de jazz Hughes Panassié parmi les membres de son comité de soutien, a consacré, de façon relativement régulière, une de ses rubriques au jazz. Derrière le goût de la somme, caractéristique de Présence Africaine dans son approche du "monde noir", il y a sans doute le sentiment que le jazz serait une métaphore pour dire cette nouvelle Négritude, libérée des contingences d'un passé de servitude. C'est aussi l'interprétation de Brathwaite, qui distingue ainsi le blues du jazz:
-
Le jazz, par contre, n'est pas une 'musique d'esclave' du tout. C'est la
musique du Noir émancipé; d'où son ton aggressivement
coloré, ses fanfaronnades, son déploiement de syncopation,
l'accent qu'il met sur l'improvisation, son swing. C'est la musique de
l'homme libre, qui quitte la honte et l'amertume de sa campagne natale pour
intégrer la complexité de la ville et sa high-life.
(55)
Cependant le jazz est assez riche pour rester aujourd'hui une métaphore apte à représenter l'épistémè postcoloniale, marquée par la déconstruction de la notion de race et la promotion de l'hybride. Hybrides, le blues et le jazz le sont, par définition. On le sait, le blues résulte de la friction, du mélange, de l'agglomérat, dans le Nouveau Monde, de reminiscences de chants, de danses, et de musique africaines, avec les répertoires classiques et populaires européens importés. Le jazz, qui se réapproprie le blues et d'autres traditions musicales religieuses, mais s'enrichit simultanément et continûment de toutes les traditions dont le blues est fait, a pu être défini comme:
-
[Le] croisement des forces souterraines d'une humanité
réputée plus instinctive avec l'idéalisme de
sociétés inspirées par la Grèce classique et le
monde germain; en fait, une forme culturelle idéale pour la
création spontanée, conviviale, gestuelle, vocale et
instrumentale. (Dictionnaire 605)
Le métissage des hommes, des sons et des gestes explique en effet la genèse du jazz et ses développements. Au dix-neuvième siècle tout particulièrement, la Nouvelle-Orléans était un carrefour privilégié entre les Antilles, l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. Ouverte sur l'Atlantique, donc sur l'Europe et l'Afrique, elle était en outre un des grands axes traversiers Sud-Nord des Etats-Unis. C'est aussi un lieu sans pareil où s'est fait, avec le transfert de la Louisiane aux Etats-Unis en 1803, le passage d'un ordre racial tripartite, à la française (Blancs-Métis-Noirs) à un ordre bipartite, Blancs et Noirs divisés par la fameuse colorline. Le jazz résulte de la convergence des Créoles et des Noirs dans le cadre
-
du plus formidable cocktail culturel réalisé en Amérique
du Nord, avec une population d'une rare diversité d'origines:
descendants d'immigrants français -- et d'Acadiens (cajuns)
chassés du Canada -- Espagnols, Italiens, Hollandais, Grecs et Irlandais,
d'esclaves noirs échappés des plantations ou affranchis, de
rescapés des révolutions caraïbes (sic)...
(Dictionnaire 874)
Si le jazz est caractérisé "par une posture mentale qui ne tend jamais à une conformité" (CJ 43), son autonomie s'est vérifiée tout particulièrement autour des questions raciales, et en ce sens également, il nous interpelle aujourd'hui. Le rôle des orchestres mixtes dans la transformation des représentations et pratiques figées par la ségrégation n'est plus à rappeler, non plus que l'esprit d'unité et d'harmonie créé dans le public par la musique elle-même (par quoi s'explique la fréquente association du jazz à un culte religieux). D'où la puissante formule de Frank Ténot:
-
[Le jazz] est même plus qu'un simple événement musical. La
rencontre aux Etats-Unis de cultures orales et écrites, issues de
l'Afrique et de l'Europe, contribue à l'évolution des moeurs et
des lois. (Dictionnaire 606)
-
rêve d'oecuménisme que sous-tend la volonté des gens du
jazz de repousser encore les limites de leur champ d'action, en
intégrant à leurs méthodes d'écriture et
d'improvisation des formes et procédés empruntés à
la tradition classique ou à ses acquis les plus récents et des
formules orchestrales jusqu'alors peu usitées en jazz."
(Dictionnaire 1166)
-
Cela fait maintenant plusieurs années que je suis rentrée. S'il
s'agissait d'une halte, elle serait bien longue. Il y a un temps pour chaque
chose et mon temps d'Europe est terminé. Ce sont les hasards de ma vie
qui m'avaient conduite là-bas, à l'époque coloniale. J'y
ai chanté des airs d'Europe, puis j'ai découvert les rythmes des
Antilles et du monde noir américain. C'était une musique qui
correspondait mieux à ma nature et à mon éducation
première. Mais lorsque j'interprétais ces chants, qui sont d'une
grande beauté, j'avais encore l'impression de mendier un passeport
auprès de pays étrangers. Et j'ai alors songé aux
berceuses que ma mère me fredonnait quand elle me portait sur son dos;
aux chansons que j'avais entendues dans les veillées ou les fêtes
de village et, de fil en aiguille, par un long et sinueux cheminement, j'en
suis parvenue à me convaincre qu'il fallait faire connaître ces
trésors à mon public. (399)
Imaginons, à titre d'exemple, quelques applications possibles. Ainsi la notion d'appel-répons pourrait rendre compte du jeu des voix dans le texte: voix singulière/voix collective; voix officielle/voix ludique, voix qui raconte/voix qui enregistre. Elle serait sans doute bienvenue pour un roman tel que le Texaco de Patrick Chamoiseau qui présente une variété de situations où la parole de l'interlocuteur(trice) est (littéralement) provoquée par séduction, défi, ou par goût de la prouesse verbale: considérons par exemple les versions de l'arrivée de l'urbaniste à Texaco, ou encore le rapport entre le projet du marqueur de paroles, le récit oral et les cahiers de Marie-Sophie Laborieux. Elle conviendrait aussi pour une situation de complémentarité rhétorique, comme celle qui existe entre Bingo, le griot et Tiécoura, son répondeur, dans le dernier roman d'Ahmadou Kourouma, En attendant le vote des bêtes sauvages. Bingo annonce:
-
Je dirai le récit purificatoire de votre vie de maître chasseur
et de dictateur. Le récit purificatoire est appelé en
malinké un donsomana. C'est une geste. Il est dit par un sora
accompagné par un répondeur cordoua. Un cordoua est un
initié en phase purificatoire, en phase cathartique. Tiécoura est
un cordoua et comme tout cordoua il fait le bouffon, le pitre, le fou. Il se
permet tout et il n'y a rien qu'on ne lui pardonne pas.
Tiécoura, tout le monde est réuni, tout est dit. Ajoute votre grain de sel.
Le répondeur joue de la flûte, gigote, danse. Brusquement s'arrête et interpelle le président Koyaga
- Président, général et dictateur Koyaga, nous chanterons et danserons votre donsomana en cinq veillées. Nous dirons la vérité. La vérité sur votre dictature. La vérité sur vos parents, vos collaborateurs. Toute la vérité sur vos saloperies, vos conneries; nous dénoncerons vos mensonges, vos nombreux crimes et assassinats...
-Arrête d'injurier un grand homme d'honneur et de bien comme notre père de la nation Koyaga. Sinon la malédiction et le malheur te poursuivront et te détruiront. Arrête donc ! Arrête!
Une veillée ne se dit pas sans qu'en sourdine au récit ronronne un thème. La vénération de la tradition est une bonne chose. Ce sera le thème dont sortiront les proverbes qui seront évoqués au cours des intermèdes de cette première veillée. (10)
A la notion de rythme correspondraient bien, dans la structure du texte, l'agencement des silences par rapport à la masse du dit, les récurrences de séquences et du thème ("riff"), l'importance des intervalles. On pourrait estimer par exemple que la nouvelle "A Love Supreme" est construite sur un rythme jazzique ABAC...: annonce de la mort de J.C./ découverte du jazz/ découverte de la musique de J.C., alors au désespoir/ retour de J.C. heureux/ apothéose et résurrection de J.C. Autre correspondance: la pratique intertextuelle, courante en jazz comme en littérature, de la citation, ce par quoi un art constitue sa propre culture, son réservoir de références, sa communauté d'amateurs -- avertis des mêmes textes, décryptant les mêmes allusions, sensibles à l'esthétique et à l'humour du collage.
Plus difficile à manipuler est à première vue la notion d'improvisation, associée davantage à l'oral qu'à l'écrit qu'on situe du côté de la composition.
-
L'improvisation... ce n'est pas seulement un des noms que l'écriture
attribue à l'oralité, mais l'un des noms que l'écriture
attribue à son 'Autre' (79)
-
La relecture est l'essence de l'étude critique soignée; la
lecture perverse ou aberrante est l'essence de la créativité, une
aptitude que nos institutions scolaires ont, pour la plupart,
négligé d'enseigner. (5)
Appliquer à la littérature francophone les distinctions repérées par les théoriciens du jazz entre plusieurs niveaux d'improvisation[6] serait certainement révélateur. La paraphrase, qui modifie sans l'effacer le discours d'un thème, rendrait bien compte, me semble-t-il, de passages controversés du Devoir de violence de Yambo Ouologuem. Le tracé d'une mélodie nouvelle, qui se déroule sur les accords, conservés ou enrichis, d'un texte-prétexte, me rappelle la relation entre le roman de Condé, La Migration des coeurs et celui d'Emily Brontë, The Wuthering Heights. Celui d'André Schwarz-Bart, La mulâtresse Solitude qui relate l'histoire d'une vie imaginée à partir d'une bribe d'archive, correspondrait bien à la notion de création libertaire, sans référence à aucun canevas harmonique (ici historique).
Puis-je conclure, alors que je ne viens pas armée de vérités décisives ? J'ai simplement voulu proposer de nouvelles équivalences pour lire quelques textes de littérature francophone. Tout à mon projet, j'ai gardé à l'esprit deux autres notes écrites par Matisse dans Jazz. La première rappelle la présence constante (quoiqu'invisible) de la ligne verticale dans ses dessins. Et Matisse d'ajouter simplement "mes courbes ne sont pas folles."(84) L'autre note évoque sa déception à peindre des bouquets qu'il a lui-même arrangés, consciemment ou non, sur le modèle de bouquets déjà vus. Il poursuit:
-
Renoir m'a dit: 'Quand j'ai arrangé un bouquet pour le peindre, je
m'arrête sur le côté que je n'avais pas prévu'
(38-39)
Notes
[1]cf Clark Terry & Milt Hinton, Seeing Jazz. Artists and Writers on Jazz. Smithsonian Institution, 1997
[2] cf Robert Jouanny, Espaces littéraires d'Afrique et d'Amérique. Paris: L'Harmattan, 1996, 79-101 "Trois poètes à New York: Garcia Lorca, Senghor, Dadié"
[3] cf Tyler Stovall, Paris Noir. African-Americans in the City of Light. New York: Houghton Mifflin, 1996, chapitre 2
[4] cf A partir des années 50, on note la présence dans le jazz d'instruments tels que les bongos et congas (instrument de percussion d'origine du Congo) et de références aux danses d'Amérique latine.
[5] cf le savoureux passage où Victor Augagneur rencontre Henri Lopes, "un Lopes aux yeux verts", alias André Leclerc, personnage du Chercheur d'Afriques (312-)
[6] cf "Improvisation", Dictionnaire du Jazz, 579-580
Bibliographie
Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths and Helen Tifflin (eds.). Postcolonial Studies Reader. London: Routledge, 1995, pp.327-331.
Baker, Houston A. Blues, Ideology and Afro-American Literature. Chicago & London: U of Chicago Press, 1984.
Brathwaite, Kamau. "Jazz and the West Indian Novel" BIM XI, 44, 1967; XII, 45, 1967; XII, 46, 1968.
Brière, Jean-François. Sculptures de proue. Paris: Silex, 1983.
Carles, Philippe, André Clergeat et Jean-Louis Comolli. Dictionnaire du Jazz. Paris: Laffont, 1994.
Césaire, Aimé. Cahier d'un retour au pays natal. Abiola Irele, (ed.). Ibadan: New Horn Press, 1994.
Condé, Maryse. Desirada. Paris: Laffont, 1997
Dadié, Bernard. Patron de New York. Paris: Présence Africaine, 1963.
Damas, Léon Gontran. Pigments. Paris: Présence Africaine, 1972.
Delaygue, Elizabeth. Mestizo. Paris: Présence Africaine, 1986.
Dongala, Emmnauel B. Jazz et vin de palme. Paris: Hatier, 1962.
Eyma, Xavier. Scènes de moeurs et voyages dans le Nouveau Monde. Paris: Poulet-Malassis, 1862.
Fréchet, Philippe. "Jazz et littérature" Cahiers du Jazz. 4. 1994, pp.3-33.
Gyssels, Kathleen. "Le jazz dans le roman afro-antillais. Consonances de la diaspora noire dans l'oeuvre de Daniel Maximin" Europe. 820-821. Août-Septembre 1997, pp.124-133.
Jarrett, Michaël. Drifting on a Read. Jazz as a model for writing. Albany: SUNY Press, 1999.
Jones, Leroi/Amiri Baraka, Blues people. The Negro experience in white America and the music that developed from it. New York: Marrow Quill Paperbacks, 1963.
Kourouma, Ahmadou. En attendant le vote des bêtes sauvages. Paris: Seuil, 1998.
Leiris, Michel. Journal. 1922-1989. Paris: Gallimard, 1992, p.744.
Leiris, Michel. L'Age d'homme. Paris: Gallimard, 1939.
Lopes, Henri. Le Chercheur d'Afriques. Paris: Seuil, 1990.
Lopes, Henri. Le Lys et le flamboyant. Paris: Seuil, 1997.
Malson, Lucien. "Ecrits théoriques : le jazz comme exemple" Cahiers du Jazz. 4. 1994, pp.39-49.
Maran, René. Batouala. Véritable roman nègre. Paris: Albin Michel, 1921.
Matisse, Henri. Jazz. New York: George Braziller, 1983.
Ndoye, El Hadj Amadou. "Jazz et vin de palme" Atlantiques. Cahier du centre régional des lettres d'Aquitaine III. Automne 1997, pp.41-50.
Nesbitt, F. Nick. "Jazz et mémoire dans l'Isolé Soleil: techniques vernaculaires d'historiographie dans la littérature antillaise" Littéréalité. 10-1. Spring/Summer 1998, pp.69-79.
Njami, Simon. African Gigolo. Paris: Seghers, 1989.
Sartre, Jean-Paul. "Orphée noir" Léopold Sédar Senghor (ed.). Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache. Paris: PUF, 1948.
Senghor, Léolpold Sédar. Oeuvre poétique. Paris: Seuil, 1990.
Sétié, Yannick. "Ce que le jazz pense de la peinture" Europe. 820-821. Août-Septembre 1997, pp.7-22.
Socé, Ousmane. Mirages de Paris. Paris: Nouvelles Editions Latines, 1937.
Remerciements au NYU Research Challenge Fund Emergency Support Grant
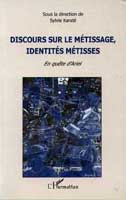
|
Dr Sylvie Kandé a une maîtrise de lettres classiques (Paris IV) et un doctorat en histoire de l'Afrique (Paris VII). Elle enseigne la littérature africaine et caribéenne francophone à New York University. Elle a contribué par ses essais et compte rendus de livres à de nombreuses revues et journaux. Elle collabore en particulier avec La Nouvelle Revue Française. En 1997, elle a organisé un colloque international sur le métissage; les actes, publiés sous sa direction, s'intitulent Discours sur le métissage, identités métisses: en quête d'Ariel (Paris: L'Harmattan, 1999). En 1998, elle a publié chez l'Harmattan Terres, urbanisme et architecture 'créoles' en Sierra Leone, 18ème-19ème siècles. Elle a également publié chez Gallimard (Paris: janvier 2000), un long poème en prose intitulé Lagon, Lagunes (Préface d'Edouard Glissant). Elle est en train de traduire un recueil de nouvelles de la romancière australienne Alexis Wright. |
| Paper presented at the African Studies Association of Australasia & the Pacific 22nd Annual & International Conference (Perth, 1999) New African Perspectives: Africa, Australasia, & the Wider World at the end of the twentieth century |
Back to [the top of the page] [the contents of this issue of MOTS PLURIELS]