No 21. mai 2102.
https://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP2102edito2.html
© Eileen Pittaway
Eileen Pittaway
Centre for Refugee Research, The University of New South Wales
|
|

Qu'est-ce qu'un réfugié?
D'après la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés,
un réfugié est une personne qui, menacée de
persécution à cause de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à
un groupe social donné se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité et ne peut pas ou ne souhaite pas, à cause de ces
menaces, se soumettre à la protection de ce pays.
En 2002, plus de 22 millions de réfugiés sont sous la protection du Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies (UNHCR). A ce nombre, s'ajoutent environ 25 millions de personnes déplacées vivant dans des conditions précaires, dans leur propre pays. Plus de 80% de ces réfugiés et de ces personnes déplacées sont des femmes et des enfants, qui font l'objet de violences innombrables, de viols et d'agressions, élevées au rang de stratégies militaires en temps de guerre. Leurs conditions de vie sont déplorables et la majorité de ces femmes manque de nourriture, d'eau potable, de soins médicaux et d'écoles pour leurs enfants. Cinquante ans après la signature, par 140 nations du monde entier, de la Convention de 1951, les réfugiés - et les réfugiées - représentent l'un des groupes les plus vulnérables de la planète.
A l'origine, la Convention de 1951 avait pour but de protéger les réfugiés des persécutions et du malheur. Elle reconnaissait le droit de refuge, octroyé aux victimes de persécutions, comme un droit fondamental de la personne, conforme à la Déclaration des Droits de l'Homme. Mais depuis la rédaction du texte de la Convention, le monde a changé de manière considérable et le profil du réfugié s'est également modifié : le réfugié, qui était alors surtout européen, appartient maintenant au monde entier. Les forces économiques, sociales et politiques qui régissent le monde ont évolué aussi au point d'être méconnaissables. Les frontières de nombreux états ont été modifiées, et le phénomène de globalisation qui régente le monde rend chaque jour plus homogène notre manière de vivre. Parallèlement, d'innombrables conflits internes, externes ou ethniques et des désastres naturels provoquent des mouvements de population sans précédent. Le monde s'épuise en vain à essayer de résoudre les problèmes associés à un monde en mutation.
Au nombre des innombrables activités mises sur pied pour marquer le cinquantenaire de la Convention relative au statut des réfugiés, une Conférence a été organisée à Sydney par le Centre de recherche pour les réfugiés, de l'Université de Nouvelles-Galles-du-Sud. Le but de cette rencontre était d'examiner dans quelle mesure la Convention de 1951 était encore adaptée aux besoins du XXIe siècle. Une approche résolument internationale était envisagée et l'évocation des problèmes propres à diverses régions de notre planète mis à l'ordre du jour. Mais l'évolution de la situation des réfugiés en Australie, au cours de l'année 2001, en décida autrement. Un durcissement du gouvernement fédéral face aux demandeurs d'asile favorisa la polarisation de la population et des médias sur le sort des réfugiés et provoqua une sérieuse controverse, aussi bien en Australie que dans le reste du monde. L'incarcération systématique des réfugiés fut évoquée aussi bien à la Conférence contre le racisme de Durban en août 2001 qu'au Conseil de l'Union européenne et encore au comité exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en septembre de la même année. Le sort des réfugiés en Australie devenant un thème hautement médiatisé à l'intérieur du pays comme à l'étranger, il était quasi inévitable que la Conférence de Sydney mît l'accent sur l'attitude australienne et que la situation locale prît une place prépondérante dans les discussions. Les articles proposés dans ce numéro de MP reflètent cette actualité, tout comme le rapport des débats de la Conférence de Sydney qui est disponible sur la page du Centre de recherche pour les réfugiés.
La peur d'être persécuté pour des raisons politiques, elle seule, justifie le droit au statut de réfugié, mais le sens donné aux mots "persécution" et "politique" fait l'objet de multiples interprétations. Face à la pléthore de définitions qui a cours, il s'agit aujourd'hui de redéfinir les limites et les responsabilités internationales des Etats vis-à-vis des réfugiés dans le cadre de la Convention de 1951. De plus, les termes de "réfugiés économiques" et de "réfugiés écologiques" ont été introduits dans le débat, suggérant que la définition étroite d'un réfugié fuyant une persécution politique doit être élargie. Les Etats-nations ont une responsabilité collective qui va au-delà de la définition limitative de la Convention de 1951. De considérables débats sont générés autour de l'alternative soit d'inclure les personnes contraintes à l'immigration pour des raisons autres que politiques dans la Convention sur le statut des réfugiés, soit, au contraire de créer de nouveaux instruments répondant à leurs besoins propres.
Actuellement, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a identifié trois solutions tendant à répondre de manière durable à la situation des réfugiés. Premièrement, le droit à l'établissement du réfugié dans le premier pays d'asile où il arrive, après avoir fui les persécutions dans son pays. Deuxièmement, le déplacement du réfugié du pays où il a trouvé un refuge temporaire vers un nouveau pays où il peut s'établir de manière permanente, souvent un pays développé. Et troisièmement, le rapatriement du réfugié vers son pays d'origine, lorsque les dangers qui le menaçaient sont réputés avoir cessés.
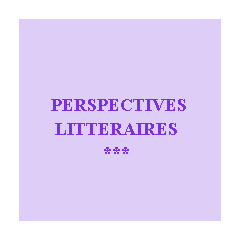
Pourquoi le monde a-t-il créé tant de réfugiés en
ce début de XXIe siècle ? Telle est la question cruciale
posée par ![]() qui explore, dans le premier article de cette
section, quelques unes des raisons qui ont conduits à la situation
actuelle. Face à un problème qui dépasse leur
singularité, la réponse des Etats-nations tient plus d'un
réflexe et d'un mouvement de recul que d'une préoccupation
humanitaire. Dans le contexte d'un système économique global,
Head introduit de manière fort pertinente la notion de
citoyenneté globale car l'impact des vagues de réfugiés
qui se succèdent constitue bien un phénomène à
portée universelle. Les déplacements anarchiques de populations
fuyant en direction d'un pays tiers sont évoqués par
qui explore, dans le premier article de cette
section, quelques unes des raisons qui ont conduits à la situation
actuelle. Face à un problème qui dépasse leur
singularité, la réponse des Etats-nations tient plus d'un
réflexe et d'un mouvement de recul que d'une préoccupation
humanitaire. Dans le contexte d'un système économique global,
Head introduit de manière fort pertinente la notion de
citoyenneté globale car l'impact des vagues de réfugiés
qui se succèdent constitue bien un phénomène à
portée universelle. Les déplacements anarchiques de populations
fuyant en direction d'un pays tiers sont évoqués par ![]() ,
qui souligne leur impact sur les pays en voie de développement car,
contrairement aux idées reçues, ce sont surtout les pays du
Tiers-monde qui accueillent la grande majorité des 22 millions de
réfugiés de la planète. Ces pays, qui déjà
peinent à faire face aux besoins de leur propre population, sont
placés dans une situation plus que précaire lors de
l'arrivée massive de réfugiés auxquels ils offrent refuge.
L'Etat-nation qui s'est développé depuis le XVIIIe siècle
accorde une importance majeure au concept de nationalité et, comme le
montre
,
qui souligne leur impact sur les pays en voie de développement car,
contrairement aux idées reçues, ce sont surtout les pays du
Tiers-monde qui accueillent la grande majorité des 22 millions de
réfugiés de la planète. Ces pays, qui déjà
peinent à faire face aux besoins de leur propre population, sont
placés dans une situation plus que précaire lors de
l'arrivée massive de réfugiés auxquels ils offrent refuge.
L'Etat-nation qui s'est développé depuis le XVIIIe siècle
accorde une importance majeure au concept de nationalité et, comme le
montre ![]() dans son étude de l'apatridie, le fait
d'être déchu de sa nationalité et de ne plus pouvoir se
placer sous la protection de son pays, place l'individu en marge du monde.
dans son étude de l'apatridie, le fait
d'être déchu de sa nationalité et de ne plus pouvoir se
placer sous la protection de son pays, place l'individu en marge du monde.
Tous les pays n'ont pas une attitude similaire vis-à-vis des
réfugiés et des demandeurs d'asile : savoir si
l'expérience australienne peut être comparée à celle
d'autres pays, tels ceux de la communauté européenne, est
âprement discuté en Australie. Deux textes offrent matière
à comparaison. Le texte de![]() analyse l'approche adoptée par
l'Allemagne. L'étude de
analyse l'approche adoptée par
l'Allemagne. L'étude de ![]() explore l'attitude de la France.
Aujourd'hui encore, suggère-t-elle, les réfugiés politiques semblent
plus facilement acceptés que les autres catégories de migrants
cherchant à s'installer en France où, comme le montre
explore l'attitude de la France.
Aujourd'hui encore, suggère-t-elle, les réfugiés politiques semblent
plus facilement acceptés que les autres catégories de migrants
cherchant à s'installer en France où, comme le montre ![]() dans
son survol de la littérature francaise, de nombreux
réfugiés se sont succédés tout au long du XXe
siècle.
dans
son survol de la littérature francaise, de nombreux
réfugiés se sont succédés tout au long du XXe
siècle.
Si la possibilité de s'établir dans un pays occidental est
offerte à un certain nombre de réfugiés, la grande
majorité d'entre eux est contrainte de s'entasser dans des camps de
fortune surpeuplés. L'étude proposée par ![]() ,
,
![]() et
et
![]() , nous
rendent conscients non seulement des conditions difficiles qui règnent dans
ces camps, mais aussi des faux-pas de l'aide internationale. Cette étude
de l'aide nutritionnelle apportée aux enfants internés montre que
les outils de référence et les modèles occidentaux
utilisés à tort, faute de connaissances appropriées,
conduisent à une aide inadaptée aux besoins de ces enfants.
L'accent mis, par cette étude, sur un aspect particulier de l'aide
occidentale, souligne le besoin de reconnaître que les modèles
développés au Nord n'ont pas un caractère universel. Cette
étude montre également qu'il est inacceptable, comme l'admettent
pourtant les pays qui hésitent à ouvrir leurs frontières,
de penser que des populations, abritées dans des camps de fortune hors
de leurs frontières, soient à l'abri du besoin et puissent y
rester ad eternum. Une approche humanitaire respectueuse d'autrui est
essentielle. Mais, comme le suggèrent
, nous
rendent conscients non seulement des conditions difficiles qui règnent dans
ces camps, mais aussi des faux-pas de l'aide internationale. Cette étude
de l'aide nutritionnelle apportée aux enfants internés montre que
les outils de référence et les modèles occidentaux
utilisés à tort, faute de connaissances appropriées,
conduisent à une aide inadaptée aux besoins de ces enfants.
L'accent mis, par cette étude, sur un aspect particulier de l'aide
occidentale, souligne le besoin de reconnaître que les modèles
développés au Nord n'ont pas un caractère universel. Cette
étude montre également qu'il est inacceptable, comme l'admettent
pourtant les pays qui hésitent à ouvrir leurs frontières,
de penser que des populations, abritées dans des camps de fortune hors
de leurs frontières, soient à l'abri du besoin et puissent y
rester ad eternum. Une approche humanitaire respectueuse d'autrui est
essentielle. Mais, comme le suggèrent ![]() et
et
![]() , évoquant
les difficultés associées à l'éducation des enfants
de réfugiés, malgré le considérable impact de la
globalisation, certains citoyens des pays d'accueil utilisent encore
l'idée de culture comme une arme à l'encontre de ceux qui sont
perçus comme des étrangers.
, évoquant
les difficultés associées à l'éducation des enfants
de réfugiés, malgré le considérable impact de la
globalisation, certains citoyens des pays d'accueil utilisent encore
l'idée de culture comme une arme à l'encontre de ceux qui sont
perçus comme des étrangers.
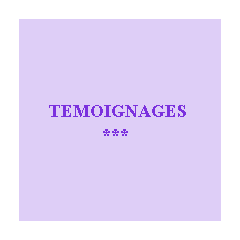
Les articles, témoignant de l'expérience des
réfugiés et des demandeurs d'asile, regroupés dans cette
section proposent des témoignages de première main. Par exemple,
l'interview de ![]() , évoquant sa fuite du
Congo, présente le cas typique d'une femme et de ses enfants fuyant les
persécutions. Leur fuite n'est pas l'aboutissement d'un choix
délibéré ; elle résulte de menaces et de
périls encourus par Tsibinda et sa famille dans son propre pays. Les
facteurs qui contraignent certaines personnes à s'enfuir de chez elles retiennent
l'attention de
, évoquant sa fuite du
Congo, présente le cas typique d'une femme et de ses enfants fuyant les
persécutions. Leur fuite n'est pas l'aboutissement d'un choix
délibéré ; elle résulte de menaces et de
périls encourus par Tsibinda et sa famille dans son propre pays. Les
facteurs qui contraignent certaines personnes à s'enfuir de chez elles retiennent
l'attention de ![]() dans une étude qui invite à se pencher sur
les raisons forçant les gens à partir, plutôt que sur le
sort des réfugiés après leur départ. Ces raisons sont multiples mais la
solution, suggère-t-elle, ne peut être effective que dans la
mesure où les pays du Nord acceptent de reconnaître leur part de
responsabilité dans l'origine du problème. Cette reconnaissance
requiert un changement d'attitude et l'adoption d'un discours aux antipodes de
la rhétorique actuelle. C'est ce que montre également
dans une étude qui invite à se pencher sur
les raisons forçant les gens à partir, plutôt que sur le
sort des réfugiés après leur départ. Ces raisons sont multiples mais la
solution, suggère-t-elle, ne peut être effective que dans la
mesure où les pays du Nord acceptent de reconnaître leur part de
responsabilité dans l'origine du problème. Cette reconnaissance
requiert un changement d'attitude et l'adoption d'un discours aux antipodes de
la rhétorique actuelle. C'est ce que montre également ![]() dans
son analyse de l'expérience de réfugiés
bénéficiant d'une protection temporaire. Sur la base d'interviews
de réfugiés en Australie, Fethi montre que les nouvelles
catégories de visas, mises en place par le gouvernement, rendent le
séjour temporaire de ces demandeurs d'asile plus traumatique que dans le
passé ; ces catégories rendent plus difficile encore
l'intégration des réfugiés dans la vie et les structures
du pays d'accueil.
dans
son analyse de l'expérience de réfugiés
bénéficiant d'une protection temporaire. Sur la base d'interviews
de réfugiés en Australie, Fethi montre que les nouvelles
catégories de visas, mises en place par le gouvernement, rendent le
séjour temporaire de ces demandeurs d'asile plus traumatique que dans le
passé ; ces catégories rendent plus difficile encore
l'intégration des réfugiés dans la vie et les structures
du pays d'accueil. ![]() , elle, explore une problématique
similaire soulignant les traumatismes psychologiques et les séquelles
à long terme soufferts par les réfugiés
bénéficiant d'un permis temporaire, ainsi que leurs
difficultés d'insertion dans la société australienne.
, elle, explore une problématique
similaire soulignant les traumatismes psychologiques et les séquelles
à long terme soufferts par les réfugiés
bénéficiant d'un permis temporaire, ainsi que leurs
difficultés d'insertion dans la société australienne.
En dépit des conditions difficiles auxquelles les réfugiés
sont confrontés, la situation n'est pas toujours
désespérée et l'on relève parfois une lueur
d'espoir, comme en témoigne la résilience de ceux qui
réussissent à reconstruire leur vie lorsque les conditions le
leur permettent. ![]() fournit le témoignage d'un groupe de
réfugiés bosniaques installés en Australie Occidentale.
Son étude examine les stratégies adoptées par certains
membres de cette communauté pour survivre et s'intégrer à
une communauté différente de la leur.
fournit le témoignage d'un groupe de
réfugiés bosniaques installés en Australie Occidentale.
Son étude examine les stratégies adoptées par certains
membres de cette communauté pour survivre et s'intégrer à
une communauté différente de la leur. ![]() et
et
![]() , elles, proposent une étude de cas basée sur de
nombreuses rencontres avec deux jeunes réfugiées. S'appuyant sur
l'expérience de ces deux jeunes femmes, elles montrent comment les
notions de loisir et de liberté fluctuent et influencent le
processus de réinsertion dans un nouveau milieu. Passant de
l'étude de cas à la revue de littérature, l'article de
, elles, proposent une étude de cas basée sur de
nombreuses rencontres avec deux jeunes réfugiées. S'appuyant sur
l'expérience de ces deux jeunes femmes, elles montrent comment les
notions de loisir et de liberté fluctuent et influencent le
processus de réinsertion dans un nouveau milieu. Passant de
l'étude de cas à la revue de littérature, l'article de
![]() ,
,
![]() et
et
![]() . propose un large survol de la littérature
relative au traitement psychologique des réfugiés ; il souligne
la nécessité d'aborder les problèmes associés au
traitement des individus en adoptant le point de vue des réfugiés
eux-mêmes et en se méfiant des normes et définitions
occidentales qui sont loin d'être universelles.
. propose un large survol de la littérature
relative au traitement psychologique des réfugiés ; il souligne
la nécessité d'aborder les problèmes associés au
traitement des individus en adoptant le point de vue des réfugiés
eux-mêmes et en se méfiant des normes et définitions
occidentales qui sont loin d'être universelles.
Demandeurs d'asile "On-shore": L'expérience des réfugiés qui tentent d'échapper
aux dangers qui les menacent en cherchant refuge directement en Australie est
très différente de l'épreuve vécue par les
réfugiés "off-shore". Le traitement de ces réfugiés
"on-shore" préoccupent les défenseurs des droits des
réfugiés depuis plusieurs années, car ces
réfugiés sont incarcérés systématiquement
à leur arrivée en Australie. Toutefois, ce n'est que depuis la
vague de xénophobie et de racisme provoquée par les succès
du parti politique "One Nation" de Mme Pauline Hanson, et la
récupération de son discours à des fins électorales
par le gouvernement fédéral (culminant dans la triste affaire du
Tampa mentionnée dans plusieurs articles) que la majorité de la
population a pris conscience du fait qu'un petit nombre de
réfugiés "on-shore" arrivait chaque année en Australie et
y demandait asile. Le gros de la population n'était d'ailleurs pas plus
au courant de la détention systématique des demandeurs d'asile,
que des conséquences et des ramifications d'une telle pratique. La
troisième partie de ce numéro de MP traite en détail de la
question et reflète, comme nous l'avons mentionné plus haut, une
des préoccupations majeures des délégués ayant
participé à la conférence de Sydney. Replacer la
réponse de l'Australie dans le contexte de ses responsabilités
face au monde dépasse la singularité d'un exemple et permet de
mieux appréhender et comprendre la réponse d'autres pays
confrontés à une situation similaire. Ce qui distingue l'approche
australienne de celle des autres pays est la détention
systématique de tous les demandeurs d'asile arrivant dans le pays par
voie de mer, quelque soit leur sexe, leur âge ou leur nationalité,
ce qui signifie, par exemple, que les enfants, tout comme les adultes, sont
incarcérés à leur arrivée et restent en prison
pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. L'article
théorique de ![]() , qui débute cette section, propose une
intéressante analyse du concept de réfugié et du
rôle menaçant qu'on lui attribue dans la société
australienne où il est associé à une transgression
violente de frontières mythiques érigées par un discours
politique doté du pouvoir de faire et de défaire l'opinion
publique.
, qui débute cette section, propose une
intéressante analyse du concept de réfugié et du
rôle menaçant qu'on lui attribue dans la société
australienne où il est associé à une transgression
violente de frontières mythiques érigées par un discours
politique doté du pouvoir de faire et de défaire l'opinion
publique.
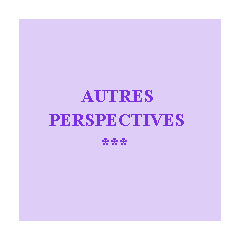 L'incarcération des demandeurs d'asile est-elle dans
l'intérêt du pays, comme essaie de nous le faire croire la
rhétorique gouvernementale ? Pour
L'incarcération des demandeurs d'asile est-elle dans
l'intérêt du pays, comme essaie de nous le faire croire la
rhétorique gouvernementale ? Pour ![]() , la réponse
est "non" car, suggère-t-elle, l'espoir de décourager les futurs
arrivants est contraire à la notion de protection à laquelle des
réfugiés devraient être associés et
l'incarcération constitue une violation des Droits de l'Homme. Loin
d'être dans l'intérêt de la nation, une telle pratique lui
porte préjudice et ternit notre réputation aux yeux de la
communauté internationale.
, la réponse
est "non" car, suggère-t-elle, l'espoir de décourager les futurs
arrivants est contraire à la notion de protection à laquelle des
réfugiés devraient être associés et
l'incarcération constitue une violation des Droits de l'Homme. Loin
d'être dans l'intérêt de la nation, une telle pratique lui
porte préjudice et ternit notre réputation aux yeux de la
communauté internationale. ![]() partage ce point de vue et
affirme, lui aussi, que l'Australie est en contravention avec la
Déclaration des Droits de l'Homme. Il propose des alternatives positives
à la détention systématique des demandeurs d'asile.
partage ce point de vue et
affirme, lui aussi, que l'Australie est en contravention avec la
Déclaration des Droits de l'Homme. Il propose des alternatives positives
à la détention systématique des demandeurs d'asile.
Les articles de ![]() et de
et de ![]() retracent le chemin qui a conduit
l'Australie à adopter une politique de détention des
réfugiés. Tous deux proposent une vue intéressante, mais
divergente, sur les raisons qui ont inspirer ce choix. Pour McMaster, cette
politique est l'aboutissement d'une progression naturelle ayant son origine
dans la politique raciale - "The White Australia Policy" - qui a exclu les
non-Européens du continent jusqu'à une date récente. Pour
lui, l'attitude actuelle du gouvernement reflète un racisme ambiant,
présent dans la communauté australienne et savamment
manipulé par les politiciens. Tout en déplorant le récent
durcissement de la législation australienne concernant les
réfugiés, la création d'un visa de protection temporaire
en particulier, Rivett suggère, quant à lui, que la
détention obligatoire des demandeurs d'asile n'est pas simplement due
à une réaction raciste, mais à une préoccupation
réelle de la sécurité des citoyens et à
l'inquiétude d'avoir à faire face à un nombre de
réfugiés dépassant la capacité d'accueil du pays.
La différence d'opinion exprimée par ces deux articles souligne
combien il est difficile de trouver un consensus lorsqu'on a affaire à
un problème aussi complexe, délicat et difficile à
résoudre.
Le dernier article, proposé par
retracent le chemin qui a conduit
l'Australie à adopter une politique de détention des
réfugiés. Tous deux proposent une vue intéressante, mais
divergente, sur les raisons qui ont inspirer ce choix. Pour McMaster, cette
politique est l'aboutissement d'une progression naturelle ayant son origine
dans la politique raciale - "The White Australia Policy" - qui a exclu les
non-Européens du continent jusqu'à une date récente. Pour
lui, l'attitude actuelle du gouvernement reflète un racisme ambiant,
présent dans la communauté australienne et savamment
manipulé par les politiciens. Tout en déplorant le récent
durcissement de la législation australienne concernant les
réfugiés, la création d'un visa de protection temporaire
en particulier, Rivett suggère, quant à lui, que la
détention obligatoire des demandeurs d'asile n'est pas simplement due
à une réaction raciste, mais à une préoccupation
réelle de la sécurité des citoyens et à
l'inquiétude d'avoir à faire face à un nombre de
réfugiés dépassant la capacité d'accueil du pays.
La différence d'opinion exprimée par ces deux articles souligne
combien il est difficile de trouver un consensus lorsqu'on a affaire à
un problème aussi complexe, délicat et difficile à
résoudre.
Le dernier article, proposé par ![]() et
et
![]() , fait le point sur les
derniers développements législatifs mis en place par le
gouvernement fédéral australien pour décourager les
demandeurs d'asile. Cette analyse pertinente montre que loin de proposer une
amélioration, les changements actuels nous éloignent encore un
peu plus de la Déclaration des Droits de l'Homme, qui pourtant devrait
inspirer nos obligations internationales.
, fait le point sur les
derniers développements législatifs mis en place par le
gouvernement fédéral australien pour décourager les
demandeurs d'asile. Cette analyse pertinente montre que loin de proposer une
amélioration, les changements actuels nous éloignent encore un
peu plus de la Déclaration des Droits de l'Homme, qui pourtant devrait
inspirer nos obligations internationales.
 L'idée de voyage et de route est souvent utilisée de
manière allégorique pour décrire l'expérience des
réfugiés. Dans ce numéro de MP, nous avons essayé
de couvrir plusieurs étapes de ce voyage. Ce qui en émerge le
plus clairement, c'est que la question des réfugiés est avant
tout politique, et que la logique politicienne balaie les principes
humanitaires à toutes les étapes du voyage. L'idée de
Droits de l'Homme est flexible et les réfugiés sont des pions
facilement sacrifiés sur l'autel de la souveraineté nationale ;
leurs droits ne pèsent pas lourd et les gouvernements
interprètent la définition de réfugié en fonction
de leurs intérêts particuliers. Les Etats-nations adoptent
différentes interprétations à différents moments de
leur histoire et de nouvelles interprétations s'imposent sous la
pression d'intérêts centralisateurs, de pressions
économiques, de mouvements stratégiques de positionnement. Les
lois régissant les politiques intérieures sont le fruit de ces
forces fluctuantes et les réfugiés sont emportés par des
courants aussi dangereux qu'imprévisibles. Une nouvelle métaphore
propre au XXIe siècle, celle d'un torrent en crue emportant les
réfugiés comme des fétus de paille dans ses eaux
agitées, semble devoir remplacer celle de voyage ou de route.
L'idée de voyage et de route est souvent utilisée de
manière allégorique pour décrire l'expérience des
réfugiés. Dans ce numéro de MP, nous avons essayé
de couvrir plusieurs étapes de ce voyage. Ce qui en émerge le
plus clairement, c'est que la question des réfugiés est avant
tout politique, et que la logique politicienne balaie les principes
humanitaires à toutes les étapes du voyage. L'idée de
Droits de l'Homme est flexible et les réfugiés sont des pions
facilement sacrifiés sur l'autel de la souveraineté nationale ;
leurs droits ne pèsent pas lourd et les gouvernements
interprètent la définition de réfugié en fonction
de leurs intérêts particuliers. Les Etats-nations adoptent
différentes interprétations à différents moments de
leur histoire et de nouvelles interprétations s'imposent sous la
pression d'intérêts centralisateurs, de pressions
économiques, de mouvements stratégiques de positionnement. Les
lois régissant les politiques intérieures sont le fruit de ces
forces fluctuantes et les réfugiés sont emportés par des
courants aussi dangereux qu'imprévisibles. Une nouvelle métaphore
propre au XXIe siècle, celle d'un torrent en crue emportant les
réfugiés comme des fétus de paille dans ses eaux
agitées, semble devoir remplacer celle de voyage ou de route.
De plus, malheureusement, bien que l'on sache depuis longtemps que la grande majorité des réfugiés est constituée de femmes et d'enfants, les politiques d'aide aux réfugiés ne tiennent pas encore compte systématiquement de cette disparité et répondent de manière inadaptée à la spécificité des besoins réels. La disproportion des femmes dans les camps a pourtant été relevée en 1985 déjà lors de la troisième Conférence mondiale des femme à Nairobi. Depuis, elle a été constatée dans tous les documents importants publiés par Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, sans pour autant conduire à une action décisive. Dans ce contexte, on notera aussi qu'en dépit de la diversité et de l'intérêt des articles présentés lors de la Conférence de Sydney, les contributions ont été singulièrement silencieuses sur ce sujet...
Ces silences ne sont pas sans importance, car ils conduisent à une aide inadaptée et mal ciblée. Les Etats-nations défendent leurs actions et en dénigrant les réfugiés et en blâmant les demandeurs d'asile ; ils fortifient leurs frontières au nom de leur souveraineté, mais ne solutionnent rien. Le problème des réfugiés, que l'on assimile de plus en plus au problème plus général de larges déplacements "illégaux" de population, c'est-à-dire échappant aux restrictions imposées par les Etats-nations, s'impose comme infiniment complexe. La réponse au problème des réfugiés demande que l'on examine les causes profondes de ces migrations "illégales" et que l'Occident admette sa part de responsabilité dans le développement d'un système qui favorise, encourage et parfois même rend inévitables, ces mouvements humains massifs et désordonnés. Espérer solutionner les problèmes des réfugiés exige de reconnaître ouvertement que 80% des victimes sont des femmes et des enfants, et qu'il est crucial de répondre à leurs besoins particuliers. Un examen minutieux de la manière dont l'aide est attribuée aux réfugiés est essentiel, de même qu'une évaluation systématique des processus d'insertion et de réinsertion et des services offerts.
Enfin, trouver une solution exige que l'on analyse de près la manière dont les Etats-nations et les Nations Unies interprètent la Convention relative au statut des réfugiés, afin de redéfinir les obligations de chacun. Les défenseurs des droits des réfugiés demandent l'introduction d'un mécanisme permettant d'établir la responsabilité des Etats et la nomination d'un rapporteur chargé de veiller à ce que les états signataires respectent les procédures mises en place. Il convient également de mettre en place de nouvelles législations permettant de venir en aide aux dizaines de millions de personnes qui ont été déplacées pour des raisons économiques ou des catastrophes écologiques. Tant que les questions fondamentales liées à l'origine des flux migratoires contemporains n'auront pas été résolues, le flot des réfugiés ne peut qu'augmenter, les mesures de défense des Etats-nations ne peuvent que devenir plus draconiennes et, mis à part la fortune des passeurs et une recrudescence des marchés noirs, qui sait quelle conséquence ce protectionnisme, qu'il faudrait éviter de voir se transformer en une nouvelle forme de persécution, peut avoir à long terme?
Bibliographie
National Population Council (1991). The National Population Council's Refugee Review. July 1991, Canberra: AGPS.
Pittaway, E. Bartolomei, L. (2001). "Refugees, Race and Gender", Refuge. Vol.19 no.6, Ontario York University.
 | Eileen Pittway est directrice du Center for Refugee Research (Centre de Recherches sur les Réfugiés), organisme abrité par l'Université de Nouvelles-Galles du Sud, où elle enseigne le développement social international. Depuis plus de vingt ans, elle participe activement à tout ce qui concerne le domaine des réfugiés et celui des femmes. Ses efforts se concentrent sur la nécessité d'assimiler le viol à un crime de guerre pendant les conflits. Elle est membre du Asian Women's Human Rights Council (Conseil des droits humains des femmes asiatiques), et co-présidente de Asia Pacific Women's Watch (APWW) (Vigile pour les femmes de la région Asie-Pacifique), un réseau d'ONG spécialisé dans les droits des femmes et couvrant la région Asie-Pacifique. Elle s'intéresse particulièrement aux rapports entre les Nations-Unies et la société civile, et elle est conseillère universitaire du Australian Journal of Human Rights (Journal australien des droits humains). |
Back to [the top of the page] [the contents of this issue of MOTS PLURIELS]