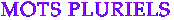
No. 14 June 2000.
https://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP1400edito.html
© Jean-Marie Volet
[Version française] [English version]
***
Depuis plusieurs années, Mots Pluriels s'est assigné pour
mission de favoriser le dialogue entre les disciplines et de débattre
les grands problèmes auxquels doit faire face notre époque, tant à
l'université qu'en dehors de nos institutions. Ce numéro du journal ayant pour thème le savoir et sa
légitimation en terre africaine est fidèle à cette orientation. Neuf
universitaires travaillant en Afrique, en Amérique, en Asie, en
Australie et en Europe y expriment leur réaction à la lecture d'un article du
professeur Ambroise Kom. Que les éminents collègues qui ont collaboré à ce numéro trouvent ici
l'expression de notre gratitude.
La relation entre l'Afrique, les anciennes puissances coloniales et le reste du
monde se trouve à un tournant décisif de son histoire. Ambroise
Kom, faisant le point des tensions et du "malaise ambiant" qui
caractérisent cette relation inégale, demande: Peut-on "valider
la recherche africaine et même africaniste en dehors de l'Afrique
elle-même? (...): sommes-nous condamnés à croupir dans la
périphérie, à nous déterminer toujours par rapport
à autrui, incapables donc de nous penser de manière autonome?
Notre recherche doit-elle se maintenir sur les sentiers tracés par/pour
les experts coloniaux ou néo-coloniaux, c'est-à-dire satisfaire
essentiellement les besoins de connaissance de l'Autre?".
La réponse à ses questions rhétoriques est à coup
sûr négative mais les mesures à prendre pour assurer un
futur plus équitable sont loin d'être évidentes.
Pour Guy Ossito Midiohouan, l'Afrique s'est trop souvent trompée de
combat. La plus grande habileté de l'Occident dans ses rapports avec
l'Afrique, dit-il, a consisté, chaque fois que ses intérêts
l'exigeaient, à détourner les Africains d'eux-mêmes, de
leurs responsabilités historiques, pour les amener à se battre,
de gré ou de force, pour sa cause et souvent contre eux-mêmes.
Prenant l'exemple du concept de francophonie imposé actuellement
à l'Afrique par la France dans le cadre sa lutte contre
l'hégémonie américaine, il suggère que ce concept
ouvre une ère de "néo-tirailleurs africains" défendant,
comme les tirailleurs sénégalais d'antan, un patrimoine qui n'est
pas le leur. Partageant les inquiétudes de Kom, il affirme: "Allons-nous
donc passer notre vie, de génération en génération,
à défendre les intérêts des autres, à
combattre pour les autres, à suer pour les autres, à mourir pour
les autres, à mourir à nous-mêmes ? Sommes-nous
condamnés à être éternellement les moyens des
autres, les tirailleurs des autres ? Le devoir incombe à notre
génération de mettre fin à cette fatalité".
Même s'ils ne partagent pas l'analyse de Midiohouan, la majorité
des commentateurs semblent d'accord pour reconnaître la
nécessité de changer de cap. Toutefois, les sources du
problème et l'action à entreprendre sont perçues de
diverses manières. Pour Lilyan Kesteloot: "nous interroger sur les
raisons de la faillite multidimensionnelle de nos institutions, comme le dit
avec anxiété le professeur Kom, eh ! oui c'est là la
vraie, la seule question". Et de souligner le rôle des facteurs de
tensions intérieures (rivalité des partis et des leaders) et les
pressions économiques extérieures (dévaluations,
fluctuation des prix des matières premières, monopole des trusts
pétroliers, ajustement structurel, etc.) qui peuvent conduire un pays au
chaos pur et simple. Mais, ajoute-t-elle, "les réponses que pour ma part
j'ose avancer ici seraient surtout de l'ordre de la gestion administrative" car
c'est l'arbitraire, la corruption, l'intérêt particulier et les
autres usages pervers qui se sont installés partout aux dépens de
l'intérêt général qui sont les vrais "cancers" de
notre société.
Néanmoins, comme le montre Patrick Bond, une bonne gestion
administrative n'a à voir ni avec les mouvements spéculatifs du
Grand Capital qui asphyxient la planète ni avec les ajustements
structuraux imposés à l'Afrique par Washington et le F.M.I.. Il
s'agit plutôt d'une gestion qui ne soit plus l'otage d'une dette
paralysante; une organisation sociale, solidement ancrée dans les
milieux locaux, qui s'appuye sur les regroupements populaires
c'est-à-dire les mouvements évangéliques et paroissiaux,
sociaux, syndicalistes, environnementalistes ou encore d'entraide
féminine. Pour Bond, le siège de la résistance, du savoir
et sa légitimation se trouve au niveau des gens eux-mêmes
plutôt qu'à celui de l'intelligentsia. Il nous appartient à
nous Africains de déterminer le sens de notre propre
développement, dit-il, et un transfert du pouvoir vers la base est
inévitable.
Innombrables sont les raisons qui font qu'un tel transfert n'est pas
aisé. O. R. Dathorne souligne par exemple que "le colonisateur n'a
souvent même plus besoin de se déplacer; ce que le F.M.I. et la
Banque Mondiale ne peuvent pas faire, d''innocents' intellectuels s'empressent
de le faire à leur place 'au nom du Père'". Quant aux idées
de développement séparé et de cadres autonomes, elles sont
toutes deux suicidaires. Par ailleurs, qui va être invité à
partager le label "Africain"? Va-t-il par exemple inclure la diaspora? Comme le
relève Gayatri Chakravorty Spivak, ce qu'il était convenu
d'appeler la périphérie occupe de nos jours une position centrale
et Dathorne d'ajouter en substence: "A nous de montrer que nous sommes plus que
'l'Autre'. Nous sommes 'Même'. Reste à déterminer de
quelle manière l'expression de cette différence originelle peut
se métamorphoser en un principe d'unicité original."
Judith van Allen remet elle aussi en question de manière vigoureuse le
bien fondé d'une approche "afrocentrique et autonome". A son avis, il
appartient aux Africanistes de toutes origines d'être attentifs aux
problèmes associés à l'héritage impérialiste
et raciste qui sous-tend le discours des Etudes Africaines. A chacun de
déconstruire ce discours et de lui en opposer un autre basé sur
des valeurs anti-impérialistes et antiracistes. Il n'est pas
nécessaire d'être Africain ou d'origine africaine pour agir de la
sorte, dit-elle. Les critères d'inclusion et exclusion ne devraient pas
être liés à l'origine des uns et des autres mais à
leur savoir, leur engagement et leur intégrité intellectuelle.
Défendant l'idée d'une répartition plus équitable
des ressources et du savoir, elle prend l'exemple d'un groupe de militantes du
Botswana dont les aspirations semblent plus proches des idéaux
féministes occidentaux que de l'attitude des élites (masculines)
locales, peu ouvertes à l'idée de partage sous couvert de
tradition. Ne rejetons pas telle ou telle idée sous prétexte
qu'elle vient de l'Ouest, suggère van Allen, mais parce qu'elle est un
frein à l'avènement d'un système démocratique
où chacun a le droit à la parole.
Bill Ashcroft exprime une idée similaire lorsqu'il écrit: "En
premier lieu, il convient d'éviter d'être tenté par
l'opposition binaire Europe/Afrique mise en place par l'impérialisme
européen. Les formes de savoir qui se sont développées sur
les deux continents sont peut-être différentes mais elles ne sont
pas incommensurables". Comme l'a montré Foucault, le pouvoir est mouvant
et circulaire plutôt que statique et oppressif. Dès lors,
l'appropriation et l'interpolation sont deux éléments susceptible
de permettre aux sociétés africaines de réconcilier un
discours dominant inadapté et les réalités locales - le
domaine littéraire fournissant peut-être les meilleurs exemples de
réussites remarquables. Tourner une relation inégale à
l'avantage des pays africains pourrait signifier développer un savoir
qui tout en embrassant l'univers technologique actuel, réponde d'une
manière originale aux besoins et aux aspirations locales. "Un savoir
dont l'autonomie ne se situerait pas au niveau de sa spécificité
mais de son fonctionnement". Selon Ashcroft , la globalisation ne peut pas
être évitée - et elle n'a pas besoin de l'être. La
légitimation du savoir ne dépend pas tant de la création
de cadres de recherche autonomes que de l'application de formes de savoir
appropriées au niveau local et de l'interpolation de systèmes
globaux par le biais d'actions locales spécifiques.
Cela ne mène pas loin de penser au progrès technologique et
scientifique en terme de suspicion, suggère Rajeev S. Patke. Les pays
anciennement colonisés n'ont pas à réinventer la roue et
les concepts de localisme, de nativisme et d'indigénisme sont tout
à fait inadaptés. Si plusieurs pays n'ont pas tenu les promesses
de l'indépendance, c'est qu'un certain nombre de facteurs ont
déterminé la marche de l'histoire: la misère qui favorise
le développement de la corruption, les erreurs de gestion et de
planification, les catastrophes naturelles et les désastres d'origine
humaine, etc. Toutefois ces éléments ne peuvent pas être
résolus par le biais du replis et de l'isolationnisme, pas plus qu'ils
ne peuvent être expliqués en terme de dichotomie soulignant
l'ancien fossé entre "Eux et Nous". Il est possible pour une nation de
choisir comment elle va faire face aux problèmes liés à
l'industrialisation et à la globalisation, dit Patke, mais elle ne peut
pas les ignorer . Essayer de tirer parti des énergies
créées par le processus évolutif auquel on assiste
aujourd'hui semble plus judicieux que de rejeter l'ensemble des
développements actuels sous prétexte qu'il ne s'agit que d'une
forme renouvelée d'exploitation néocoloniale. Si les graves
problèmes associés au monde postcolonial doivent trouver une
solution, suggère Patke, c'est sans doute dans le cadre d'une large
dissémination du savoir organisée de manière à
combler le vaste fossé qui semble se creuser entre un localisme
aggressivo-défensif et un universalisme en mal de
sincérité.
La voix autoritaire de grands maîtres a dominé l'époque
coloniale et les premières années des Indépendances. On
retrouve leur écho dans la vision de l'Afrique offerte par Kom.
En revanche, la perception de l'univers "postcolonial" que propose
Shirley Lim souligne que dans la plupart des pays d'Asie, le débat a
beaucoup évolué depuis les années 60 et qu'il a conduit
à bon nombre d'idées, d'initiatives et d'espoirs. Dans
des pays tels que le Japon, la Corée, Taiwan, Singapour, les
Philippines, la Thaïlande, la Malaisie, la Chine, etc., les relations
avec les anciennes puissances coloniales européennes ont changé,
affirme Lim. De nos jours, le discours intellectuel ne traite plus guère
des séquelles de la colonisation. Depuis plusieurs années, il
prend la forme de négociations serrées sur le thème de la
globalisation, du libre échange et du capitalisme démocratique.
Lorsqu'elles n'ont pas cours entre les pays asiatiques eux-mêmes, ces
discussions regroupent aussi bien des analystes occidentaux que des
intellectuels locaux et elles ont un impact considérable sur le
développement économique et le bien-être des populations
des pays en question. Ces débats sont considérés comme
un élément essentiel de la sécurité nationale et de
la compétitivité économique. De l'ordre du pragmatique et
non du dogmatique, les transformations sociales et culturelles sont toujours le
produit de négociations influencées par les institutions propres
aux sociétés locales.
On pourrait envisager qu'il en aille de même des relations de l'Afrique
avec le reste du monde, mais, à ce jour, tel n'est pas le cas -- du
moins en ce qui concerne les sphères dirigeantes. Une répartition
des richesses pour le moins inéquitable et les zones obscures d'un
passé récent débordant largement sur le présent
hantent les esprits et rendent tout dialogue difficile, voire impossible. C'est
ce que montre Madeleine Borgomano lorsqu'elle écrit, meurtrie: "le
raisonnement d'Ambroise Kom, apparemment ouvert, puisqu'il fonctionne
essentiellement par questions, reste enfermé dans une idéologie
close bloquant en fait, toute possibilité de réponse.
L'interlocuteur se voit assignée la position de l'Autre. Car il lui faut
bien, bon gré, mal gré, se reconnaître comme
'héritier du colonisateur', héritier aussi des ethnologues du
passé et des politiques, et comme tel, responsable du
détournement des valeurs de l'universel et du conditionnement de la
pensée africaine". Pour Borgomano -- et de fait la majorité des
commentateurs -- l'idée d'exclure "l'Autre" sur des bases plus ou moins
arbitraires a un côté pervers et paralysant qui ne profite
à personne et il convient d'essayer d'aller au delà d'une
opposition binaire réductrice, d'oser sortir des chemins battus comme
l'a fait Ahmadou Kourouma -- l'un des plus grands romanciers de l'Afrique
francophone -- oser "se regarder dans le miroir", sans complaisance.
En ce sens, la réponse de Kom aux propos suscités par son article
rejoint les préoccupations de tous les commentateurs: "C'est
peut-être un truisme mais, pour moi, le savoir n'a pas de
frontières et je milite pour que les Africains ou quiconque a le destin
du continent à coeur, butinent, partout où besoin sera, pour
trouver les matériaux utiles à la construction d'une
société à notre mesure. Incontestablement, la
mondialisation est avec nous mais pourquoi faut-il qu'elle soit à sens
unique, l'Afrique étant toujours le réceptacle des
énoncés venus d'ailleurs?"
A cette dernière question, il n'y a qu'une réponse : "Si c'est le
cas, il faut que ça change!". A nous tous d'y veiller, qui que nous
soyons, quelles que soient nos origines et où que nous vivions.
jmv
[Haut de la page] / [Table des matières
de ce numéro de MOTS PLURIELS]
Over the years, Mots Pluriels' intent has been to foster exchanges across the disciplines and to engage in a vigorous debate of major issues confronting not only universities but the world at large. This issue of the journal is no exception. It deals with the theme of "Knowledge and Legitimation" and invites readers to share in a stimulating exchange of ideas between Professor Ambroise Kom - who wrote a lead article on the topic - and nine leading scholars from Africa, Asia, Australia, Europe and America commenting on his view and to whom goes our gratitude.
The relationship between Africa, the old colonial powers, and indeed the rest of the world, is at the crossroads and Ambroise Kom's article, taking stock of institutional failures in todays' Africa, begins with a conundrum: "Are we condemned to stagnate on the periphery, always determining ourselves in relation to other people, unable to picture ourselves in an independent way. Must our research stick to the pathways mapped out by/for the colonial or neo-colonial experts?" The answer to these rhetorical questions is clearly in the negative but the way to a brighter future is more uncertain.
According to Guy Ossito Midhiohouan, Africa has fought the wrong battles for too long. Western powers have exacted an exorbitant price from the local African population and have left the continent in ruins. France's current use of the concept of "Francophonie" in its fight against American hegemony is nothing but a modern version of battles fought by the old "tirailleurs Sénégalais". Echoing Kom's preoccupations, he asks: "So are we going to spend our lives, from generation to generation, defending the interests of others"; he concludes: "the duty to put an end to such a fate is incumbent upon our generation".
That, I believe, is agreed by all contributors, but the way out of such a complex and multifaceted problematic cannot be the result of simplistic and clear-cut solutions. For Lilyan Kesteloot, the one and foremost question to ask ourselves is "What are the reasons for the multidimensional failure of the institutions?" She suggests a number of factors both internal (political tensions, rivalry between parties and their leaders and external (economic pressures, devaluation, fluctuations in commodity prices, structural adjustments) that can lead a country to utter chaos; but she adds, part of the answer would be tighter administrative management which at present is corrupted by nepotism, ethnicism and other perverse practices.
Good administrative management, as Patrick Bond shows, has nothing to do with speculative finance capital ranging uncontrolled across the globe or structural adjustments devised in Washington. Rather it means a solid "bottom-up" organisation of African society freed from the crippling effect of debt. The legitimacy of neoliberalism and global capitalism is being vigorously contested at the level of grassroots activism by churches, social movements, trade unions, environmentalists, women's organizations - rather than by the intellectuals � and the location of resistance, knowledge and legitimization is shifting to the people themselves. Bond asserts that "African ourselves must determine our own development" and that a transfer of power is inevitable.
That of course is not as easy as it seems. To begin with, "The new news is that the colonizer does not need to move to have his bidding done. As O.R. Dathorne says, what the IMF and the World Bank cannot accomplish, the very same innocent "intellectuals" cited by Dr. Kom will accomplish in the name of the Father". Conversely the ideas of "separatism" and "autonomous framework" are fraught with danger. Who will be invited to share the label "African". Would the so-called "Diaspora" be included? As Gayatri Chakravorty Spivak suggested: "The margin has indeed become the center" and Dathorne adds: "We have to show that we are more than the Other. We are the Same". What remains to be seen however is how "[the] presencing of a former otherness can become the original Same".
Judidth van Allen also vigorously challenges the usefulness of new Afrocentric autonomous frameworks. "All Africanists need to be actively self-conscious of the imbeddedness of African studies in imperialism and racism, and try to deconstruct, challenge, and counter that heritage and to reconstruct African studies from an anti-imperialist, anti-racist perspective. But you don't have to be an African or of African descent to engage in that project. The line should be drawn on the basis of politics and scholarly critical commitment and skill, not on the basis of race or national origin". Arguing the case for a broad-base sharing of knowledge, she takes the example of Botswanan women's militancy. Whereas it had been labelled by male elites as divisive, culturally imperialist and contrary to African tradition, it had much affinity with Western feminist ideals. "Let ideas not be rejected because they come from the West or any other part of the world outside Africa, but only because they are destructive to futures envisioned, desired and negotiated through public debate and democratic politics by Africans themselves", she concludes.
Bill Ashcroft expresses a similar idea when he writes: "The solution to this problem begins by avoiding the temptation to accept the binary between Europe and Africa originally installed by European imperialism. Forms of knowledge generated in the two continents may be different from each other, but they are not incommensurable". As demonstrated by Foucauld, power is productive and circulatory rather than simply static and oppressive. Thus appropriation and interpolation are key elements at the disposal of African societies in the fluctuating relationship of dominant discourse and local reality - literature providing a striking example. "Using the master's tools to dismantle the master's house" may lead to "knowledge that met local needs and local purposes but which would not need to dispense with the technologies of knowing. Its autonomy would not exist in the frame of its identity but in the manner of its operation. Globalism cannot be avoided, nor should it need to be. 'Legitimization' may not depend upon the establishment of an 'autonomous framework' of knowledge so much as a direction of appropriated forms of knowing to local uses, and the interpolation of global systems with a locally specific practice."
It is not fruitful to think of scientific and technological progress in term of suspicion, Rajeev S. Patke argues. Formerly colonized countries do not have to reinvent the wheel. Localism, nativism and indigenizing impulses are stultifying. A whole raft of reasons may have led to many countries failing to deliver on the promises of independence, among which are poverty that breeds corrupt rule and administration, poor social planning, natural and man-made disasters etc.. However these factors can neither be satisfactorily understood nor overcome by falling back on isolationism and "the old dichotomous mould of Us versus Them." There are choices to industrialization as policy, but hardly to whether new nations should or should not walk that path, Patke argues. Utilizing the energies of the process for one's nation seems a more constructive plan than to reject it as neocolonial exploitation. If anything, it is "the widespread dissemination of knowledge, accomplished in such a way as to avoid the schism between an aggressive-defensive localism versus a disingenuous universalism" that could possibly provide a solution to the distressing problems of postcoloniality; problems that are at their ugliest in so many places.
Powerful voices which have dominated colonial and early post-independence discourses are echoed by Kom in his perception of Africa. In contrast, Shirley Lim's analysis of Asia suggests that debates on identity and polity have moved on, generating new ideas, new directions, new hopes. Based on her experience of Asian countries such as Japan, Korea, Taiwan, Singapore, the Philippines, Thailand, Malaysia, China, etc., she shows how relationships to the old colonial powers have changed. Intellectual discourses are seldom about the continued psychological damage of colonial history. Rather, for a number of years now the relational discourse has taken the shape of discussions on globalization, free trade competition, and democratic capitalism. "These debates engage both Western analysts and native intellectuals, and they have large material bearing on the economic development and well being of people in these territories. These debates are seldom criticized as extracontinental; they are approached as vital to national security and economic competitiveness". She contends that cultural transformation and social formation are always the product of negotiation mediated by societies' local institutions: pragmatic rather than dogmatic.
That may well be the way of the future in the relationship between Africa and the rest of the world, but at present it is not - or at least not at the level of officialdom. The shadows of the past and the inequities of the present are big hurdles in the way of meaningful dialogue. Negotiation is difficult or indeed downright impossible. As Madeleine Borgomano puts it, "closed ideology blocks any possibility of reply". Assigning either "the African" or "the person of non-African descent" to the position of the Other has a paralysing effect and she, together with Dathorne and indeed most of the commentators, share the idea that "More than the Other, we are the Same". Mentioning the example of Ahmadou Kourouma and others, she suggests it is time to leave Afropessimism behind and to move forward.
A view also shared by Kom who writes in his rejoinder: "It may be a truism but, for me, knowledge has no borders and I am militating for Africans, or anyone at all who cares about the continent's destiny, to gather from wherever they need to those materials required to construct a society that measures up to us. Indubitably, globalisation is with us but why does it have to be a one-way street, with Africa always being the receptacle of declarations from elsewhere?"
A simple answer to his question is: "It does not have to be so." Lets work together to make sure that it doesn't.
jmv
[Haut de la page/ Top] / [Table des matières de ce numéro de MOTS PLURIELS] / [Back to contents]