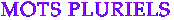
no 9. February 1999.
https://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP999skg.html
© Sélom Komlan Gbanou
dans la nouvelle de Sewanou Dabla
Sélom Komlan Gbanou
Universität Bremen
| Le récit bref est, dans sa morphologie, une survivance de l'oralité. En Afrique notamment, il n'a pas été institué par l'écriture mais par les contes dont il tire à la fois la matière et l'esthétique. Il permet d'intégrer dans la littérature les préoccupations et le discours des basses couches de la société avec leurs croyances mythiques d'où découlent les explications du monde. Ainsi, le recueil de nouvelles de Séwanou Dabla Leur Figure-là, publié sous le pseudonyme de Towaly, représente une expérience d'écriture du conte ewe. [1] |
| Du conte à la nouvelle |
Dans la première partie de Leur Figure-là, qui donne son nom à l'oeuvre, le tissu narratif est morcelé en huit récits brefs, mélange d'anecdotes et de merveilleux. La narration est plaisante et elle inscrit le récit dans le cadre de l'infini et de l'inachevé. La technique est propre au genre mystique de gli qui fait de chaque récit, quoique autonome, le maillon d'une chaîne ininterrompue ou toute fin est recommencement. Les huit récits ne sont pas modulés autour d'un thème central mais alternent comme dans une veillée de contes ou l'on retrouve les mêmes personnages. Ce sont des fragments juxtaposables d'une seule et même histoire dans laquelle trône le même acteur: Leuk le lièvre dans les Contes d'Amadou Koumba de Birago Diop (1961) ; Kakou Ananzé l'araignée dans Le Pagne noir de Bernard Dadié (1955), etc. Dabla choisit aussi d'inclure un personnage qui revient dans la plupart des récits, Bossou-le-scandale, c'est-à-dire un personnage qui joue le rôle de monstre - symbole de laideur physique et morale - omniprésent dans le conte ewe sous le nom de nukpekpe. Ainsi se dégage, pourrait-on dire, une alliance entre la nouvelle et le conte. Les deux genres opèrent par une mise en forme et en scène du monde sur le mode de la parabole. Comme le conte, la nouvelle propose, non sans subjectivité, une lecture explicative du monde, de la mentalité humaine. Comme le montre la récurrence de Bossou, un stéréotype du monstre humain, la nouvelle devient le lieu où l'écrivain renoue le mieux avec la force de la parole orale qui sait utiliser les images et les symboles pour dénoncer et critiquer les malaises sociaux. A l'instar du monstre des contes qui tue, détruit, hante les êtres doués de raison, le "Bossou" de Dabla est un personnage sanguinaire, une malformation génétique et psychologique comme on le lit dans les dernières lignes de "Métro nouveau" (pp. 9-14) :
- Soudain, tout explosa et, au milieu de Dugan, une masse informe apparut. Comme
le vilain fétiche Légba, un amas de ferrailles, de briques et
d'ossements humains toisait arrogamment la ville et le pays tout entier.
Les "klakés", ces intellectuels qui veulent toujours trouver quelque chose à dire en toute circonstance, le baptisèrent "La Démagogie". Le peuple dans son murmure préféra "Bossou" (le scandale). (Métro nouveau, p.14)
La nouvelle "Bossou-le-scandale" constitue un gros plan du personnage de Bossou laissé en suspens dans "Métro nouveau". La technique qui consiste à enchaîner un récit par l'élément final du conte précédent est propre aux veillées, où après avoir écouté un conteur, un membre de l'auditoire connaissant un autre conte parlant du même personnage, prend la relève. Il peut, pour annoncer le conte qu'il va raconter, interrompre le conteur en charge à un point culminant de son récit en utilisant la formule "j'étais témoin, ce jour-là quand la scène se passait". A ce moment-là, il chante une chanson qui énonce son récit et, à la fin, rend la parole au conteur en lui disant: "continue !".
L'enchaînement d'histoires centrées sur un même personnage permet une mise en relief de ce dernier. En optant pour cet artifice propre à l'oral, Dabla semble vouloir aller dans ses nouvelles jusqu'au au bout de son portrait de "Bossou" qui, en définitive, est un référent textuel de dictateur. Pour la société traditionnelle, le conte est une tribune commode pour attaquer les rois et les seigneurs en feignant le mensonge. Le conte est le lieu où le mensonge est vérité et la fiction réalité. Tout y est convention implicite. Dabla part de cette légitimité du mensonge fictionnel pour écrire ses nouvelles et cherche à provoquer l'esprit critique du lecteur, à solliciter sa complicité. Les voix conteuses dans ces nouvelles, au-delà de l'affabulation, cherchent à redire le monde et la réalité.
Tout comme le conte, la nouvelle permet de fictionnaliser la dictature politique et d'indexer des figures réelles bien connues de manière absolument badine, et, paradoxalement, en mettant en garde les personnes présentes contre toute confusion avec la réalité. On n'est pas loin de la formule plaisante que nombre de romanciers mettent en exergue à leurs oeuvres: "Toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé relève de la pure imagination". Bossou n'existe que dans l'univers du récit. Tant mieux si l'imagination du lecteur croit le trouver partout:
-
Hélas, tous ces Oyé, toutes ces ripailles vides n'avaient rien de
dernier. Bien vite on fut obligé d'écouter ce chercheur - l'un de
ces types qui mettent leurs yeux, leur nez partout dans le ciel, les livres,
les ventres, les têtes et sous-terre - reconnaître et
décrire Bossou en Asie et en Amérique Latine... Bossou le
scandale avait investi la ville, par ses fondations, bouffé tout le pays
village par village pour finalement le déborder à gauche et
à droite! "(Bossou-le-scandale, pp. 19-20)
L'imagination et l'imaginaire sont fortement influencés par le cosmopolitisme - fondement de l'universalité des contes. Dabla convoque des mondes lointains et inconnus, celui des fantômes, mais il place ces rencontres sous le signe de la modernité. Désormais, ce ne sont plus les monstres à sept têtes, les cyclopes..., que découvre le lecteur, mais les métros, les dictateurs, les intellectuels..., autant de personnages qui se retrouvent au coeur de récits ancrés dans le merveilleux. Bossou fonctionne comme les monstres mutants des contes qui, sous l'apparence de princes charmants, séduisent de belles filles qu'ils dévorent par la suite. Dans les premières nouvelles, Bossou se retrouve sous les traits du "Vieux Bon Papa" (p.9), un chef d'Etat qui a offert un luxueux métro à la population pour susciter sympathie et admiration. Mais une fois acquise la confiance de ses concitoyens, le "Vieux Bon Papa" va entreprendre un phénomène de transfiguration et révéler sa vraie nature : celle d'un monstre. La stratégie de séduction par laquelle les monstres des contes flattent leurs futures proies avant de s'en emparer est en tout point identique à celle mise en oeuvre par Le Bossou de Dabla.
Bien ancrées dans la réalité, les nouvelles du recueil font cependant montre d'une grande richesse inventive et elles refusent tout ancrage topologique précis. C'est comme si tout se passait au niveau de la parole et que l'écriture elle-même finissait par devenir une mise en scène de cette parole. A l'instar du conte qui est avant tout théâtre par la parole et théâtre de la parole, les nouvelles de Dabla s'autorisent toutes formes d'audace. Leur imitation du conte est si bien réussie que dans certaines d'entre elles, telles que "La Fontaine fatale" (pp. 57-58), "Le Grand Maître" (pp. 59-60), "Le Fou de l'Université" (pp. 61-64)..., l'histoire s'efface sous la fulgurance de cette "oralité du récit" dont parle Jean-Pierre Aubrit[2]:
- Alors Kanli a donc été gâté. Sans pitié.
Tué Kanli pour la deuxième fois! Ni les gris-gris de Bocco, ni
les prières à Na'a Maria n'ont rien pu" (p. 59).
Les artifices de l'écrit et la spontanéité du récit oral ne se distinguent plus. Tous deux font appel aux formules incantatoires, à des personnages aux prises avec des situations difficiles et cherchant à dédoubler un pouvoir qui leur assurera une ascendance certaine.
-
- Ata Kokodabi! La lune mange-t-elle le soleil ? p. 41
| Les lieux stratégiques |
La dette de la nouvelle par rapport aux contes ne se limite pas à la dérision sociale et à l'emprunt d'une langue spontanée très proche de la performance du conteur traditionnel sachant faire du récit un spectacle de la parole. L'introduction et le dénouement, qui représentent deux lieux stratégiques du conte, inspirent aussi Dabla qui les adapte parfaitement à son écriture.
Le conte ou l'anecdote ewe débute toujours par la formule "mi se gli !" (écoutez le conte !) ou "mi se asse'n!" (écoutez l'anecdote !) selon le genre. Cette formule introductive crée d'emblée une relation phatique avec l'auditoire dont elle sollicite l'attention et la participation. Elle instaure un dialogue entre le conteur et l'auditoire:
-
- Conteur: mi se gli / mi se asse'n
- Auditoire : gli ne va / asse'n ne va (que le conte vienne / que l'anecdote vienne)
-
Joka marcha et marcha encore des saisons. Il traversa l'Afrique et atteignit
le pays des Blancs. Il s'arrêta en Autriche et en Angleterre. Il voulait
savoir le Joka, connaître la vérité des hommes par
lui-même. Il s'étonna de quelques détails tel ce silence
plus lourd que plomb qui le frappa aux abords de la Grande Forêt, telles
ces cages dans lesquelles s'entassaient les banlieusards d'Europe...
- C'est pas des cages. C'est des appartements ! Ton Joka-là n'est pas fort !
- Joka même? Attendez la suite avant de crier ainsi sur sa tête ! (p. 26)
Parallèlement, le conte pérennise l'éphémère et le ponctuel pour en faire le reflet de la société. On retrouve le même phénomène dans les nouvelles de Dabla. Ses récits saisissent un événement dans sa banalité ou sa précarité pour en faire une constante de certaines classes sociales. Par exemple, dans les contes, l'Araignée ne représente jamais qu'un petit insecte : c'est toujours un signifiant à signifiés multiples. De même, Mosha Dayon, dans la nouvelle "Mosha Dayon" (pp. 38-40), est plus qu'un homme, il est un monstre: la figure de l'omnipotence militaire, du soldat tropical qui se donne, en toute impunité, le droit de vie et de mort sur ses concitoyens. "Chef de la sécurité" de son état, ce personnage a pour devise "Moi zé su né pou tué" (p. 39) et il tue qui il veut, quand il veut et comme il veut, avec une arrogance qui frise la folie:
-
A toutes les tables du bar, le silence s'assit, mystérieusement. Et le
calme aussi, comme après une tornade. Mosha se tourna et se retourna:
personne. Il hocha la tête, se dirigea vers le bar où il se servit
une bière qu'il but lentement tout en dévorant des brochettes.
Puis il rota, sortit, domina la ville de ses yeux-foudres avant de partir dans
la nuit. Seul. Et tout-puissant. (p. 40)
La place de conteur traditionnel qu'il occupe conduit le narrateur-conteur de Dabla à s'intéresser au contenu de ses paroles et à leur forme. Les voix sont multiples mais comme dans les performances orales, leur hétérogénéité n'implique en aucun cas une anarchie du système discursif des textes. Elles instaurent au contraire une situation de jeu au sein de la communauté et excluent de ce fait toutes les règles d'une hiérarchisation de la société. L'enfant peut intervenir dans un cercle de conte réunissant des adultes pour motiver le récit ou y injecter un grain d'humour. La nouvelle respecte elle aussi cette stratégie du discours-conteur et rappelle le "principe de coopération" défini par Grice dont le principe fondateur est le suivant: "que votre contribution conversationnelle corresponde à ce qui est exigé de vous au stade atteint par celle-ci, par le but ou la direction acceptés de l'échange parlé dans lequel vous êtes engagé[3]". Il n'existe pas d'incises dans les nouvelles de Dabla. Les voix narratives qui alternent et se suppléent dans une parfaite harmonie, sont anonymes. Elles viennent d'un auditoire diégétique auquel le narrateur-conteur s'adresse tout en lui appartenant:
-
Trois jours pus tard arrive de Paris un Yovo froid et sérieux comme un
sorcier. Un Yovo appelé, logé, nourri, véhiculé et
payé à grands frais. Deux millions disaient certains; cinq
affirmaient d'autres, la main sur la bouche.
- Yééguéé ! Cinq, les camarades ! Cinq millions !
[...] On admira le Yovo à la valise:
-Quoi qu'on dise, non, les Yovos sont forts. Mawou !... Mais on se rappela que le Vié... Et puis le Yovo à la valise l'avait félicité, non? ("L'Aizéniais", p.52)
Le second lieu stratégique où l'écriture de Dabla déploie sa parenté avec le conte est le dénouement. Plutôt que de conclure ses nouvelles en faisant tout rentrer dans l'ordre par un revirement spectaculaire, un "whip-crack ending" comme disent les américains, Dabla préfère achever ses récits en laissant le lecteur sur sa faim. Les nouvelles s'achèvent alors que le noeud du problème n'est pas encore résolu. Et il appartient à l'auditoire et au lecteur de proposer une réponse aux questions du narrateur-conteur : "Qu'auriez-vous fait à la place?" ou "quelles leçons faut-il tirer de ce récit ?". C'est au lecteur insatisfait de résoudre l'énigme, provisoirement, car la fin d'une nouvelle ou d'un conte ne fait que signaler le début d'un ou d'une autre.
Parfois, le narrateur-conteur semble tourner en rond et la structure cyclique de la nouvelle ramène le lecteur à la case de départ. La fin n'est pas un aboutissement en soi. Par exemple, le récit de "La fontaine fatale" offre en gros plan l'un des nombreux accidents qui se succèdent aux abords d'une fontaine située en plein périmètre urbain, là où s'entrecroisent des rues au "bitume en plaques d'eczéma" prises d'assaut par des conducteurs imprudents. Alors qu'on pourrait s'attendre à une nouvelle débouchant sur une amélioration de la situation , le récit tourne en rond et s'achève sur une note d'angoisse et de désespoir. L'insouciance des dirigeants face au sort qui frappe la masse appartient au non-dit, mais on devine que c'est là que réside le problème qui va se répéter à l'infini:
-
Après-demain certainement; dans un mois sûrement. D'autres morts,
dans un an. Devant la fontaine. La fontaine fatale, l'unique fontaine dans un
rayon de mille mètres (p. 58).
Au lecteur comme à l'auditoire de répondre: "Nous l'avons reçu."
| Conclusion |
Plus proche du conteur que d'un narrateur romanesque omniscient, le narrateur-conteur de Dabla s'affiche comme une simple voix conteuse, soucieuse de rapporter une histoire dans la plus stricte neutralité. Un subtile dosage de fantastique, de merveilleux et de réel souligne la dette de la nouvelle par rapport au conte, même si, en choisissant de substituer le classique rapport Homme-Animal - épicentre du fantastique dans le conte - par des tensions entre humains, Dabla inscrit son oeuvre dans une perspective sociale contemporaine. Héritière du conte qui, chez tous les peuples africains, est un puissant agent régulateur de la morale sociale, la nouvelle, en se voulant conteuse, entend utiliser la parole du peuple opprimé pour fustiger les nouvelles mentalités introduites dans la société par la bureaucratie, la technologie et les nouvelles donnes politiques.
Notes
[1] désigné par les termes de gli ou d'asse'n selon sa longueur et son origine mystique ou profane.
[2] Jean-Pierre Aubrit. Le Conte et la nouvelle. Paris: Armand Colin, 1997.
[3] H. P. Grice. "Logique et communication". Communication 30, 1979, pp. 60-61.
[4] La mise en scène facile de la pluralité des voix qu'offre le conte est à la base de la multiplication au Togo des groupes comme le ZITIC et le ZIGAS qui jouent les contes sous forme de théâtre.
Bibliographie
Bernard Zadi Zaourou. "Traits distinctifs du conte africain". Revue de Littérature et d'Esthétique Négro-Africaine No2. Abidjan: NEA-ILENA, 1979, pp. 19-21
Dénes Lenhyel. "Transfiguration et quiproquo dans deux contes hongrois". Le Conte. Pourquoi? Comment. Paris: Editions du CNRS, 1984, pp. 595-612.
Gérard Genette. Seuils. Paris: Seuil, Coll. Poétique, 1987, p.8.
Gillian Lame-Mercier. La Parole romanesque. Les Presses universitaires d'Ottawa, 1989, p. 103.
Jean-Pierre Aubrit. Le Conte et la nouvelle. Paris: Armand Colin, 1997
Joseph-Marie Awouna. Contes et Fables. Etude et compréhension, Clé, Yaoundé, 1979.
Séwanou Dabla. Les Couleurs du monde. Illustrations de Catherine Roy. Mayenne: Eclats d'Afrique, 1988.
Tohonou Gbeasor. "Un genre littéraire oral: L'alobalo", in Littérature togolaise. Volume II. INSE-UB, Série B, No2, 1987, pp. 107-123.
Towaly, alias Séwanou Dabla. Leur Figure-là. Paris: l'Harmattan, 1985.
Yves-Emmanuel Dogbé. "Misegli ou l'esthétique d'une création littéraire", in La tradition orale. Source de la littérature contemporaine en Afrique. Dakar-Abidjan-Lomé: NEA, 1984, pp. 99-109.
Né en 1964 au Togo, Sélom Komlan Gbanou a fait des études
de littératures générales et comparées, de
sémiologie et communication à l'université du Bénin
au Togo. Enseignant et journaliste, il a dirigé la rédaction de
l'hebdomadaire satirique togolais Kpakpa Désenchanté de
1990 à 1995 et a écrit des pièces de théâtre
dont Le Bal des fous, créé à Lomé en 1989 et
A chacun son cercueil (1995). Depuis 1995, il vit en Allemagne
où il termine une thèse de littérature africaine à
l'université de Bremen où il dirige la revue Palabres, une
publication africaine de l'université de Bremen.
Ses publications comprennent entre autres un recueil de nouvelles et de poésie Soldatesques, Edition New
Leaf Press, Universität Bremen, 1998, 56 p. ISBN 3-88722-421-3 et plusieurs articles critiques :
"Dénomination et écriture dans le théâtre de
Sénouvo Zinsou ", Bayreuther Frankophonie Studien, Hg.
Jànos Riesz/Véronique Porra, Edition Schultz & Stellmacher,
Bayreuth, 1998, pp. 147-163. "Entre Aristote et la Bible : Toko Atolia, un exemple de tragédie en
langue africaine ", Palabres, Vol. II, No 1&2,
Théâtre d'Afrique et des Caraïbes, Bremen, 1998, pp.
63-76. "Dramatic Esthetics in the Work of Sénouvo Agbota Zinsou ",
Research in African Literature, Volume 29, Number 3, Indiana University
Press, 1998, pp. 34-57.
Back to [the top of the page] [the contents of this issue of MOTS PLURIELS]