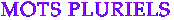
no 9. February 1999.
https://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP999js.html
© Jean Sob
dans la nouvelle camerounaise.
Jean Sob
Université de Yaoundé 1
De tous les genres littéraires que nous offre l'histoire de la littérature, le genre de la nouvelle est le moins codifié. Depuis sa naissance au XVe siècle, la pratique a souvent tenu lieu de règle et, plus que pour tout autre genre, quelques grands auteurs, de temps en temps, ont constitué la norme. La nouvelle a connu une évolution irrégulière, elle n'a intéressé que très rarement les théoriciens de la littérature, et partant, a souffert d'un manque d'identité. C'est ainsi que la nouvelle n'est définie que par rapport aux autres genres littéraires fixes, par rapport au roman, au conte, à l'histoire ou au journalisme, presque jamais en elle-même. On connaît à ce sujet les formules sarcastiques de René Etiemble:
- Depuis les nouvelles des renaissances on ne fait que parler de la
renaissance de la nouvelle; au XIXe, au XXe siècle. Comme si ce genre
périodiquement périclitait ou décédait " [1]; ou bien la nouvelle est "partout
présente, mais insaisissable ; existante, mais sans essence" [2] et cette ironie condescendante d'André
Gide qui ne manque pas de sel:
"La nouvelle est bien près de former un genre depuis qu'elle doit se limiter aux exigences de la revue et du journal."[3]
Cependant, comme on va le voir, l'incertitude qui frappe la nature de la nouvelle et son statut dans l'histoire littéraire, le mépris dont elle a été l'objet en France ne semblent pas avoir découragé les écrivains africains de jeter leur dévolu sur ce genre littéraire.
En examinant un corpus représentatif de nouvelles camerounaises, nous avons constaté que les auteurs de nouvelles du Cameroun ont su tirer parti de la souplesse des critères de la nouvelle; ils ont vu en elle un genre littéraire simple, libre, ouvert, pouvant encadrer plusieurs possibles narratifs à partir de menus incidents quotidiens. Certains écrivains africains ont vu dans la nouvelle un genre littéraire où la prise de parole sur le plan technique et stylistique peut se réaliser sans avoir beaucoup de contraintes à surmonter. Ils ont eu quelquefois à exploiter les débats qui ont été engagés sans être clos au sujet de la nouvelle à travers l'histoire littéraire, pour lui imprimer une identité narrative qui leur est propre, et la manier dans le sens des mythologies de leur écriture.
Ainsi, quand les écrivains africains ont eu à donner une fonction citoyenne à la littérature, et à cause de l'inexistence jusqu'à une date récente de la presse indépendante sur le continent noir, ils ont vu dans la nouvelle le genre idoine pour véhiculer les idées nouvelles, et surtout pour faire entendre la voix des oubliés ou plus précisément la voix des censurés de l'histoire officielle dans la plupart des pays africains pendant et après la colonisation. Tel est visiblement l'avis d'Alexandre Kum'a Ndumbe III quand il déclare dans l'introduction - manifeste à son recueil de nouvelles au titre évocateur Nouvelles Interdites:
- Pourquoi Nouvelles Interdites?
Parce que la vérité est nécessaire à la démarche historique de notre peuple.
A l'heure des grands affrontements sur le continent africain, des complots et des trahisons, à l'heure des marchandages sordides de certains gouvernants avec les puissances étrangères, fossoyeurs de l'Afrique, à l'heure des répressions barbares perpétrées par les Africains contre les Africains, du muselage de nos peuples, de la désintégration galopante de nos sociétés, l'homme d'Afrique se doit de crier tout haut la vérité sur les bouleversements qui affectent le continent. C'est son devoir le plus absolu. Mais justement, sous nos cieux, l'index frappe la vérité comme la foudre s'abat sur l'arbre.[4]
La nouvelle est selon Kum'a Ndumbe III la voie royale pour atteindre ce noble objectif assigné à la littérature et il va même plus loin en trouvant dans la nouvelle comme genre littéraire des qualités qui peuvent aider les écrivains à résoudre les difficultés de communication culturelle qui se posent à eux.
"La nouvelle comme genre littéraire s'adapte-t-elle à l'Afrique actuelle ?"[5] s'interroge-t-il. Après avoir énuméré les problèmes qui se posent à l'écrivain africain, problème de langue d'écriture, difficulté subséquente de faire passer son message, problèmes d'édition, Kum'a Ndumbe III place, en réponse à son interrogation, la nouvelle en bonne position dans la hiérarchie des genres littéraires qui s'offrent aux auteurs africains:
- Moins que le film, la nouvelle, plus que le roman, le poème, l'essai et
peut-être le théâtre, s'adapte mieux à cette
situation culturelle difficile. Courte, elle se lit rapidement, sans trop de
peine, elle transmet le message en peu de mots. La nouvelle est mieux
accessible à une couche plus large et moins scolarisée que celle
des intellectuels, elle s'offre plus aisément à la traduction dans
les langues africaines. C'est pourquoi nous proposons au lecteur les nouvelles interdites
relatant des bouleversements et événements dont l'Afrique seule,
peut-être, détient la clé du mystère.[6]
L'étude attentive de la plupart des nouvelles camerounaises nous a permis de découvrir que pour exprimer la socialité camerounaise dans son intégralité, les auteurs - certainement tributaires de leur formation scolaire à l'époque coloniale compte tenu de la place accordée à la période classique dans les programmes scolaires - ont exploité des notions comme l'invraisemblance, le vraisemblable et le vrai, élaborées par l'esthétique classique pour la nouvelle.
En effet Kibedi Varga note qu'à l'époque classique, " La nouvelle est considérée comme une forme d'art narratif qui permet de réagir contre les invraisemblances du roman héroïque des générations précédentes "[7]; d'où le débat engagé à l'époque par des auteurs comme Donneau de Visé ou Saint-Réal au sujet des rapports entre la nouvelle et l'histoire. Or, nous savons qu'à l'invraisemblance, l'esthétique classique a opposé d'une part le vraisemblable, entendu comme le réel censuré, purgé de tout ce qui peut choquer le jugement ou les moeurs de la classe dominante à un moment donné de l'histoire, et d'autre part le vrai, c'est-à-dire le réel socio-historique tel que saisi par l'historien. Inspirés par ces éléments de l'esthétique classique en matière de nouvelle, les écrivains camerounais ont considéré la nouvelle comme une réaction contre les invraisemblances de l'idéologie coloniale et néocoloniale telles qu'elles ont été répandues pendant la colonisation et après la décolonisation. Le texte de la nouvelle camerounaise sera fortement dépendant du hors-texte; la socialité de la matière de la nouvelle est en rapport de complémentarité indissoluble avec la société de référence, c'est-à-dire la société africaine en général et la société camerounaise en particulier d'où elle part et où elle trouve tout son sens.
Le sens des mots dans les nouvelles, leur connotation péjorative ou méliorative, l'appréciation des situations, la célébration de certains personnages et dates historiques et la censure imposée à d'autres ne peuvent se comprendre en profondeur qu'au regard du hors texte que les oeuvres désignent, et qui désigne les oeuvres.
Ainsi, au mythe de la mission civilisatrice de la colonisation à laquelle les Africains auraient adhéré, au mensonge colonial qui présentait, pour le besoin de la cause l'Afrique comme un peuple de bons sauvages, sans héros ni patriotes, un peuple fourré dans les réserves, un musée vivant d'ethnologie pour la culture occidentale et chrétienne comme le disent les blancs eux-mêmes,[8] Eza Boto dans Sans haine et sans amour,[9] oppose en écho le soulèvement kikuyu au Kenya dans les années 50, soulèvement dont les grondements indiquent sans équivoque le réveil des peuples africains et le sens de leur avenir. La marche de Momoto, le héros de la nouvelle d'Eza Boto sur Nairobi, marche longue, incertaine mais résolue à contribuer à la libération de son pays de l'occupant anglais, est un symbole fort qui souligne que l'Afrique était loin de succomber aux charmes de la nouvelle rhétorique humaniste, de tomber dans le piège des arguties et des discours démagogiques élaborés par les puissances coloniales au lendemain de la deuxième guerre mondiale, à l'instar de la Conférence de Brazzaville et des lois-cadres diverses. Elle était plutôt prête à se donner tous les moyens, juridiques, politiques, diplomatiques et même militaires pour arracher son indépendance et rétablir sa dignité bafouée par de longues années d'esclavage et de colonisation. Cette lutte multiforme des peuples africains, appuyée diplomatiquement par une bonne frange de la Communauté internationale va pousser les puissances à lâcher leurs colonies, ou tout au moins à un changement de stratégie. Aussi vont-elles dans un premier temps rendre la lutte plus complexe en ralliant une fraction d'Africains à leur cause; en semant ainsi la discorde et la confusion parmi les noirs, les colonisateurs écartelaient les forces des combattants de la libération entre l'ennemi extérieur, l'homme blanc, et l'ennemi intérieur constitué de leurs complices africains. C'est ce qui désole Momoto car, d'après le narrateur de Sans haine et sans amour:
-
S'il haïssait les Blancs, il méprisait surtout leurs amis noirs
qui, à ses yeux, étaient des lâches, des traîtres,
des gens en qui leurs ancêtres ne se reconnaîtraient pas, s'ils
revenaient à la vie. Néanmoins, pour des raisons sentimentales,
il lui répugnait beaucoup de tuer ces derniers. En fait, c'est cette
répugnance à tuer les siens qui l'avait amené peu à
peu à hésiter et finalement à avoir peur puisqu'alors sa
conviction de bien faire diminuait considérablement.[10]
Dans un second temps, après avoir réduit les forces patriotiques par une répression barbare, les puissances coloniales vont accorder un semblant d'indépendance à leurs colonies, en prenant soin d'installer leurs amis au pouvoir: écoutons le vieux Momba
-
L'indépendance ne tarda pas à s'annoncer, car après des
siècles de travaux forcés et d'exploitation sans merci, tout le
continent africain se mit en branle. Le colon fut pris de panique et voulut
déserter. Mais il se remit bientôt de sa peur, visa juste et
devint le marchand des indépendances. Armé d'un énorme
régime de bananes des indépendances, il en offrait à tout
passant affamé, et espérait ainsi apaiser la tempête
à peine déchaînée.
"Comme ils aiment tellement bouffer, ces nègres, il faut leur donner autant de bananes des indépendances que possible!" se disait le colon en douce, et avec générosité il jouait son rôle de bienfaiteur.[11]
En Afrique en général et au Cameroun en particulier, le repli de la colonisation a sécrété des forces sociales qui relèvent du vraisemblable et du vrai, à savoir d'une part les forces sociales qui hier combattaient l'idée d'indépendance des colonies, et à qui les puissances coloniales ont remis le pouvoir pour imposer l'ordre néocolonial, et d'autre part les forces sociales nationalistes qui ont combattu, quelquefois les armes à la main, pour la libération de leur peuple, forces sociales nationalistes qui ont été étouffées par l'ordre néocolonial. D'où les relations étroites entre la nouvelle camerounaise et l'histoire, en vue de dévoiler la causalité complexe des rapports sociaux camerounais.
C'est le souci de Patrice Kayo dans ses nouvelles, où le thème de l'indépendance revient comme un leitmotiv; dans la nouvelle La fête, au sujet des dignitaires du nouveau régime, il note :
-
L'indépendance les avait en quelque sorte surpris, mais ils s'en
accommodaient si bien. La vie n'est-elle pas un savoir-faire, un
perpétuel accommodement, et le sage n'est-il pas ce
caméléon qui sait prendre la couleur du milieu où il se
trouve ? Hier, la plupart d'entre eux demandaient à ceux qui luttaient
pour l'indépendance: "Comment pouvez-vous vouloir
l'indépendance, alors que nous ne savons pas encore fabriquer une
aiguille". Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui chantent en se vautrant
dans les orgies: "Vive la République indépendante et
démocratique de Todjom". Tous ceux qui luttaient pour
l'indépendance sont morts... C'est après les avoir
exterminés que le pouvoir colonial a gratifié de cette
indépendance ceux qui ne le voulaient pas, convaincu de leur
indéfectible attachement à la mère-patrie. [12]
Le thème revient avec insistance dans la nouvelle Chronique des premiers jours de liberté d'un ancien déporté ; écoutons le constat amer que dresse ce martyr de la liberté:
-
Il semble que l'indépendance pour laquelle sont tombés presque
tous les patriotes de ma génération a été
finalement conquise. L'armée d'occupation a capitulé et a
évacué. J'ai survécu à toutes les tortures. Notre
martyre n'aura donc pas été inutile. Partout, il n'y a que des
nègres au commandement : les sous-préfets, les Préfets,
les Ministres et même le remplaçant du gouverneur de la colonie,
sont des noirs... Une chose m'intrigue. Je n'arrive pas à comprendre
pourquoi nos frères qui ont hérité de ce pouvoir ont
continué à nous pourchasser, à nous emprisonner et
à nous massacrer comme l'ancien occupant blanc. Nous ne luttions contre
personne, mais pour la seule libération de notre pays. Pourquoi nos
frères ont-ils hérité aussi de la haine du colon ? ...
Pour avoir voulu et lutté pour cette indépendance, on nous a
exilés, exécutés, déportés.[13]
- (Al) Il doit exister une procédure, reconnue par convention,
dotée par convention d'un certain effet, et comprenant
l'énoncé de certains mots par certaines personnes dans
certaines circonstances. De plus
(A2) il faut que, dans chaque cas, les personnes et circonstances particulières soient celles qui conviennent pour qu'on puisse invoquer la procédure en question.
(B1) La procédure doit être exécutée par tous les
participants, à la fois correctement et
(B2) intégralement.
(C1) Lorsque la procédure - comme il arrive souvent - suppose
chez ceux qui recourent à elle certaines pensées ou certains
sentiments, lorsqu'elle doit provoquer par la suite un certain comportement de la
part de l'un ou de l'autre des participants, il faut que la personne qui prend
part à la procédure (et par là l'invoque) ait en fait ces
pensées ou sentiments, et que les participants aient l'intention
d'adopter le comportement impliqué. De plus
(C2) ils doivent se comporter ainsi, et par la suite
si nous pêchons contre une (ou plusieurs) de ces six règles, notre
énonciation performative sera (d'une manière ou d'une autre)
malheureuse. [14]
-
Il y a des mots dans la vie qui sont capables de bouleverser
irréversiblement le système : Indépendance. Alors, avant
qu'il ne soit trop tard, avant que les fils du pays ne prennent sérieusement
la situation en main avant qu'ils ne réalisent leur rêve, eh bien on
accepte. D'accord pour
l'indépendance, déclare l'occupant. Il le proclame tout haut et
s'arrange dans l'ombre pour s'installer mieux que jamais. Bien, alors, il
nomme un nègre qui a combattu avec acharnement pour le colon. [15]
Comme l'acte a été accompli malgré son énonciation malheureuse, la décolonisation n'a été qu'un abus[16] puisque ceux qui l'ont conduite n'avaient aucune qualité morale ni légitimité politique pour le faire. Ce fut une énonciation "sans effet" ne veut pas dire "sans conséquences, résultats ou effets"[17]; et les conséquences, résultats et effets de cet échec de l'indépendance seront dramatiques pour le peuple camerounais.
Pour les auteurs de nouvelles camerounais, tous les malheurs qui se sont abattus depuis lors sur leur pays, sur le plan politique, socio-économique et sur le plan culturel trouvent leur étiologie dans l'échec de cet acte fondateur de la nation que fut la proclamation illégitime de l'indépendance.
Ainsi en va-t-il de la répression aveugle contre les patriotes devenus de vulgaires "bandits"[18] de vils criminels ou "des maquisards"[19] irresponsables. Toute contestation, toute prise de conscience sont réprimées sans mesure : emprisonnements, déportations sans procès, pendaisons; aucun moyen n'est épargné, les imaginations sont créatives pour inventer toujours plus de techniques de tortures pour réduire tous ceux qui sont tentés de remettre en cause la légitimité de l'indépendance.
Ainsi en va-t-il du système économique qui prévaut après l'indépendance; véritable esclavage déguisé qui consiste à faire travailler tout un peuple pour satisfaire les besoins des autres:
-
On dit que le pays se développe continuellement. Et d'une
manière auto-centrée. Puisque ceux qui travaillent ne jouissent
pas du fruit de leur travail. Les paysans travaillent pour les bourgeois
nationaux et ceux-ci pour ceux des anciennes métropoles.[20]
Cultures de rente, exportations des matières premières, toute l'économie des pays africains est conditionnée par la volonté de l'étranger qui régularise le flux des produits, décide unilatéralement de leur qualité, fixe les prix à sa guise:
-
Les blancs avaient tout arrangé avec minutie, depuis bien des
décennies pour que toute l'économie africaine ne soit
orientée que vers les besoins européens, au détriment de
la population noire. Aussi, des pays tels que le Sénégal ne
vivent que d'arachide, puisqu'il fallait au blanc une vaste plantation
d'arachide et que le Sénégal est vaste et produit bien
l'arachide.
C'est pourquoi le nord ne pouvait connaître l'expansion industrielle du Sud de l'Afrique, étant condamné à la monoculture en particulier et à l'agriculture en général.[21]
La conséquence de tout cela, c'est le règne de la pauvreté et de la misère qui écrasent le peuple qui se bat au jour avec philosophie pour survivre.
C'est ce que nous voyons dans Trois petits cireurs, nouvelle de Francis Bebey. La lutte que les trois petits cireurs mènent au quotidien contre la pauvreté et la précarité est à la fois un chant d'espoir et une épopée de la résistance à la fatalité historique. Ecoutons Francis Bebey qui se fait poète pour la circonstance:
-
La fin du monde n'est pas proche. L'arbuste qui fleurit auprès de la
lave encore brûlante porte en lui l'espoir d'une terre qui se moque
éperdument des volcans en feu ... et l'enfant qui naît est
semblable.[22]
Il en est de même de l'aliénation culturelle dont le peuple africain en général et camerounais en particulier est victime depuis l'avènement des soleils des indépendances. L'aliénation culturelle comporte deux aspects : il y a d'abord celle des jeunes africains qui subissent un nouveau système éducatif extraverti qui transmet un savoir de bas niveau, juste bon à les préparer à singer l'homme blanc:
-
Les enfants ne devront plus s'exiler pendant des années pour aller
acquérir la formation nécessaire dans les pays des blancs, la
néo-colophonie venait d'investir des sommes gigantesques pour la
construction d'une présence permanente mais invisible. Alors, on vit
des savants d'occasion affluer de toutes parts, des affamés
d'idéalisme venir inculquer aux enfants de la nation des savoirs cuits
dans les fours néo-colophones.[23]
De plus, la fin ultime de cette école n'était pas en réalité la formation des jeunes pour le développement de leur pays, c'était tout simplement un prétexte pour enrichir les multinationales d'édition de la métropole:
-
Les enfants de six ans qui n'avaient jamais ouvert un livre devaient en
posséder six dès qu'ils franchissaient le seuil de
l'école. Six ans et six livres dans une langue jamais articulée
! Etait-ce pour leur faire comprendre dès le départ qu'ils
avaient déjà perdu beaucoup de temps, qu'il leur fallait rattraper
six ans, six ans d'une enfance sans savoir, six ans d'une vie au-delà
des barrières de l'école du blanc ? Et plus les parents
achetaient, plus les enfants en perdaient... Les couvertures des livres
changèrent de couleur, mais les éditeurs restèrent les
mêmes, et chacun d'eux se félicitait du profit sextuplé en
un rien de temps dans son commerce avec l'Afrique. La néo-colophonie,
inventée comme un jeu, devint une esthétique des
indépendances, à la grande joie des hommes d'affaires de la
métropole.[24]
Et que dire des films de mauvaise qualité, - tel Jango, le Voleur d'occasion -[25] qui envahissent le pays et qui encouragent le grand banditisme chez les jeunes?
C'est ainsi que les valeurs morales saines sont oubliées, au profit d'une culture de l'argent, qui devient le paramètre d'exclusion sociale:
-
L'argent a déjà détruit toutes les vertus de notre
société. Pour le riche, tout est permis. Le pauvre n'a que des
devoirs. [26]
A titre d'exemple, l'entrée en classe de sixième dans un établissement public du pays ne se fait plus sur concours, il faut acheter une place auprès du chef d'établissement.[27]
Ensuite, il y a un autre aspect de l'aliénation culturelle du petit peuple qui consiste à le maintenir dans l'ignorance, à encourager les us et coutumes obsolètes. Il devient une proie facile pour les marabouts, le charlatans, les sorciers de tout genre et les politiciens démagogues. C'est ce à quoi René Philombe s'attaque, avec l'humour féroce qu'on lui connaît, dans Lettres de ma Cambuse [28], et surtout dans Histoires-queue-de-chat [29] . Et l'auteur prend soin dans son avertissement au lecteur de Histoires-queue-de chat, de souligner qu'il cherche à sensibiliser son public "à certaines pratiques qui, pareilles à des boulets aux pieds des esclaves, entravent la marche en avant."
Au terme de notre investigation, il nous est permis de dire que la nouvelle camerounaise est une écriture de la socialité. La socialité ici, c'est tout ce qui manifeste dans la matière du texte la présence, hors de la nouvelle, d'une société de référence et d'une pratique sociale qui consiste à réagir aux invraisemblances et au vraisemblable par le vrai. D'Eza Boto à Patrice Kayo en passant par Francis Bebey, Alexandre Kum'a Ndumbé III et René Philombe, pour ne citer que ceux-là, il s'agit d'opposer le vrai au vraisemblable (c'est-à-dire une version de la réalité qui n'a que l'apparence du vrai), la vérité au mensonge et au trucage, le réel à la fiction et l'artifice, bref, d'opposer aux nouvelles autorisées, parce qu'elles véhiculent des contrevérités, les nouvelles interdites qui réhabilitent la vérité historique de la société camerounaise. Pour tous ces auteurs, l'avenir de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier passe par une lutte sans merci contre "la néo-colophonie" comme le fait Kum'a Ndumbé III, par une impitoyable chasse anti-acridienne à laquelle se livre Patrice Kayo et par une charge féroce contre les traditions rétrogrades comme le fait René Philombe, pour dégager l'horizon du continent.
Certes, d'aucuns diront que ce faisant, les auteurs de nouvelles camerounais sacrifient quelque peu la forme pour le fond, l'art pour la communication, et apportent ainsi de l'eau au moulin des détracteurs qui disent que nouvelle et journalisme se confondent. Ils auront peut-être raison pour leur part. Cependant, comme le dit si bien le philosophe iranien Daryush Shayegan,
On ne peut comprendre l'art d'un peuple sans saisir l'esprit qui le motive, l'âme qui le nourrit et le coeur où il s'épanouit. Si l'esprit qui anime les canons culturels de ce peuple se modèle au gré de son génie, il puise aussi à une source plus ancienne où s'abreuvent tous les esprits de tous les peuples. C'est pourquoi chaque peuple a sa mémoire, qui est comme un fleuve jaillissant de la source des images primordiales. La mémoire relie le présent au passé et celui-ci à l'avenir; elle accumule l'histoire de la race, rassemble ses trésors, en transmet les messages à ses enfants fidèles." [30]
Que doivent faire les artistes quand l'esprit du peuple est étouffé, son génie bridé, sa mémoire verrouillée? Ne faudrait-il pas d'abord consacrer son talent à leur libération avant de se lancer à la conquête des formes artistiques d'avant-garde qui ne peuvent se nourrir que par l'âme et ne peuvent s'épanouir que dans le coeur d'un peuple libre politiquement, économiquement et culturellement?
Au total, depuis la décolonisation, l'histoire officielle, au-delà du discours démagogique, présente la société camerounaise telle qu'elle est, c'est-à-dire sous la botte du néocolonialisme par l'entremise du pouvoir local soumis à l'ancien oppresseur; mais la nouvelle camerounaise présente la société camerounaise telle qu'elle devrait être si les forces sociales qui ont contribué à sa libération étaient réhabilitées. La spécificité de la nouvelle camerounaise réside dans le fait qu'au lieu d'être "la conclusion d'un roman non écrit"[31] comme le dit Abdallah Laroui, elle est plutôt l'introduction d'un roman à écrire, pour célébrer la mort des forces sociales rétrogrades et déployer l'épopée des forces sociales patriotiques historiquement étouffées.
Notes
[1] R. Etiemble. Essai de littérature (vraiment) générale. Paris: Gallimard, 1975, p. 220
[2] Ibidem, p. 236
[3] A. Gide. "Interview Imaginaire", VIII, in le Figaro littéraire. 27/12/1941
[4] A. Kum'a Ndumbe III. Nouvelles interdites. Lyon: Editions Fédérop, 1978, p. 9
[5] A. Kum'a Ndumbe III. Op. cit. p. 10
[6] Ibidem, p. 11
[7] A. Kibedi Varga. "Pour une définition de la nouvelle à lépoque classique". Cahiers de l'Association internationale des enseignants de français, n0 18, Mars 1966
[8] A. Kum'a Ndumb III. Op. cit., p. 217
[9] Eza Boto. "Sans haine et sans amour", in Présence Africaine, n0 14, 1953, p. 213-220
[10] Eza Boto. Op. cit., p. 217
[11] A. Kum'a Ndumbé III. "Le vieux Momba", in op. cit., p. 21
[12] P. Kayo. "La Fête", in Tout le long des saisons. Paris: Editions Silex, 1983
[13] P. Kayo. "Chronique des premiers jours de liberté d'un ancien déporté", in Les Sauterelles. Yaoundé: Editions Clé, 1986, p. 67
[14] J.L. Austin. Quand dire, c'est faire. Paris: Editions du Seuil, 1970, p. 49
[15] A. Kum'a Ndumbé III. Op. cit., "La pendaison du Commandant Bibila", p. 112
[16] J.L. Austin dit qu'on peut "baptiser du nom d'abus les échecs qui ont eu lieu quand l'acte est accompli". Op. cit., p. 50
[17] Ibidem, p. 51
[18] P. Kayo. "Les bandits", in Les Sauterelles, p. 25
[19] Nouvelles interdites, p. 112
[20] "Chronique des premiers jours de liberté d'un ancien déporté", in Les Sauterelles, P. 73
[21] "La fuite du jeune Matlala", in Nouvelles interdites, p. 127
[22] Fr. Bebey. Trois petits cireurs. Yaoundé: Editions Clé, 1972, p. 62
[23] "Le vieux Momba", in Nouvelles interdites, p. 27
[24] Ibidem, p. 22
[25] "Jango, le voleur d'occasion", in Nouvelles interdites, p. 53
[26] Tout le long des saisons, p. 38
[27] "Concours d'entrée en sixième", in Tout le long des saisons, p. 49
[28] R. Philombe. Lettres de ma Cambuse. Yaoundé: Editions Clé
[29] R. Philombe. Histoires-queue-de chat. Yaoundé: Editions Clé, 1971
[30] D. Shayegan. Les illusions de l'identité.Paris: Editions du Félin , 1992, p. 95
[31] A. Laroui A. L�idéologie arabe contemporaine. Paris : Maspéro, 1967, p. 205.
Bibliographie
A - Ouvrages généraux et articles
John Langshaw Austin. Quand dire, c'est faire. Paris: Editions du Seuil, 1970
René Etiemble. Essai de littérature (vraiment) générale. Paris: Editions Gallimard, 1975
André Gide. "Interviews imaginaires VIII", in Le Figaro littéraire, 17/12/1941
Abdallah Laroui. L'idéologie arabe contemporaine. Paris: Editions Maspéro, 1967
Daryush A. Shayegan. Les illusions de l'identité. Paris: Editions du Félin, 1992
Kibédit Varga. "Pour une définition de la nouvelle à l'époque classique", in Cahiers de l'association internationale des enseignants de français, n0 18, Mars 1966
B - Nouvelles
Francis Bebey. Trois petits cireurs. Yaoundé: Editions Clé, 1972
Eza Boto. "Sans haine et sans amour", in Présence Africaine, n0 14, Paris 1953, p. 213-220
Patrice Kayo. Tout le long des saisons. Paris: Editions Silex, 1983
Patrice Kayo. Les Sauterelles. Yaoundé: Editions Clé, 1986
Alexandre Kum'a Ndumbé III. Nouvelles interdites. Lyon: Editions Fédérop, 1978
René Philombe. Lettres de ma cambuse. Yaoundé: Editions Clé, 1964
René Philombe. Histoires - que - de chat. Yaoundé: Editions Clé, 1971
Dr. Jean Sob est Docteur en Littératures et Civilisations d'expression française. Ses publications comprennent : Le genre de la nouvelle dans la littérature négro-africaine d'expression française : Etude historique. (Thèse de doctorat Université de Paris -Sorbonne,1984). "Tout le long des saisons, nouvelle de Patrice Kayo" et "Vies de femmes, roman de Delphine Zanga Tsogo" in Dictionnaire des oeuvres Littéraires de langue française au sud du Sahara sous la direction de A.Kom. (I.S.P. San-Francisco-London,1996). Son aticle "Ressources du capital religieux et projet créateur dans l 'La Main Sèche' de Tchicaya U Tam'si" est à paraître).
Jean Sob est actuellement enseignant à la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines, Université de Yaoundé I, Cameroun
Back to [the top of the page] [the contents of this issue of MOTS PLURIELS]