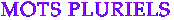
no 8. Octobre 1998.
https://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP898abo.html
© Angèle Bassolé Ouédraogo
Histoire d'une conquête
Angèle Bassolé Ouédraogo
Université d'Ottawa
|
Commençons par une anecdote. J'ai terminé mon cursus scolaire
et universitaire de Lettres en Afrique (Côte d'Ivoire, Burkina Faso) sans
jamais voir une seule oeuvre de femme inscrite au programme. Je savais
pourtant que des écrivains femmes, il en existait, puisque je les
lisais. C'est une écriture récente (quoique les premiers
écrits datent déjà de 1958), me dira-t-on.
Peut-être, mais née une décennie après les
indépendances africaines, je n'ai pas connu l'ère de "nos
ancêtres les Gaulois" figurant dans les manuels d'histoire
africaine! Alors, comment se fait-il que les seuls écrivains dont on me
parla furent Senghor, Césaire, Sembène, Tchicaya, Lopès et
autres? Pourtant, des femmes et pas des moindres écrivaient
déjà, se faisaient reconnaître sur le plan international
par des prix prestigieux et demeuraient néanmoins absentes de
l'institution littéraire africaine. La plupart des multiples
anthologies de littérature africaine ignoraient leur présence et
les champs du savoir (universités et écoles) observaient un
silence total sur leur travail de création. Depuis 1994, un regain d'intérêt semble se manifester à l'égard de cette écriture féminine africaine avec la publication d'anthologies et d'études qui intègrent les créations des Africaines, mais il émane la plupart du temps d'universitaires occidentaux et de quelques rares Africains vivant en dehors du continent. Mais sur le continent même, c'est toujours le silence ou presque à tel point que lorsque j'amorçai ma thèse de doctorat portant sur l'écriture poétique des Africaines, mes professeurs sur un ton de raillerie me demandèrent : "qu'y a t-il à dire sur ce sujet?" . Réaction qui m'aurait découragée si je n'étais pas déterminée et convaincue qu'ils se trompaient largement. Ma détermination les fera me donner raison 5 ans plus tard lorsque ces mêmes professeurs me diront en me félicitant : "tu avais un sujet en or" . Cette anecdote n'avait pas pour but d'orienter les feux des projecteurs sur ma modeste personne mais d'esquisser les contours du contexte dans lequel les Africaines parviennent à l'écriture. C'est une écriture qui émerge du silence et rencontre encore un autre silence, celui de l'institution. Dans cet article, j'essaierai de montrer comment les femmes ont cherché à s'approprier la parole qui était jusque là le seul privilège des hommes qui parlaient et écrivaient en leurs noms. Comment s'effectue leur quête d'identité dans ce contexte social qui les ignore? Quelle Afrique projettent-elles à travers leurs écrits? |
De 1930 à 1960, la littérature africaine sub-saharienne est majoritairement le fait d'hommes. De l'époque des revendications sociales menées par le mouvement de la Négritude à l'octroi des indépendances de 1960, on n'entend et ne voit que les hommes. Aux sphères de décision, ils sont toujours là, parlant et agissant au nom de tous au point où l'on est tenté de se demander si des femmes existent dans ce milieu!
Et pourtant! le continent africain est numériquement dominé par les femmes depuis toujours et son histoire regorge de hauts faits dont les actrices sont des femmes. Si dans ce contexte, on aime évoquer avec fierté ces grands noms féminins de l'histoire africaine : la Princesse Yennenga (Burkina), la Reine Pokou (Côte d'Ivoire), la Reine Sarraouinia (Niger), on est, par contre, moins enclin à reconnaître quelque mérite aux femmes en général dans l'aboutissement des luttes sociales et l'essor du continent. Les femmes sont les chevilles ouvrières de ce développement mais ce sont des militantes de l'ombre.
Lorsque la littérature africaine émerge, ce sont les hommes qui la portent sur les fonds baptismaux et c'est à travers leur regard qu'on découvre les Africaines.
L'absence de celles-ci de la production littéraire s'explique d'une part par les fondements socioculturels des sociétés africaines et d'autre part par des facteurs externes. En effet, éduquées dans un environnement social qui leur dicte la discrétion jusqu'à l'effacement, les femmes n'apparaissent presque jamais au-devant de la scène.
Or, l'écriture est un acte public. Comment les Africaines qui n'avaient pas droit à la parole auraient-elles eu ce droit à l'écriture?
C'est pourquoi leurs débuts dans cette arène se feront de façon timide. Ainsi, les premiers écrits de femmes passent pratiquement inaperçus bien que publiés à Paris. C'est le cas notamment du poème d'Annette M'Baye [1] et de l'autobiographie de l'adolescente Marie-Claire Matip.[2].
Il faut attendre 1975 (Année internationale des femmes) pour voir émerger ici et là quelques voix féminines. À la faveur de cette année donc, la production des femmes va s'accroître avec l'entrée en scène de la Malienne Awa Kéita, des Sénégalaises Nafissatou Diallo, Kiné Kirama Fall, Aminata Sow Fall, Awa Thiam, Mariama Bâ, de la Camerounaise Wèrèwèrè Liking, de la Congolaise Clémentine N'Zuji, etc.
Plus de deux décennies plus tard, une nouvelle génération de romancières et de poètes a pris le relais et de nombreuses oeuvres exceptionnelles ont été publiées, mais il existe encore un déséquilibre notoire non seulement entre le nombre d'oeuvres publiées par des femmes et par des hommes, mais aussi entre le sérieux et l'attention critique apportés aux premières et aux seconds, ceci en dépit des nombreuses femmes primées lors de concours littéraires variés (Bernadette Sanou : Prix de poésie Jean Cocteau 1995; Calixthe Beyala : Grand Prix du Roman de l'Académie Française 1996; Fama Diagne Sene : Prix du Président de la République [Sénégal] 1997, etc.)
Si les structures des sociétés africaines font que les femmes ont tendance à jouer les seconds rôles, il y a aussi des facteurs externes comme l'école interdite aux filles dès les débuts de la colonisation par les missionnaires catholiques peu ouverts à l'émancipation féminine. Les difficultés rencontrées de nos jours par l'école africaine - décrites entre autres par Ambroise Kom dans son ouvrage [3] sur l'école camerounaise qui n'est guère différente de celle de bien d'autres pays. Ces difficultés ne permettent pas de favoriser l'éducation et la scolarité des filles, bien au contraire, et ces dernières sont toujours très largement délaissées. L'instruction étant un préalable à toute prétention à l'écriture, on comprend que les femmes exclues du processus de scolarisation ne puissent pas accéder aussi facilement à l'écriture.
La seconde cause de la venue tardive des femmes à l'écriture est la division sexuelle des tâches qui confère très peu de temps aux femmes. De plus en plus nombreuses sont les femmes qui occupent des postes à hautes responsabilités en Afrique mais ces nouvelles tâches, si importantes soient-elles, ne libèrent jamais la femme de ses devoirs de mère, d'épouse et c'est à elle qu'incombe toutes les tâches ménagères. Il y a donc un problème de disponibilité quand on sait que l'écriture requiert énormément de temps, de concentration et de tranquillité.
La troisième cause est liée au poids des traditions tenaces. Dans l'Afrique traditionnelle, les femmes n'ont pas droit à la sphère publique. On ne les retrouve pas sous l'arbre à palabre où tout se décide : "Dans ce monde, les lots des femmes ont trois noms qui ont la même signification : résignation, silence, soumission[4]." Quand bien même les femmes sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses à assurer la survie tant économique que sociale de l'Afrique, à tous les niveaux, les forces traditionnelles se refusent à évoluer et s'obstinent à maintenir la femme dans une condition subalterne.
Dans cette logique, il paraît évidemment inadmissible qu'elles occupent le devant de la scène par l'écriture, d'où les réticences auxquelles elles font face, de la création à la diffusion de leurs oeuvres :
-
Je ne peux pas porter plus longtemps cette secrète terreur que
ces critiques ont engendrée dans mon âme. Je suis
véritablement effrayée par le pur poids originel de ces
attaques. En dehors de la peur, j'éprouve aussi de la rage[5].
En prenant la plume, les femmes africaines transgressent ainsi une loi tacite de leurs sociétés. Par l'écriture, elles signent leur premier acte de rébellion contre ces sociétés qui ont toujours fait d'elles de simples spectatrices. Elles usurpent la parole interdite pour ne plus se laisser raconter mais pour raconter elles-mêmes leur histoire. Comment seraient-elles perçues socialement? Mariama Bâ nous donne la réponse :
-
Dans toutes les cultures, la femme qui revendique ou proteste est
dévalorisée. Si la parole qui s'envole marginalise la femme,
comment jugera-t-on celle qui ose fixer pour l'éternité sa
pensée?[6]
Les écrivaines africaines apparaissent donc comme des personnes qui dérangent l'ordre ancien. Ce qui n'est pas du goût de chacun. Le témoignage de pionnières telles que Kaya ou Aidoo est révélateur :
-
Une femme qui présente un manuscrit ressent beaucoup d'ironie
à son égard. Le Prix d'une vie a été
très lu par des femmes de tous les âges [...]. Toutefois, bien
des hommes m'ont exprimé leur gêne et, à la sortie du
livre, certains journalistes m'ont presque insultée [7]
Presque tout le monde prend les femmes écrivains pour une plaisanterie ou pire encore. Ceci comprend aussi bien les éditeurs, les agents littéraires que tous ceux qui profitent de notre labeur[8]
En prenant la plume, les Africaines ont brisé l'étau de leurs propres peurs et rompu ce pacte du silence qu'elles observaient jusque-là. Cependant, rien ne leur est encore acquis car aujourd'hui comme hier les difficultés s'amoncellent et les victoires d'hier et d'aujourd'hui ne font souvent que dessiner les contours de la bataille à livrer demain :
-
Par l'acte même d'écrire, la femme prend très vite
conscience qu'elle pénètre dans un monde fermé, depuis
longtemps modelé par et pour les hommes [...]. L'écriture en
tant qu'institution et non en tant que pratique ne s'offre jamais à la
femme. Elle doit biaiser, saper cet énorme bloc gris à la base
pour pouvoir obtenir droit de cité[9].
Vaincre sa peur, braver le qu'en-dira-t-on et rompre le silence s'avère donc insuffisant pour garantir aux écrivaines africaines une place au sein de l'institution littéraire. Elles doivent encore se battre pour détruire cet autre silence qui accueille leur création :
-
Women Writers of Africa are the other voices, the unheard voices, rarely
discussed and seldom accorded space in the repetitive anthologies and the
predictably male-oriented studies in the field[10].
Ce constat datant du début des années 80, donc bien avant la publication des travaux des critiques femmes sur le sujet, est d'autant plus intéressant qu'il est le fait d'un homme. Le silence de la critique littéraire africaine, s'il a pu être justifié au début par l'absence des Africaines de la scène littéraire, s'explique difficilement au début des années 1990 car :
-
Bien que numériquement faible, la proportion des femmes
écrivains n'est cependant pas négligeable. Elle passe pourtant
inaperçue dans les anthologies et les revues critiques. Le monde
feutré de l'édition n'a la part que trop belle, grâce
à la censure de facto qu'il exerce à l'occasion sur les
publications pour s'assurer d'un corpus canonique à
l'homogénéité presque univoque[11].
Aujourd'hui, rien ne saurait plus justifier ce qu'on serait tenté d'appeler le "culte des célébrités mâles " , c'est-à-dire une mise à l'écart de l'écriture féminine qui demeure toujours d'actualité alors que les femmes désirent sortir de la périphérie d'où a émergé leur discours. Mais comment quitter ce lieu de la marginalité dans lequel s'est forgé leur parole quand le centre ne les entend pas? :
-
Reiterating the concern with women's silence acknowledges the fact that if
women have made significant social advances by challenge and accommodation, by
opposition, resistance, and subversion, their enforced silence - in particular
the denial or limitation of their literate expression - remains nonetheless a
common and painful reality[12].
La parole qui bute contre le silence ne finit-elle pas par s'éteindre, lassée de toutes ces tentatives infructueuses? La détermination qu'affichent les écrivaines leur sert de rempart au découragement. Cette exclusion ne les empêche pas de continuer à écrire car elles ont compris que l'écriture pouvait être une arme efficace contre ce poids des traditions qui pèse sur elles. Le message de leur consoeur Mariama Bâ retentit encore en elles:
-
Comment ne pas prendre conscience de cet état de fait agressif? Comment
ne pas être tenté de soulever ce lourd couvercle social? C'est
à nous, femmes, de prendre notre destin en mains pour bouleverser
l'ordre établi à notre détriment et ne point le subir.
Nous devons user comme les hommes de cette arme, pacifique certes, mais
sûre, qu'est l'écriture[13].
Continuer à écrire donc, c'est la seule façon pour ces femmes de se sentir exister. Écrire devient alors pour elles une véritable libération et c'est dans cette perspective que la plupart d'entre elles perçoivent leur pratique de l'écriture. Tanella Boni, à la question de savoir pourquoi elle écrit, répond : "Je n'en sais rien. Peut-être pour ne pas mourir[14]." L'écriture devient ainsi un moyen de survie. Écrire pour survivre face au quotidien hostile, écrire pour se faire reconnaître socialement, le défi est énorme mais ces femmes semblent déterminées à le gagner. Tuer par la plume ce silence qui les oppresse, telle semble être la mission qu'elles se donnent dans la poursuite de leur quête d'écriture. Elles nous parlent d'elles mais aussi de ce continent africain qui leur tient tant à coeur :
-
Ce continent le leur
avec sa forme en hache
surréelle ou une houe de labour dans la boue
dans le sable bavait sous leurs yeux angoissés
partagés en quatre en cinq cinquante
minuscules gâteaux de fête ce continent le
leur faisait figure de foire sous leurs yeux
éplorés[15]
-
J'aimerais être moi tu aimerais être toi
nous aimerions être nous être nous être
nous au nom du chaos casse-cou[16]
Bien qu'ayant des raisons d'être amères, les écrivaines africaines n'abondent pas dans la voie d'une écriture vindicative. Si elles se servent de la plume comme d'une arme, c'est dans le sens de la construction. En dénonçant le silence qui les entoure mais aussi l'atmosphère malsaine qui mine tout l'espace social dans lequel elles vivent (injustices, corruptions, dictatures), elles apportent leur pierre à l'édification d'une société où le soleil brillera enfin pour tous :
-
Je voudrais être foudre et éclair
Avoir pouvoir de mettre
L'espoir là où l'espoir manque[17]
Nous bâtirons pour lui
Des fermes claires
Et des maisons en dur
Nous ouvrirons les livres
Et soignerons les plaies
Nous donnerons un nom
À chaque mendiant du coin
Et habillerons de basin
Les plus petits d'entre eux
Il faut savoir bâtir
Sur les ruines des cités
Savoir tracer
Les chemins de liberté[18].
-
Mais tu es encore là la mémoire en lambeaux
Sur cette Terre en poussière et tu murmures
il y a des misères partout tu passais par là
un de ces jours tu pensais immobile
comme le Pouvoir il y a des misères partout
alors les misères t'ont répondu en choeur
comme des mains ouvertes oui bien sûr il
y a des femmes partout comme des nuages
dans l'air du Temps[19]
La problématique de l'existence d'une écriture féminine africaine ne peut s'analyser sans tenir compte de son contexte d'émergence. Ce contexte d'émergence renferme un topos, celui du silence, délimite un espace, celui de la marginalité. Le discours des femmes qui s'élabore après une trop longue période de silence porte les marques de l'ostracisme et se confronte au discours hégémonique patriarcal. Souvenons-nous que :
-
L'hégémonie, ce n'est pas seulement ce qui, dans la vaste rumeur
des discours sociaux, s'exprime le plus haut, le plus fort, ou se dit en
plus d'endroits. Ce n'est même pas du tout cette dominance
quantitative. L'hégémonie est un ensemble de mécanismes
qui imposent sur ce qui se dit et s'écrit de l'acceptabilité et
stratifient des degrés et des formes de légitimité.
L'hégémonie est donc à décrire, formellement comme
un canon de règles et d'impositions légitimantes et,
socialement, comme un instrument de contrôle, comme une vaste synergie
de pouvoirs, de contraintes, de moyens d'exclusion, liés à des
arbitraires formels et thématiques[20].
Notes
[1] Annette M'Baye. Poèmes africains. Paris : Centre national français, 1965.
[2] Marie-Claire Matip. Ngonda. Paris : Bibliothèque du jeune Africain, 1958.
[3] Ambroise Kom. Éducation et démocratie en Afrique : le temps des illusions. Paris : L'Harmattan, 1996.
[4] Ahmadou Kourouma. Monné, outrages et défis. Paris : Seuil, 1990, p. 130.
[5] Ama Ata Aïdoo. "To be an African Woman Writer. An overview and a detail" . Criticism and Ideology. Uppsala : Scandinavian Institute of African Studies, 1988, p. 170 (traduction d'Irène Assiba d'Almeida).
[6] Mariama Bâ. "Fonctions politiques des littératures africaines" . Écriture française dans le monde. Vol. 3. no 5, 1981, p. 6 .
[7] Simone Kaya in Jean- Marie Volet et Ormerod Beverley. Romancières africaines d'expression française : Le Sud du Sahara. Paris : L'Harmattan, 1994, pp. 81-82.
[8] Ama Ata Aïdoo. "To be an African Woman Writer. An overview and a detail" , p. 165.
[9] Irma Garcia. Promenade femmilière. Recherches sur l'écriture des femmes. Paris : des femmes, 1981, p. 29.
[10] Lloyd Brown. Women Writers in Black Africa. Westport : Greenwood Press, 1981, p. 67.
[11]Irène Assiba d'Almeida et Sion Hamou. "L'écriture féminine en Afrique noire francophone : le temps du miroir" . Études littéraires. Vol. 24. no 2, 1991, p. 42.
[12] Irène Assiba d'Almeida. Francophone African Women Writers : Destroying the Emptiness of Silence. Gainesville : University Press of Florida, 1994, p. 1.
[13] Mariama Bâ. "Fonctions politiques des littératures africaines" , p. 7.
[14] Tanella Boni in Jean-Marie Volet et Ormerod Beverley. Romancières africaines d'expression française : Le Sud du Sahara, p. 49.
[15] Tanella Boni. Grains de sable. Limoges : Le bruit des autres, 1993, p. 11.
[16] Tanella Boni. Grains de sable, p. 56.
[17] Kiné Kirama Fall. Les Élans de grâce. Yaoundé : Clé, 1979, p. 38.
[18] Véronique Tadjo. Latérite. Paris : Hatier, 1984, p. 22.
[19] Tanella Boni. "Cordes de femmes" in Grains de sable, p. 51.
[20] Marc Angenot. "Pour une théorie du discours social : problématique d'une recherche en cours" . Littérature, no 70, 1988, p. 300.
Dr Angèle Bassolé Ouédraogo
est titulaire d'une Maîtrise ès Lettres (Université de Ouagadougou),
d'un Doctorat en Lettres (Universié d'Ottawa) et d'un Diplôme de Journalisme,
(Université de Montréal). Elle a enseigné au Burkina Faso, d'où
elle est originaire, et au Canada. Elle combine son métier d'enseignante avec
ses activités de Journaliste-reporter et de Chroniqueur.
Son intérêt pour la littérature féminine africaine
en général et la poésie en particulier date de plusieurs
années et elle a entre autres contribué au dévelopement du site
Lire les femmes
Angèle Bassolé Ouédraogo prépare le
1er Salon de la
littérature Féminine Africaine
et le Forum des Africaines
qui devraient avoir lieu à la
fin de l'année à l'Université de Ougadougou. Elle convie chacun
et chacune à y participer.
Back to [the top of the page] [the contents of this issue of MOTS PLURIELS]