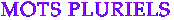
no 12. Décembre 1999.
https://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP1299soe.html
© Editions Donniya
Salem ould Elhadj
Les arts à Tombouctou
Editions Donniya, Bamako
Tombouctou, la cité des 333 saints. Carrefour de plusieurs cultures, la ville a conservé des traditions artistiques et artisanales bien particulières.
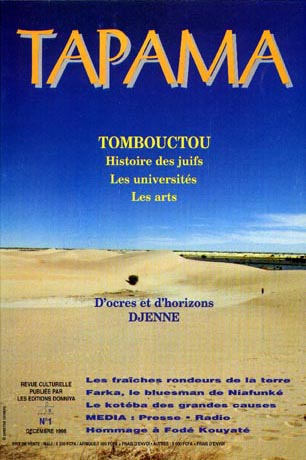
Cet article a été publié dans la Revue culturelle
TAPAMA
no1, 1996, pp.11-18.
Reproduit avec l'aimable autorisation des Editions Donniya.
This article may not be
published, reposted on the web, or included in a CD-Rom without written permission from Les Editions Donniya.
Tombouctou, cité historiquement célèbre située entre le monde blanc et le monde noir, à la lisière du désert, est une terre de rencontre. De riches commerçants, d’habiles artisans et de fins lettrés venaient de tous les horizons à la recherche de fortunes ou en quête de savoir. Très tôt, une forte immigration de Soudanais, de Maghrébins et d’Arabes du Moyen-Orient s’installa dans un climat d’échanges et de commerce. Cette position centrale de la cité fur favorisée également par la politique d’ouverture de certains de ses souverains tels que Kankou Moussa, Aquil Ag Meloual et Askia Mohamed. En 1591 arrivèrent les soldats du pacha Jouder (Marocains et Européens) à Tombouctou qui en firent la capitale du pachalik arma. L’influence de toutes ces communautés marqua profondément la vie sociale et culturelle des populations autochtones de Tombouctou. La cité sut tirer des vicissitudes de son histoire et des multiples dominations qu’elle a connues (peul, toucouleur et française) un très grand profit. Au cours des ans, elle apprit savamment à observer, à enregistrer, à accumuler lentement mais sûrement les riches expériences des uns et des autres pour ensuite les digérer et les faire siennes.
Au XVIe siècle particulièrement, les Tombouctiens adoptèrent une nouvelle philosophie de vie basée sur l’instruction, le commerce et l’artisanat. Cette population très laborieuse et très riche créa et adopta plusieurs folklores tirés du riche patrimoine soudano-saharien.
| Influences orientales et orales |
La vie culturelle, tant dans ses aspects immatériels qu’artistiques, a subi l’influence arabe et moyen-orientale. Les éléments de cette influence se retrouvent dans les parures, les costumes traditionnels et l’architecture.
Concernant l’art culinaire, si les aliments à base de mil et de riz sont des mets provenant du sud, ceux à base de blé sont inspirés surtout du Moyen-Orient. Les Tombouctiennes excellent dans la préparation de cette dernière céréale. Elles peuvent en composer douze mets différents (couscous, pain, sahal finta, dogol loma, widjila, toucassou, etc.).
Dans le domaine linguistique, contrairement au sonraï de Gao, celui de Tombouctou est fortement teinté de vocabulaire arabe. On reconnaît aisément certains de ces vocables sonraï. Ils commencent tous par l’article al. En sonraï, on appelle le maçon al banna et en arabe al bannâ.
Tombouctou, plus que toute autre ville noire, a subi une forte influence orientale et arabe et fut, au XVIe siècle, la grande métropole religieuse du Soudan.
Cette cité se glorifie jusqu’à nos jours de tous ces symboles, à savoir ses 333 saints, anges gardiens de la ville, ses trois célèbres mosquées et ses innombrables bibliothèques de langue arabe aux livres jalousement conservés dans plusieurs familles.
Le brassage des populations du Nord et du Sud, la vie intellectuelle intense et la grande richesse d’antan poussèrent les Tombouctiens à se divertir malgré la désapprobation de l’Islam. Les ethnies et les corporations créèrent leur folklore et parfois même en importèrent, comme le bambara-toubal.
| Le folklore aristocratique : m’Bâga |
Au début, l’unique instrument musical était une sorte de violon, hérité probablement de la civilisation hispano-mauresque et introduit par les musulmans d’Andalousie. En effet, des musulmans d’Andalousie venaient s’installer à Tombouctou et professer comme le saint patron de la ville Sidi Yahiya Al Andalousi, mort en 1470.
L’instrument se composait d’une calebasse de 20 à 25 centimètres de diamètre. Son ouverture était recouverte d’une peau de biche ou d’outarde. Une baguette aussez longue traverse cette peau dans le sens du diamètre de la calebasse de manière à avoir un manche comme la guitare moderne.
La corde de l’instrument était constituée de crins de cheval. D’autres accessoires permettaient de mettre l’instrument au point. Ce violon était surtout utilisé pour le folklore familial. Pour s’égayer, les femmes de la maison jouaient et chantaient entre elles. La percussion était donnée par un récipient de fortune : bassine, calebasse, tasse,... Contrairement au reste du Mali, la femme noble de Tombouctou était obligée de maîtriser le violon. Pour garder son mari dans la maison après le dîner, elle parfumait l’étage et jouait pour lui. Elle improvisait un chant qui relatait l’arbre généalogique du maître de logis, elle le remerciait de tout ce qu’il lui apportait sur le plan matériel, spirituel et moral. Elle lui demandait pardon du mal qu’elle pouvait lui faire. C’était une musique aristocratique, savante et cultivée. La femme cessait de jouer dès que son mari s’endormait...
Par la suite, ce folklore de vestibule des femmes aristocratiques et bourgeoises de Tombouctou devint une danse traditionnelle. Elle repose sur deux calebasses renversées sur les coussins ou sur un amas de draps qui servent de percussions.
La violoniste est d’une importance capitale. Elle est l’animatrice principale. La manifestation prend alors le nom de M’Baga et se voit surtout dans les quartiers de la médina (Badjindé, Sankoré, Djingareïber et Sareïkeïna).
Elle exige des femmes un costume spécial. La vedette doit porter un ample boubou brodé, en bazin de préférence, un pagne tissé artistiquement à la tombouctienne. Elle se tresse à la mode de Djenné. Sa coiffure est mise en valeur par un sarani (bande bicolore, noir et blanc) qui ceint sa tête sous la tresse, sur le front. Elle porte une paire de babouches en cuir local, des bijoux en or et en argent. Elle fait partie des femmes qui partagent un certain niveau de vie. Elle doit faire la fierté de son mari, en général moins bien habillé qu’elle.
Avant de sortir, cette maîtresse de maison se parfume d’encens recherché et se rend à la réunion suivie d’une ou deux compagnes, souvent des griotes qui marchent à pas lents devant elle. Sur le chemin, elles font les louanges de la vedette d’un jour qui ne se lasse pas de saluer à chaque porte pour mieux faire admirer sa toilette et ses parures.
De toutes les rues, débouchent des Tombouctiennes dignes, bien nourries, respirant le bonheur et l’abondance. Cette danse folklorique de la haute aristocratie marque les grands événements de la vie sociale : mariage, port du turban, circoncision...
La cérémonie se déroule de la façon suivante : deux danseuses se mettent au centre du tam-tam. Elles se font face et exhibent au public leur riche costume. Elles dansent en remuant les bras, les pieds et la tête en s’appuyant d’un côté puis de l’autre, la tête légèrement baissée. Chaque mimique et chaque geste exprime un langage qui s’adresse surtout à des co-épouses. Elles montrent qu’elles vivent dans l’opulence pendant que leurs rivales sont dans le besoin. A ces adversaires qu’elles considèrent stériles, elles mettent en avant les enfants qui les prendront en charge durant toute leur vie.
La violoniste accorde son instrument en quinte et en octave, enflamme la querelle grâce à ce son particulier et soutient tour à tour les danseuses parentes ou amies, ou les coépouses furieuses. Les deux danseuses se reposent enfin. Ensuite, les coépouses mises en cause entrent à leur tour dans la danse et cherchent à répondre énergiquement aux provocations. Malgré ce duel symbolique, le tam-tam termine toujours la séance en beauté et sans incident.
Ce genre de manifestation est organisée l’après-midi ou le soir. De nos jours, elle tend à disparaître car les jeunes filles de Tombouctou ne s’intéressent plus au violon, elles préfèrent le tacamba ou les danses modernes.
| L’Abarbarba |
C’est la danse traditionnelle des bouchers de Tombouctou qui sont recrutés parmi les Sonraï, les Peul, les Kel Tamachek noirs, les Arma...
Le Maouloud est l’anniversaire de la naissance du prophète Mohamed (S.A.W) et c’est une fête capitale pour Tombouctou. Déjà la veille, partout dans la cité, au marché, dans les maisons, aux champs, dans les ateliers et les chantiers, autour des puits et des mares, les Tombouctiens jouent de tous les objets sonnores à leur portée pour exprimer leur joie en ce jour béni. Les uns entonnent des chants religieux en sonraï pour louer la supériorité de la nuit et du jour anniversaire sur les autres jours et nuits de l’année. Les autres exaltent la prophétie de Mohamed (S.A.S.) et sa supériorité sur les autres prophètes.
Ce jour-là, les bouchers sont plus heureux que les autres. Non seulement ils fêtent comme tout le monde mais ils gagnent beaucoup plus d’argent que d’habitude à cause des innombrables invitations à travers la ville. En ce jour glorieux, ils ont une manière bien spécifique d’exprimer leur joie en tapant avec leurs couteaux sur tous les récipients qu’ils trouvent. Ils jouent, chantent et dansent. Obligatoirement, ils doivent faire danser tous leurs clients réguliers en terme de cousinage. C’est de cette manifestation religieuse et spontanée qu’est née Abarbarba dans les boucheries de Tombouctou.
Les hommes improvisent Abarbarba en l’absence de leurs femmes sur la place du marché. Son organisation compliquée et coûteuse implique une certaine hiérarchisation des tâches : lorsque le chef des bouchers, informé de l’intention de la corporation d’organiser une fête, donne son accord, il distribue cent et une noix de kola aux quatre grandes familles de cette corporation. Par ce don, les dignitaires informent toutes les familles de bouchers, hommes, femmes et enfants. La cérémonie est alors sacrée. Etre absent serait un sacrilège. Avant midi, tous les bouchers abandonnent le marché pour se préparer à porter les costumes traditionnels qui forcent le respect et l’admiration. Vers dix-sept heures, ils se retrouvent ensemble à la place désignée pour cette grandiose manifestation. Leurs femmes à leurs côtés, parfaitement ordonnées, richement habillées et parées de bijoux en or et en argent, excitent la foule en tapant des mains de toutes leurs forces pour soutenir l’orchestre.
Celui-ci est composé d’un grand tambour circulaire assez plat, d’un autre en calebasse sphérique mais ouvert et de trois petits canaris en argile qui servent de tambourin. Une peau de vache soigneusement choisie est tendue et attachée à l’ouverture de chaque instrument pour obtenir la résonnance.
La manifestation s’organise peu à peu. En ce jour solennel, tous les absents seront amendés. Dans un enthousiasme délirant, l’orchestre entame l’Abarbarba. La cantatrice, généralement une femme de boucher, accompagne la musique. Les autres femmes tapent des mains en suivant le rythme à quatre temps dans un ensemble parfait. Un homme se lance au milieu de la danse, un turban à la main. Il danse en s’appuyant fortement sur un seul pied au sol. En même temps, il manie le turban entre ses mains. Il s’avance vers l’orchestre qui redouble d’intensité. Une femme qui n’arrive plus à se retenir prend une grande écharpe et se jette auprès de lui. La concurrence commence entre le "cavalier" et sa "cavalière". Les femmes ajoutent une note tonique à l’ambiance avec leurs youyous stridents.
Echappant à tout contrôle, hommes et femmes se lancent à leur tour dans la danse. Chacun d’eux s’applique à des démonstrations exceptionnelles pour paraître le meilleur danseur. L’Abarbarba atteint son paroxysme lorsque les bouchers costumés arrivent, suivis par une foule d’enfants. A leur passage, on leur cède partout la place. Leurs costumes assez bizarres sont formés de cornes de bœufs, de peaux, de vessies pleines d’air, de vieux sacs, de vieilles nattes, d’intestins d’animaux...
Ces accoutrements appartiennent depuis des générations à certaines familles de bouchers. Ils ont pour but de protéger tous les bouchers de Tombouctou contre les mauvaises langues. Certains bouchers représentent les vendeurs de viande de bœuf, d’autres de mouton ou de chèvre. Ils sont les plus grands danseurs. Avec des gestes précis et calculés à l’attention de la foule, ils font mine de jeter le mauvais sort sur le sorcier présent à cette cérémonie. Par leurs mimiques, ils montrent au public que même si le boucher est pourri, sa viande est grasse. Ils dansent tous sans arrêt. Toute l’attention est concentrée sur eux et c’est le moment le plus fort. Certaines femmes, emportées par leur enthousiasme, battent des mains comme des possédées et se mêlent aux danseurs dans le désordre.
Le crépuscule arrive. Ces maîtres de l’art de la danse, suivis par les curieux, abandonnent la place qui se vide. Le muezzin de Djingareyber, leur quartier, lance dans l’air l’appel à la prière.
| Les Kel tamacheq noirs de Tombouctou et le diaba |
Les Kel tamacheq noirs, d’après la tradition orale de leur quartier, sont les premiers habitants de cette localité. Les vieux relatent l’histoire avec un orgueil tout particulier.
D’après le patriarche du quartier, Khamaye Ag Mohamed Al Mubareck, un marabout presque centenaire, les premiers habitants de Tombouctou étaient de race noire. La première personne à habiter la cité avant les Imogcharen était Bouctou qui s’appelait en réalité Gaïchoutou Ein Atouboutoute, c’est-à-dire la femme au gros nombril en tamacheq. Elle était sonraï, originaire de Khaïragho, localité se trouvant à l’est de la ville de Rarhous.
Un jour, alors qu’elle était au pâturage avec les brebis de sa famille, une grosse épine de taboragh (dattier sauvage) la piqua. Elle s’assit pour l’enlever. Son troupeau poursuivit son chemin en broutant. Elle ne parvint pas avant le crépuscule à enlever l’épine. Ses bribis étaient déjà bien loin. Elle partit à leur recherche et après deux jours de marche, elle se retrouva au bord d’une mare. Là, elle retrouva facilement une partie de son troupeau.
Selon notre patriarche, cette mare était à l’emplacement de Tacaboundou, petite place à une cinquantaine de mètres de la célèbre mosquée Sankoré. Située en pleine forêt et carrefour des eaux de pluies, l’endroit était vraiment luxuriant.
Désorientée, Bouctou décida de s’installer aux environs de la mare, probablement à Tombouctou Koï Batouma. Ses animaux trouvaient à brouter en abondance. Dans cet endroit clément, elle vivait de fruits sauvages et du lait de ses animaux.
Bouctou était l’unique fille des sept enfants de son père. Sa famille, n’ayant aucune nouvelle depuis plusieurs mois, envoya son grand frère Boutaghla à sa recherche. En cours de route, il ramassa un gros fruit qu’il n’avait jamais vu auparavant. Il le brisa, le goûta et le trouva tellement délicieux qu’il en emporta un morceau avec lui. C’était de la pastèque. Après mille et une difficultés, Boutaghla parvint au bord de Tacaboundou. Il chercha et retrouva sa sœur Bouctou. Ils pleurèrent de joie. Boutaghla offrit le reste de la pastèque à sa petite sœur. Elle le mangea et jeta les grains par terre.
Boutahgla tenta de ramener sa sœur en famille à l’est de Rahous. Mais celle-ci avait déjà pris goût aux charmes de cette campagne et refusa de le suivre. Elle trouvait l’endroit idéal pour l’élevage à cause de l’eau et de l’herbe abondante. Le grand frère retourna seul chez ses parents. Après quelques mois, il se maria et revint près de sa sœur avec son épouse. Il constata que les graines avaient poussé et donnaient de très bonnes pastèques. De leur côté, les animaux se multipliaient au fil des années. Lait, beurre, viande et fromage inondaient Tacaboundou. Devant ce paradis terrestre, Boutaghla revint à Khaïragho, usa de diplomatie et ramena avec lui ses cinq frères orphelins. Ils surent savamment cultiver et utiliser les produits de la pastèque. Avec ses grains, ils parvinrent à préparer un bon repas: ikanayané, une sorte de tô. Les six frères et les deux femmes installèrent un campement et construisirent aussi des paillotes.
Les visiteurs logeaient chez Bouctou, fondatrice de la cité. Parmi ceux-là, les Imogcharen (Touareg) étaient les plus nombreux. Ils faisaient paître leurs troupeaux pendant un bon moment. Ils étaient tellement nombreux que Bouctou et les siens abandonnèrent leur langue d’origine, le sonraï, au profit du tamacheq.
La cité prenait de plus en plus d’importance. Les riches commerçants y érigèrent des maisons en banco. Mais Bouctou, ses frères nobles et leurs descendants ne voulurent jamais abandonner leurs paillotes. Certains esclaves, surtout ceux capturés par Sonni Ali Ber, venaient aussi vivre dans le même quartier en paillote. Au fur et à mesure que les constructions en banco avançaient, les paillotes reculaient.
Du milieu de la ville, les nobles descendants de Bouctou sont à Bellé Frandi, dans un très gros quartier à l’est de Tombouctou. Cet endroit porte aujourd’hui le nom significatif d’Amazagh (lieu où vivent les frères).
A partir de 1947, à cause d’une trop grande fréquence d’incendies, l’administration coloniale lotit Abaradjou et Bellé Farandi en exigeant des constructions en banco. La plupart de ceux qui vivent aujourd’hui à Bellé Farandi ont comme ancêtre le grand-père de Bouctou Boutaghla Ag Wanghanghane Ag Boutaghla Ag Karidar Ag Bikiya. Restés libres, ils cultivent encore les pastèques dans le lit de l’ancien canal de Tombouctou ou sur les dunes de sable.
D’après la tradition orale, les premiers habitants de la cité des 333 saints, les Kel Tamacheq noirs ont su, à travers les âges, créer d’admirables danses folkloriques très riches et très variées (le diaba, le challo, etc.) tirées de leur vaste patrimoine culturel.
| Le diaba |
Le diaba est une danse traditionnelle des Kel tamacheq noirs de Tombouctou.
L’orchestration est composée d’une grande bassine remplie aux trois quarts d’eau sur laquelle on renverse une calebasse. On tape celle-ci à l’aide d’une ou deux baguettes terminées chacune par un chiffon attaché en boule.
Une cantatrice de talent entonne un chant mélodieux que les femmes reprennent en chœur. Cette mélodie, cadencée par les percussions, est essentiellement accordée à la gamme pentonique qui donne à l’ensemble de la musique, puissance, clarté et harmonie.
Cette danse folklorique est organisée à la fin des grandes récoltes ou à l’occasion des grandes cérémonies de la vie sociale. Elle se déroule l’après-midi, principalement dans le quartier des Kel tamacheq noirs.
Le tam-tam s’anime. D’un côté, la cantatrice s’adresse aux célibataires, les invitant à ne pas avoir peur des femmes dignes présentes devant eux. De l’autre, elle excite les femmes non mariées à profiter de l’occasion pour se "tailler un mari". Alors un cavalier, richement habillé et portant un grand turban targui, se dandine vers le milieu du spectacle et balance amplement les bras en l’air.
Il se dirige vers un joli tapis étalé pour la circonstance. Chacun de ses gestes est un langage. Le cavalier invite sa bien-aimée qui, sans hésiter, se lance pour danser avec lui. La cantatrice vante la démarche élégante de cette belle femme, son cou de girafe, ses dents d’une blancheur lumineuse, ses parures scintillantes et sa tenue colorée.
Le cavalier, enivré, l’invite des bras, des épaules et de la tête à s’asseoir sur le tapis. La danseuse refuse énergiquement et néglige le cavalier en lui tournant le dos.
La musique monte en volume. La cantatrice et le batteur, chacun à sa manière, interviennent en faveur du cavalier. Le chant et le tam-tam supplient la cavalière d’accepter cette invitation sur le tapis. L’homme, complètement éperdu, multiplie ses démonstrations par des trémoussements qui mettent tout son corps en mouvement. La cavalière le regarde d’un œil morne. A un moment, elle se retournne et les deux dansent face à face.
Alors, l’homme fixe la femme dans les yeux et pousse un cri de joie. A pas lents, la femme enfin conquise, s’avance vers le tapis. Elle s’y arrête et danse sur place. Sa tête, son buste, ses bras et ses jambes entrent tour à tour en jeu. Elle devient le centre des regards. L’homme s’asseoit le premier et la femme, charmée, le rejoint à son tour sur le tapis. La danse redouble d’ardeur. L’assistance est emportée par la grâce et la virtuosité des danseurs.
Les youyous des femmes fusent. Selon un code précis, la danseuse communique avec l’homme. Les deux bras étendus devant, elle tourne les paumes des mains vers le ciel. Elle approuve ainsi la sincérité de l’amour de l’homme. L’homme imite son geste mais tourne les paumes des mains vers le sol. De cette façon, il promet que, s’ils fondent ensemble un foyer, il la rendra heureuse. Il mettra à sa disposition toutes les récoltes de ses champs. La cavalière pose la main droite sur sa poitrine et affirme qu’elle sera l’épouse idéale pour son foyer.
D’un geste auguste, l’homme lève les deux bras et les balance trois fois de suite en l’air en faisant tomber sa poitrine vers l’avant. De cette façon, il lui signifie qu’il lui offrira tout ce qu’elle veut et qu’elle brillera devant ses amies.
La danseuse pose la main gauche sur son sein droit. Elle rassure ainsi son cavalier qui l’admire, de plus en plus éperdu, lui promettant une belle descendance. D’un geste brusque et sec des épaules, l’homme montre sa soumission et sa profonde reconnaissance.
La danse s’accélère... Emportés par l’euphorie génerale, les spectateurs suivent l’action avec un vif intérêt. Les femmes richement habillées, autour de l’orchestre, battent des mains à perdre la tête. Au même moment, la cantatrice et la batteuse de tam-tam arrêtent brusquement le morceau. La bien-aimée fait alors un ample mouvement des bras symbolisant un coup d’épée, et fait semblant de couper la tête à son partenaire; ce qui confirme sa victoire dans cette épreuve.
Souvent, un autre couple entre sans transition. La danse du Diaba est très appréciée à Tombouctou et s’achève au crépuscule, au premier appel du muezzin de la mosquée du quartier.
| Le Hâla |
C’est une danse organisée par les Ag Welène, cultivateurs du quartier Sareïkeïna.
Un grand tambour circulaire, un moyen et trois tambourins forment l’orchestre qui accompagne une cantatrice soutenue par des battements de mains. Les autres reprennent la mélodie en chœur.
Elle demande au Tout-Puissant, par l’intermédiaire du "Saint Boukouri Attahir", la protection de tous les paysans du quartier, partis aux champs depuis l’aurore. Ensuite, elle fait les louanges des cultivateurs qui se sont distingués au travail par leur courage et leur abnégation. Hommes et femmes dansent ensemble en suivant le rythme à deux temps.
Les danseurs s’arment de bâtons et les danseuses prennent un voile à deux mains. Tout le monde commence à bouger. Tout-à-coup, les cultivateurs annoncent leur arrivée par des chants tonitruants. Houes en main, ils font mine de piocher et s’avancent de loin en soulevant une épaisse poussière. A leur arrivée, on leur cède le passage. Ils entrent au milieu de l’orchestre. Les cultivateurs continuent à piocher la terre nourricière et entonnent un chant qui fait vibrer toute l’assistance enthousiaste.
Alors, le chef des paysans lève sa houe vers le ciel et danse, les autres danseurs l’imitent. Puis, des femmes se jettent au milieu des danseurs. Il arrive que l’une d’entre elles tombe en transe. La danse s’achève à la fin du jour.
| L’architecture traditionnelle |
Même s’il existe aujourd’hui au Mali une architecture de style soudanais, celle de Tombouctou était surtout inspirée par la construction de la mosquée de Djingareïber.
Selon la tradition orale, l’empereur Kankou Moussa, pour bâtir cet édifice religieux et le Mandougou (palais), fit venir des maçons égyptiens très qualifiés et des menuisiers expérimentés du Yémen.
Ces artistes talentueux émerveillèrent les riches commerçants et les fins lettrés de la ville qui leur demandèrent de rester pour leur construire des habitations dans le même style. Les maçons résidèrent dans le nouveau quartier de Djingareïber et les menuisiers dans l’ancien quartier Sareïkeïna. Ils occupaient le secteur de Djamaï Kounda.
La mosquée qui enchanta la ville (1325-1326) s’inspirait des pyramides pharaoniques. Ainsi, les murs de ce grand monument ont des bases très larges qui diminuent vers le sommet. On peut le constater en regardant les neuf rangées de l’oratoire dont les murs très hauts sont parallèles au côté est de la mosquée. Ces maçons et menuisiers firent fortune en participant à partir du XIVe siècle à l’agrandissement de la cité. Ils s’y enracinèrent. Leurs descendants sont aujourd’hui parmi les grands notables de Tombouctou. Ils sont craints et très respectés pour leur art dans le style de la construction et de la fabrication des portes traditionnelles.
Encore aujourd’hui, une maison tombouctienne type, malgré l’évolution à travers le temps, comprend dès l’entrée, un vestibule qui est consolidé par un grand pilier central qui empêche les passants indiscrets de voir ce qui se passe à l’intérieur. Là, les femmes cousent et travaillent et les enfants jouent. L’étranger qui cherche un asile peut y loger gracieusement le jour et même la nuit. C’est de ce vestibule que part l’escalier qui monte à l’étage. Il peut être double si l’aire de construction et les moyens du propriétaire le permettent.
Après le vestibule, il y a une sorte de salon soutenu par quatre piliers qui encadrent une ouverture assez large à ciel ouvert. On a l’impression d’être dans une cour couverte. C’est le lieu de travail de la maîtresse de maison d’où elle dirige la cuisine et peut vendre certains produits (condiments, céréales,...). Discrètement, elle est très entreprenante, surtout dans le quartier de Badjindé. Elle y reçoit ses amies et les visiteurs.
Dans cette partie de la maison, trois chambres s’ouvrent dont l’une est réservée à la femme. Elle y garde ses habits et ses bijoux. L’autre concerne son mari. Personne n’a le droit d’y pénétrer car l’homme, dit-on, a toujours des secrets à cacher à sa femme. La troisième chambre est strictement reservée aux filles. Aucun homme n’a le droit d’y pénétrer, même parfois leurs frères. Cette chambre est régulièrement contrôlée par la maîtresse de maison et, de temps en temps, par le chef de famille.
Le magasin se trouve souvent dans cette partie de la maison. Au fond, c’est la cour. Dans les familles aristocratiques, il y a un escalier par lequel les membres de la famille montent à l’étage. La cuisine, les toilettes et un endroit pour un petit élevage de volaille sont dans la cour.
La cour à ciel ouvert a une importance capitale. La servante, les filles et la maîtresse de maison y sont très actives pour tous les travaux domestiques.
L’étage est généralement construit au dessus du vestibule sur des murs très épais à la base. C’est ici le salon du maître dont les fenêtres très larges donnent directement sur la rue. Le salon décoré est d’un grand luxe pour tout Tombouctien qui a les moyens.
Des jolis tapis sont accrochés aux murs et des coussins de fabrication locale sont posés ici et là. Le sol est aussi couvert de tapis importés aux couleurs vives et au style oriental. Le lit de bois local, les objets décoratifs sont bien à leur place. Deux chambres s’ouvrent dans le salon, l’une pour l’époux et l’autre pour l’épouse.
Cette dernière a pour rôle principal de maintenir le salon dans un ordre et une propreté impeccables, sans oublier de l’embaumer d’encens chaque fois que celà est nécessaire. Le maître de la maison y reçoit ses visiteurs et les amis qui viennent pour causer en famille. Du vestibule, ils montent directement à l’étage sans voir les autres membres de la famille (femmes et grandes filles) ni l’intérieur de la maison. Dans certaines familles, un autre escalier dans la cour permet aux propriétaires de monter à l’étage sans être vus des autres.
Le reste de la maison est couvert pour qu’il y ait une grande cour à l’étage. C’est l’endroit idéal où l’homme et la femme causent et dorment pendant les grandes chaleurs.
Sans entrer dans le détail des différents matériaux de construction qui sont un peu partout les mêmes, il faut préciser tout de même que Tombouctou possède une roche spéciale l’alhor qu’on trouve à une dizaine de kilomètres de la ville. C’est une pierre blanche à laquelle on donne une forme presque carrée avec du ciment et dont on fait le revêtement des murs des maisons. Cette construction semi-dure est presque définitive. L’architecture de Tombouctou est bien particulière.
| Djam tanda (l’atelier du forgeron) |
De nos jours, cet atalier est composé d’une véranda en banco soutenue par deux piliers en alhor. Elle donne accès à une grande salle éclairée par un trou au plafond. Le travail artisanal se fait activement dans cet atelier et devant, dans la ruelle.
Pour le Tombouctien moyen, la famille qui travaille à cet endroit s’occupe du fer (Djam) même si son activité principale porte sur le bois.
La famille de Djamaï Kounda est une des plus anciennes de Tombouctou. Elle serait venue d’Orient, plus exactement du Yémen. Encore aujourd’hui, les griots qui font leurs louanges font ressortir cette origine yéménite.
En effet, les membres de cette famille de Djamaï Kounda étaient venus à Tombouctou en 1325, sous l’empereur El Hadj Kankou Moussa. Comme artisans, ils avaient accompagné l’architecte et poète andalou Abou Ishaq Es Saheli Al Fouedjin auquel l’empereur offrit 40 000 pithcals d’or pour la construction de la mosquée de Djingareïber.
Dans son livre Tombouctou et l’Empire Songhoï, le professeur Sékéné Mody Cissoko parle de cette famille sous Sonni Ali Ber qui régnait depuis le XVe siècle (p. 131).
La tradition orale explique qu’en 1594, les jurisconsultes de Tombouctou, déportés au Maroc étaient passés devant Djam Tanda.
Cette famille d’artisans était chargée de confectionner les portes et les fenêtres de la mosquée. Le travail fut exécuté avec une maîtrise de l’art qui fut admirée par tous. Les riches Tombouctiens les retinrent alors sur place pour leurs propres constructions. Très vite, la physionomie de la ville changea vers un nouveau style de construction avec de nouveaux battants et de nouvelles fenêtres.
Les matériaux utilisés dans la menuiserie traditionnelle sont variés. Depuis le XIVe siècle, le travail de Djam tanda consiste à fabriquer des battants et des fenêtres traditionnels connus sous le nom local d’algaloum gambou. C’est un bois provenant du tronc du diospyros africana, un arbre de la région. En grattant son écorce, on voit apparaître une couche brune et rouge très solide qui résiste aux termites et aux rongeurs.
Le bois est utilisé par planches auxquelles on donne la forme rectangulaire d’une porte. Ici, le travail de la forge consiste à confectionner des clous à tête aplatie qui servent à maintenir à l’arrière les différentes planches par un bois transversal. On fabrique également des plaques métalliques à l’intérieur desquelles on découpe avec précision des arabesques très décoratives. Le tout est affiché sur le battant par l’intermédiaire d’un tissu rouge vif. On passe ensuite une couche d’étain liquéfié sur les différents métaux. L’ensemble donne un joli battant rouge vif avec des plaques qui brillent comme de l’argent. Sur l’œuvre achevée, la décoration la mieux mise en relief est une grosse plaque ronde en métal munie d’un anneau circulaire : la porte fermée, le chef de famille tape dessus pour annoncer son arrivée. C’est le seul qui a le droit de s’en servir.
Tous les battants traditionnels de Tombouctou bien ouvragés sont fabriqués de père en fils par cette famille. Tout autochtone qui en a la possibilité en fait la commande en donnant une avance au chef menuisier.
Une foule de maîtres et d’apprentis se met aussitôt à l’œuvre pour respecter le délai fixé qui peut durer un an...
Dans toutes les belles constructions et les mosquées célèbres, on utilise l’ algaloum gambou, symbole de l’art architectural et décoratif de la cité. Au cours de veillées, les jeunes filles chantent la valeur artistique de ces portes. Les Tombouctiens de la diaspora qui en ont la possibilité les commandent pour marquer avec force l’appartenance de leur famille à une brillante civilisation.
Cette famille d’artisans est très respectée à Tombouctou. On lui attribue certains pouvoirs ésotériques et elle est consultée au sujet de plusieurs cérémonies de la vie sociale.
| La broderie à la main |
Les ateliers de broderie ont toujours une importance capitale dans la vie artisanale de Tombouctou. Autrefois, l'école était même intemement liée à la vie. Ces deux institutions, l’atelier et l’école, formaient un tout indissoluble.
Les célèbres pédagogues tombouctiens contemporains de Montaigne disaient : "L’esprit, siège de l’intelligence, est apte à assimiler en l’absence du soleil et la main la plus adroite en compagnie de cet astre du jour." Ainsi, les écoles islamiques commençaient très tôt et continuaient la nuit pour libérer l’enfant le reste de la journée à l’apprentissage d’un métier.
C’est ainsi que plusieurs enfants, surtout ceux des familles maraboutiques, apprenaient la broderie à la main. L’atelier tindéhou est généralement dans le vestibule ou dans un autre local donnant sur la rue. Le maître brodeur malé était entouré d’apprentis. Avant de s’asseoir, il invoque le Tout-Puissant en récitant quelques versets du Coran : la place est alors sacrée et tout son travail est confié à Dieu. Il maîtrise la technique de la coupe et de la broderie. Pour ce faire, le matériel est très simple; une paire de ciseaux, du fil, de la soie provenant de Fez, un dé, une aiguille...
Il découpe le tissu suivant la tenue qu’il veut obtenir. A l’aide d’un crayon, il trace les figures géométriques très adroitement, souvent sans règle ni compas, puis il coud et les jolis motifs prennent forme. C’est un artiste en harmonie avec son œuvre. Les modèles sont très nombreux, fruit du brassage culturel de Tombouctou. Pour désigner les variétés de coutures, les mots peuvent être d’origine arabe, haoussa, peul, wolof...
Les différentes variétés de broderie à la main:
* La variété initiale la plus simple est Djindé hinsa.
* Le picole, expression certainement wolof est la variété initiale citée ci-dessus améliorée.
* Djiba me est le motif de la poche.
* Wakia fo n’da djéré djaro se coud avec une mesure et demie de soie.
* Djiba mé n’da haoussa nossi comporte un motif haoussa inspiré des Nigériens.
* Wakia fon’da djiré sogno est plus fine que les autres.
* Wakia taine comporte des broderies sur les deux faces, l’expression est arabe.
* Araàa Wakou comporte plusieurs broderies, l’expression est aussi d’origine arabe.
Ce métier est non seulement très fatiguant, mais aussi très méticuleux. Pour broder certains boubous, il faut parfois attendre un an tant le travail est compliqué. Il faut y appliquer la technique mais aussi l’intelligence.
Pour son apprentissage, l’enfant passait par plusieurs grades, comme d’une classe à l’autre. Son maître lui tendait une aiguille, du fil et un dé et chaque fois qu’on le rencontrait au marché seul, n’importe qui avait le droit de le corriger sans le connaître ni lui expliquer pourquoi. Il devait être à ce moment précis à l’école coranique ou à l’atelier.
Dans ces deux institutions fondamentalement tombouctiennes, on apprend à l’enfant le métier, l’art de vivre et de se conduire suivant la philosophie tombouctienne. C’est-à-dire se sacrifier avant tout pour l’honneur et la grandeur de le cité, ce qui ne peut se faire sans une éducation souvent rigoureuse. L’enfant n’a plus le temps de se livrer à la délinquance.
Cette éducation suivie par tous les membres de la société favorise Tombouctou en lui donnant des artistes de grande renommée : maçons, scribes, bijoutiers, cordonniers, chanteurs... sont souvent appréciés à l’extérieur.
Mais la société tombouctienne rejette tout art qui représente les créatures animées comme les hommes et les animaux. Les statuettes qui proviennent du sud sont désapprouvées par la population. C’est dire à quel point l’idée est fortement ancrée dans l’esprit du Tombouctien que toute personne qui représente un être vivant sous forme de statuette ou de peinture, lui insuflera une âme le jour du jugement dernier. Cette société refuse même les dessins dans les mosquées ou dans les maisons. Toutes ces décorations rencontrées dans les manuscrits et les tapis sont de forme géométrique.
La musique et le folklore sont le quotidien de la société à Tombouctou. Il y a plus de quatre cents ans, Jean-Léon l’Africain constatait que les manifestations continuaient tard dans la nuit. Le professeur Sékéné Mody Cissoko ajoute dans son livre Tombouctou et l’empire songhoï : "Les scènes de mariage avec tambours battants, les chants coraniques dans les quartiers constituaient les agréments quotidiens de la ville" (p. 171).
Encore de nos jours, les Tombouctiens ont une passion démesurée pour le chant et le floklore. Quel que soit son âge, un maçon ne se gêne pas pour danser le dimba, un boucher l’abarbarba, un cultivateur de Sareïkeïna le hala et un marabout pour chanter à haute voix en public les panégyriques du prophète Mohamed (S.A.S.). Les notables de Tombouctou organisent chaque année au quartier Sankoré un concours de chant qui porte le nom de bobbohoumé thiaou. Sur le lieu de travail, tout Tombouctien chante souvent un chant religieux pour se donner du courage ou pour éloigner Satan.
Il faut noter que pendant son évolution, la société tombouctienne n’a pas connu de griots. Ceux qui y vivent aujourd’hui sont venus d’ailleurs. Peut chanter qui veut, mais pas n’importe où.
Quant aux artisans, ils sont de tous les milieux, même si la forge et la bijouterie paraissent endogamiques.
Tout Tombouctien, quelle que soit son origine, doit travailler de ses deux mains car la fortune et l’instruction peuvent s’envoler. Le métier, lui, suit toujours l’homme. Il n’y a aucun sot métier à Tombouctou. Aussi, des familles très illustres comme les Arma peuvent être cordonniers. La cité, dans tous ces arts, a connu de grands artistes.
Consciente de son art raffiné et de sa brillante civilisation, la ville de Tombouctou, repliée depuis longtemps sur elle-même, a pu jusqu’ici protéger ses valeurs culturelles grâce à son isolement en plein Sahara.
Aujourd’hui, elle doit faire face à une agression étrangère. Elle s’ouvre de plus en plus au monde moderne, nécessité oblige. Elle y échappe difficilement avec déjà la télévision et les autres moyens de communication qui vont rapidement la lier au reste du monde. Tombouctou saura-t-elle conserver son authenticité?
Il faut l’espérer.
Bibliographie
Civilisations et art de l’Ouest africain. B. Holas Union générale des Editions. Paris 1976
Figure de l’art contemporain. Marc Le Bot Presses Universitaires de France.
Festival Mondial des Arts Nègres. Vol. Il Dakar. 1- 24/4/1976
Histoire générale de l’Afrique du XIIe au XVIe siècle. UNESCO/NEA
Tarick es Soudan. Es Sa’di. 1964
Tarick et Fettach. Mahmoud Kati. 1964
Comité de jumelage Saintes-Tombouctou.
Culture et civilisation islamiques. Le Mali 1988
Tombouctou et l’empire songhay. Mody Sékéné Cissoko. 1975
Description de l’Afrique. Jean-Léon l’Africain. T. II 1956.
Back to [the top of the page] [the contents of this issue of MOTS PLURIELS]