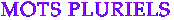
no 12. Décembre1999.
https://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP1299rg.html
© René Gnalega
René Gnalega
Université de Cocody, Abidjan
Nous avions initialement choisi comme sujet "Poésie et expressions artistiques chez L. S. Senghor", mais nous nous sommes rendu compte que le sujet était vaste. Aussi avons-nous décidé de nous focaliser sur "Les relations entre la poésie de Senghor et la Sculpture", un thème apparemment mineur mais qui, à l'analyse, est capital car la sculpture permet de mieux cerner la poésie. Elle est inhérente à une pratique de la société africaine et est en même temps liée au sacré, au religieux. N'est-elle pas perçue comme un pont entre les vivants et les ancêtres disparus ? N'établit-elle pas aussi un lien avec les forces obscures et les divinités de toutes sortes ?
Par ailleurs, la sculpture intègre en elle-même certains arts comme la peinture et même la danse. Notre démarche consistera à lire rigoureusement l'oeuvre de l'Académicien sénégalais pour mettre en évidence les relations entre la poésie de ce dernier et la sculpture.
La place des arts est prépondérante chez Senghor. Lors du premier festival des Arts nègres à Dakar, il déclarait ceci :
-
N'ayant donc pu nier l'Art nègre, on a voulu en minimiser
l'originalité sous le prétexte qu'il n'avait le monopole ni de
l'émotion, ni de l'image analogique pas même du rythme. Et il est
vrai que tout artiste véritable est pourvu de ces dons, quels que soient
son continent, sa race, sa nation. Il n'empêche, il a fallu que Rimbaud
se réclamât de la Négritude, que Picasso fût
ébranlé par un masque baoulé, qu'Apollinaire chantât
les fétiches de bois pour que l'art de l'Occident européen
consentît, après quelques deux mille cinq cents ans, à l'abandon
de la physéôs mimesis: de l'imitation de la nature[1]
Chaka :
-
Mais je ne suis pas le poème, mais je ne suis pas le tam-tam. Je ne
suis pas le rythme. Il me tient immobile, il sculpte tout mon corps comme une
statue du Baoulé.
Non je ne suis pas le poème qui jaillit de la matrice sonore. Non je ne fais pas le poème, je suis celui - qui - accompagne. Je ne suis pas la mère, mais le père qui le tient dans ses bras et le caresse et tendrement lui parle[2]
Et plus loin Chaka dit encore :
-
Et moi je suis celui - qui - accompagne, je suis le genou au flanc du
tam-tam, je suis la baguette sculptée.
La pirogue qui fend le fleuve, la main qui sème dans le ciel, le pied dans le ventre de la terre.
Le pilon qui épouse la courbe mélodieuse. Je suis la baguette qui bat laboure le tam-tam[3]
Le poème est comparé à un sculpteur et le poète est "la baguette sculptée". Le fait que la sculpture soit l'une des images majeures pour rendre compte de l'essence poétique n'est pas gratuit chez Senghor. La sculpture est une image-symbole du poème.
Il convient par conséquent d'étudier quelques aspects importants de la sculpture à l'intérieur même de l'oeuvre poétique. A l'analyse, nous constatons que le poète veut graver le mot comme sur une pierre dans le poème. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre ce que dit le poète dans "Femme noire".
-
[...]
Femme nue, femme noire
Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel
Avant que le Destin jaloux ne te réduise en cendre, pour nourrir les racines de la vie. (p. 17)
Pour aborder avec attention les rapports entre la poésie de Senghor et la sculpture nous nous intéresserons à la figure de l'hypotypose et à la problématique du mouvement et de l'immobilité.
| I - L'HYPOTYPOSE |
Cette figure de rhétorique désigne une description "si vive et si bien observée qu'elle s'offre aux yeux avec la présence, le relief et les couleurs de la réalité. "[4]
En fait, l'hypotypose intègre dans son fonctionnement deux phases. La première consiste à rendre sensible au regard une description. La seconde, qui est du reste inhérente à la première, valorise les couleurs. Aussi l'hypotypose cultive-t-elle les chocs visuels et plus précisément le pittoresque. Celui-ci fait découvrir des représentations aux couleurs vives et piquantes.
Dans l'oeuvre de Senghor l'hypotypose se remarque lorsque le poète décrit le visage qui est matière. Et il est vrai que Senghor n'est pas insensible à la rugosité de la pierre et de toutes les formes dures, solides et brutes.
-
In Memoriam
J'ai peur de la foule de mes semblables au visage de pierre
(p. 90)
C'est cette thématique de la pierre qui conduit le poète à donner le prénom de Pierre à Eboué.
-
Au gouverneur Ebou
Ebou-é ! Et tu es la pierre sur quoi se bâtit le temple et l'espoir
Et ton nom signifie "La pierre" et tu n'es plus Félix ; je dis Pierre Eboué. (p.73)
Senghor aime bien le travail patient, long, pénible mais exaltant de tous ceux qui métamorphosent la matière dans sa forme première. On ne peut pas ne pas penser ici à l'esthétique parnassienne qui au-delà de l'art pour l'art entretient des relations de proximité avec les arts plastiques et au dialogue Eupalinos de Paul Valery.
Théophile Gauthier dit dans L'Art:
Oui, l'oeuvre sort plus belle
D'une forme au travail
rebelle
Vers, marbre, onyx, émail
Conscient de l'importance des arts plastiques, le poète considère que le visage le plus beau est celui du masque ou de la statue.
-
Chants pour Signare
Tes cils ont pris la position de l'Eternel sur le visage des statues
Mais il flotte autour de ton masque l'aile claire de la mouette
Et c'est ce sourire obsédant, comme le leitmotiv de ton visage mélodie
Diamant patiemment sculpté par une haute raison
Ton sourire me pose l'Enigme, plus subtil que ceux qu'échangeait les Princes confédérés.(p. 179)
Cette beauté inscrite au coeur même du visage fait de lui un objet de contemplation, de célébration. L'hypotypose met ici en relief tous les fastes de la beauté du visage.
-
Que m'accompagnent koras et balafonds
[...]
visage classique ! depuis le front bombé sous la forêt de senteurs et
les yeux larges obliques jusqu'à la baie gracieuse du menton
L'élan fougueux des collines jumelles ! O courbes de douceur visage mélodique !(p. 37)
Le thème du visage est majeur. N'est-il pas l'expression de la vérité elle-même ? Le visage a même une dimension baptismale. Dans "Lettre à un poète" adressée à Aimé Césaire, Senghor dit :
-
Au fond du puits de ma mémoire, je touche
Ton visage où puise l'eau qui rafraîchit mon long regret (p. 12)
Nous savons bien que le poète a fait de la quête identitaire une réalité constante. Et le visage est encore l'un des passages obligés d'accès à l'identité véritable. C'est pour cette raison que l'autre versant du visage est le masque. Celui-ci voile certes le visage au sens propre et au figuré. Mais il est aussi le masque du sculpteur et renvoie à la réalité même de l'Afrique avec toutes ses croyances. On ne s'étonnera pas que le poète adresse une prière aux masques.
-
Prière aux Masques
Masques aux visages sans masques, dépouillés de toute fossette
comme de toute ride
qui avez composé ce portrait, ce visage mien penché sur l'autel de
papier (p. 23)
Le masque africain est dépourvu d'hypocrisie et de laideur. Il est comme Dieu lui-même puisqu'il est à l'origine du visage humain et notamment de celui du poète. Le vrai visage est masque.
-
Masque nègre
Visage de masque fermé à l'éphémère, sans yeux sans matière
Tête de bronze parfaite et sa patine de temps
que ne souillent fards ni rougeur ni rides, ni traces de larmes ni de baisers
O visage tel que Dieu t'a créé avant la mémoire même des âges (p. 18)
On l'aura déjà remarqué, le masque est de l'ordre de l'impérissable, de l'indestructible. Le temps n'a pas prise sur lui à l'opposé du visage humain voué à la putréfaction.
En outre, les formes sculptées à l'instar du "tam-tam sculpté" exercent une fascination sur le poète au point que bien souvent l'écriture elle-même emprunte les chemins de la sculpture. Senghor cultive le goût du détail dans la description. Celle-ci relève du pointillisme propre au bon sculpteur.
-
Masque nègre
Elle dort et repose sur la candeur du sable.
Koumba Tam dot. Une palme verte voile la fièvre des cheveux, cuivre
le front courbe
Les paupières closes, coupe double et sources scellées.
Ce fin croissant, cette lèvre plus noire et lourde à peine (p. 17)
Le corps en son ensemble est une oeuvre d'art, surtout lorsqu'il danse.
-
Elégie pour la Reine de Saba
Que tu es beau lorsque tu danses ! Tu virevoltes comme le papillon (p. 325)
L'hypotypose est aussi visible à travers les notations de couleurs particulièrement saisissantes, autrement dit à travers le pittoresque.
-
Prière aux Masques
Masques ! O Masques !
Masque noir, Masque rouge, vous masques blanc et noir
Masques aux quatre points d'où souffle l'Esprit
Je vous salue dans le silence ! (p. 23)
Le pittoresque se manifeste notamment à travers la figure de l'oxymoron "Masques blanc et noir". En effet, le poète aura tendance à opposer le blanc et le noir comme dans cet autre exemple.
-
Chants de Printemps
Ecoute le bruissement blanc et noir des cigognes à l'extrême de leurs voiles déployées (p. 85)
C'est dans ce contexte d'opposition des contraires qu'il convient de placer les différentes juxtapositions du jour et de la nuit: "et les nuits - jours"
La lumière incandescente et les ténèbres opaques ont le même voisinage à l'intérieur d'une même construction syntaxique.
-
Elégies de Minuit
Seigneur de la lumière et des ténèbres ! (p. 119)
Pour le poète la nuit revêt les attributs de la clarté. Elle se mue en lumière. Elle est non seulement dans un rapport de proximité avec le jour, mais elle a des vertus plus positives que celui-ci. La nuit de Senghor n'est pas ténèbres.
-
Epîtres à la Princesse
C'était une nuit transparente (p. 142)
Indépendamment de ce qui précède, nous constatons que le poète montre constamment les couleurs sous leur aspect chatoyant. Comme un véritable peintre, le poète nous dévoile au sens propre le monde dans sa diversité pittoresque. Il dit dans "Elégie à Martin Luther King":
-
[...]
Je chante l'Amérique transparente, où la lumière est polyphonie des couleurs (p. 302)
Hormis le noir et le blanc, Senghor privilégie le vert et le rouge dans
sa création.
La couleur verte est la couleur du royaume d'enfance, du printemps, du
reverdissement de la nature et du printemps. Elle est porteuse de vie. Ce n'est
pas fortuitement que le poète choisit pour le BDS un écusson vert
sur lequel se dresse une tête de lion. Quant à la couleur rouge,
elle est la couleur du sang. Certes elle met à nu les violences des
crimes mais elle est aussi la manifestation d'une vie sans cesse renaissante.
-
Tyarorye
Non, vous n'êtes pas morts gratuits Ô Morts ! Ce sang n'est pas de
l'eau tépide.
Il arrose épais notre espoir, qui fleurira au crépuscule (p. 90)
La figure de l'hypotypose est donc présente à travers les images du visage, du masque et du corps perçu comme une oeuvre d'art. Elle est aussi visible à travers des couleurs vives. Mais si le poète se veut sculpteur comment peut-il figer, par exemple, le mouvement du danseur ? Autrement dit, n'y a-t-il pas un paradoxe entre le mouvement et l'immobilité ?
| II - LA PROBLEMATIQUE DU MOUVEMENT ET DE L'IMMOBILITE |
Rendant compte des fonctions de l'hypotypose, Henri Morier parle ainsi de la fixation d'une essence dynamique :
-
[ ...] Dès que le mouvement acquiert une qualité et une forme
constantes, on voit se reconstituer une permanence à l'intérieur
du changement. Alain montre bien qu'un certain effet de cinéma tend
à l'abolition du mouvement : cette mouette que le même battement
d'ailes emporte hors de l'écran est immobile dans le schéma de
son vol ; cette vague qui revient à l'assaut du roc blanchit pour
l'éternité ; cette bataille de Taillebourg n'est que bras
levés et sans cesse abattus. Effet de kinétoscope plus encore que
de cinéma : les mêmes séquences se renouvellent pour
décrire un geste unique [...] "Toute métamorphose désigne
une permanence" (cf Jean Rousset, L'intérieur et
l'extérieur, Corti, 1968, p.245). Ainsi se trouve
réalisée la condition poétique, posée par Goethe,
de l'unité dans la variété [...] "[5]
Ces remarques préliminaires nous aident à mieux comprendre l'oeuvre de Senghor. Le mouvement y est inscrit de façon permanente. Ce mouvement a pour nom rythme.
Le poète écrit :
-
Les poètes gymniques de mon village, les plus naïfs, ne pouvaient
composer, ne composaient que dans la transe des tam-tamps, soutenus,
inspirés, nourris, par le rythme des tam-tams.
Pour moi, c'est d'abord une expression, une phase, un verset qui m'est soufflé à l'oreille, comme un leitmotiv, et, quand je commence d'écrire, je ne sais ce que sera le poème.(p. 161)
Le rythme à l'origine de la création poétique se manifeste dans la danse. Ce n'est pas un hasard si Senghor affirme que l'homme noir est un homme de la danse.
-
Prière aux Masques
[...]
Nous sommes les hommes de la danse, dont les pieds reprennent
vigueur en frappant le sol dur. (p. 24)
Comme le géant Antée de la mythologie grecque, l'homme noir est
en osmose totale avec la terre mère, mère - nourricière
(alma mater).
Le nègre qui danse vibre de tout son corps en contact avec la terre
comme pour faire corps avec les forces dyonisiaques du cosmos.
Nietzsche met en relief dans son oeuvre le principe du dyonisisme qui correspond, en fait, chez Senghor au rythme. Le dyonisisme se définit comme le dépassement du négatif et l'affirmation de la vie. Ce qui fait de Nietzsche le héraut de la gaieté et de la force libérée. Le philosophe allemand est celui qui traduit le mieux le vitalisme que Michel Decaudin définit comme le "culte de l'expérience, découverte de la beauté de la vie quotidienne, morale de l'énergie, optimisme, panthéisme."[6]
Le vitalisme est un amour fou de la vie. Il sous-entend la disparition des forces inhibitrices et l'éclosion de toutes les énergies. Aussi pensons-nous que le dyonisisme est un vitalisme libérateur. Or le Nègre a fait de la danse un moyen extraordinaire de joie.
-
Le rythme chasse cette angoisse qui me tient à la gorge (p.201)
Toute l'oeuvre de Senghor se donne à nous comme un hymne à la danse.
-
Epîtres à la Princesse
[...]
Et Lilanga ma soeur. Elle danse elle vit.
[...]
Et pourquoi vivre si l'on ne danse l'Autre ?
Lilanga, ses pieds sont deux reptiles, des mains qui massent des pilons qui battent des mâles qui labourent.
Et de la lettre sourd le rythme, sève et sueur, une onde odeur de sol
mouillé
Qui trémule les jambes de statue, les cuisses ouvertes au secret
Déferle sur la croupe, creuse les reins tend ventre gorges et collines
Proues de tam-tams [...]
[...]
Les tam-tams roulent, les tam-tams roulent, au gré du coeur. Mais les tam-tams galopent hô ! Les tam-tams galopent. (p. 144)
Le rythme senghorien est de l'ordre de la création artistique. Il s'inspire certes de la réalité immédiate mais pour lui donner une dimension autre. Car comme nous l'avons déjà dit, le poète se veut sculpteur. A ce stade, il n'est pas inutile de noter au passage que le mouvement en tant que tel ne peut se poursuivre indéfiniment. Tout mouvement appelle, pour ainsi dire, à brève ou longue échéance son arrêt, sa disparition ou sa mort. Aussi peut-on se demander si ce n'est pas la peur de finitude qui est l'un des ressorts importants de l'art et fait de celui-ci un refuge exemplaire pour le créateur - artiste.
Et justement le mouvement qui est consubstantiel à la vie en son dynamisme plénier renvoie paradoxalement à son contraire c'est-à-dire à la mort elle-même en tant qu'elle est la gélification de la vie, absence de tout cynétisme. Un danseur extra-ordinaire qui nous fascine par la virtuosité de ses pas est bien obligé de s'arrêter à un certain moment.
Le thème de la fatigue est bien rendu dans cet extrait de "Tout le long du jour ..."
-
[...]
Voici que décline la lune lasse vers son lit de mer étale
Voici que s'assoupissent les éclats de rire, que les conteurs eux-mêmes
Dodelinent de la tête comme l'enfant sur le dos de sa mère
Voici que les pieds des danseurs s'alourdissent, que s'alourdit la langue des choeurs alternés. (p.14)
De même, un être vivant qui porte en lui le rythme de la vie verra ses forces décliner progressivement au fil du temps jusqu'à la mort. Or l'art qui est célébration extrême de la vie pérennise la vie notamment dans la sculpture. On ne peut pas ne pas songer à la formule de Gautier "Le buste survit à la cité". Chez Senghor le mouvement du danseur dans son rythme spiralé et même dyonisiaque se fige, s'immobilise.
C'est la raison pour laquelle dans la description des gestes du danseur nous remarquons des indices de la sculpture comme la présence non gratuite de ces "jambes de statue".
Il est un fait avéré que le poète veut fixer le transitoire dans l'éternel. Et il n'y a de beau véritable que dans le dépassement de l'éphémère. La vision du geste en sa scansion régulière jusqu'à saturation est saisie par le regard pétrificateur du poète-sculpteurs. Le mouvement n'est pas annulé mais est capté pour accéder au permanent par la magie de la création scripturaire. Le thème du retour participe de cette volonté d'immobiliser le mouvement et l'instant.
Fernando Lambert écrit justement :
-
C'est à l'intérieur même du poète, dans ses
souvenirs, que la poésie plonge d'abord ses racines. L'anaphore
constituée par les nombreux "je me rappelle" du
poème "Joal" le conforme éloquemment. Ce monde de
souvenirs passe, on le sait, par le royaume d'enfance. La radiance de l'enfance
a pour le poète, un effet magique ; elle suspend le temps, elle le rend
étal, éternel, unique. (p.7) [7]
Le retour est ce processus par lequel le poète retrouve les bases de son être angoissé en ce présent dilatoire qui est le maître-mot de la poésie de Senghor. Le présent est l'autre nom de l'éternité. Autant le mouvement est statufié autant l'absence de bruit révèle un rythme souterrain.
-
Nuit de Sine
Qu'il nous berce le silence rythmé (p.14)
On comprend dès lors que le poète nous donne d'accéder à un rythme qui échappe au commun. La statue apparemment sans mouvement est alors parcourue d'un rythme sous-jacent qui la rend plus vivante qu'un être inscrit dans la fulgurence de l'éclair et par cela même "voué au néant vagissant" pour parler comme la voix blanche dans Chaka. La finitude est abolie par la création artistique. Le bonheur est possible, l'oeuvre nous le donne, nous le montre, nous le dit à portée de mots, à coups de vers et de versets pour ne pas dire à coups de scalpels.
Il faut conclure.
La littérature entretient des relations avec les autres arts. La
poésie de Senghor nous montre ainsi que la sculpture est sa soeur
jumelle.
D'une part, le poème lui-même est comparé au sculpteur, le
poète étant comme un instrument dans les mains de l'oeuvre qui
est rythme.
D'autre part, la poésie, comme la sculpture, proclame la
suprématie des arts sur la réalité immédiate en sa
dimension fugace.
La poésie se mue elle-même en réalité plastique par la magie des mots gravés sur la "pierre-papier" pour donner un surcroît d'âme à cette beauté évanescente, passagère comparable à la Rose chantée par Ronsard.
Nous disons enfin que la poésie fait non seulement corps avec le monde sensible dans lequel nous sommes, mais lui donne plus de rutilance, d'éclat comme l'incandescence sans pareille du premier soleil sur le premier matin, et, "ipso facto" plus de réalité que la réalité.
Notes
[1] L. S. SENGHOR, "Fonction et signification du premier festival mondial des Arts nègres" in LIBERTE III (Négritude et civilisation de l'Universel), Editions du Seuil, 1977, P. 59.
[2] L. S. SENGHOR, Poèmes, Ed. du Seuil, 1964, P. 128, Collection "Points".
[3] L. S. SENGHOR, Poèmes, Ibidem, P. 132.
[4] Henri MORIER, Dictionnaire de poétique et de rhétorique, P.U.F., 1961, P. 524.
[5] Henri MORIER, Dictionnaire de poétique et de rhétorique, OC, P. 529.
[6] M. DECAUDIN, La crise des valeurs symbolisées, Slathorie, 1981, P. 167, " Références".
[7] Fernando LAMBERT, "La Poésie de L. S. Senghor, une poésie du présent" in L. S. Senghor un poète, volume 9, L'Harmattan, 1988, P. 192, "Publications du Centre d'Etudes Francophones de l'Université de Paris XIII" "Itinéraires, et contacts de cultures".
René Gnaléga est
Maître-Assistant au département de Lettres Modernes,
Université d'Abidjan à Cocody. Il enseigne la poésie française
et la poésie
africaine d'expression française. Un ouvrage sur la poésie de Senghor est
en voie d'être publié aux Nouvelles Editions ivoiriennes. René Gnaléga prépare
actuellement un autre ouvrage sur la poésie de Jacques Rabemananjara.
Back to [the top of the page] [the contents of this issue of MOTS PLURIELS]