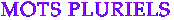
No. 12. Décembre 1999.
https://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP1299coulibaly.html
© Editions Donniya
"Kandioura Coulibaly et ses costumes"
Toutes les histoires que racontent les films
africains sont celles d'hommes et de femmes, d'objets et de symboles, de
paroles et de vérités d'ailleurs... du passé. En ces
temps là, la lumière de la nuit était différente de
celle de maintenant. La couleur de la terre, la forme des maisons et même
les vêtements des hommes étaient autrement faits. Le cinéma
africain conte
Les costumes dans le cinéma, sont vraiment comme
l'éclairage, comme le son...
Le costume est même plus que tout cela. Il est, dans le film
conteur, une deuxième voix silencieuse qui raconte la même
histoire que les images. Le costumier capte une partie du rêve du réalisateur et aide
celui-ci à marcher vers l'écran. Notre cinéma... nos films
doivent faire ressortir la culture malienne : nos parures, nos costumes, nos
façons de vivre et nos manies.
Faire ressortir le caractère de ceux dont c'est l'histoire. Quand on voit un personnage apparaître, on doit pouvoir savoir qui il
est de par son costume. Dans notre réalité sociale, le rôle
de chacun est défini et précis. Si le cinéma ne peut pas
prendre en compte tous ces éléments, il sera sans âme, sans
racine.
Le costume habille l'histoire, il paysage le propos du réalisateur.
Mais le cinéma africain semble, maintenant seulement, se rendre compte
de cette place importante du costume et du décor.
A travers Guimba, le costume a tapé du poing sur la table. Le
costume a fait une révolution au Fespaco cette fois-ci. Mais cette
révolution doit s'améliorer par une recherche continue. Il faut
continuer à vouloir une bonne toilette pour nos films, continuer
à vouloir les pousser plus loin sur les marchés du monde. Mais il
faut se dire que si la marchandise est "sale", les clients
passent à côté. Ils ne demandent pas de quoi il s'agit.
Les histoires de tournage sont toujours les mêmes : le travail a commencé avec un tiers du budget prévu. Il a fallu tout arrêter pendant plusieurs mois. Les infidélités : un réalisateur qui lâche un acteur exigeant; un acteur qui refuse de tourner dans un deuxième film alors qu'il n'a pas été payé pour le premier. Le cinéma africain compte.
Moi je pense que le costume aide le scénario, il le rend
séduisant, lui donne de la crédibilité, il l'habille pour
aller voir le financier. C'est comme quand vous allez voir un ministre ici. Si
vous êtes bien habillé, alors vous êtes bien accueilli
même si vous n'avez pas de bonnes idées. Il vous
préfère à celui qui est mal habillé.
Dans le cinéma africain, c'est comme dans le théâtre
amateur : le costume et le décor doivent cacher le malheur du jeu des
acteurs, remédier à la légèreté des sujets
et à l'insipidité du texte.
Si l'acteur joue mal, on l'oublie et on regarde son costume. Il n'y a rien
sans difficulté. Il faut savoir faire des sacrifices. L'Afrique a des
difficultés. Le cinéma ne peut pas ne pas en avoir. Il ramasse
l'erreur de l'Afrique. Ce qui se passe en Afrique est triste mais les Africains
ne sont pas tristes. Il faut que l'on montre ce côté jovial, cette
réalité. Montrer l'Afrique toilettée à travers le
cinéma. Le costumier va doucement s'imposer comme élément
important du grand cinéma Africain. Pour moi, le film malien est costume
d'abord.
Même si les réalisateurs n'ont pas tous les moyens, ils ne doivent
pas oublier cela. Pour créer chaque costume, je me mets dans la peau des
acteurs, je joue leur rôle intérieurement, en silence. Ce jeu
intérieur me permet de trouver dans mon laboratoire tous les
éléments qu'il lui faut: les gestes qui vont avec les mots qu'il
doit dire, les accessoires qui accompagnent mieux les gestes eux-mêmes,
l'habit qui aide le geste à s'accomplir. Si l'acteur a un front
dégagé, comment le coiffer?
Le cinéma malien se jouait à deux rôles principaux :
le réalisateur et l'acteur.
Les autres rôles de figuration, ils se les partageaient : le
réalisateur assurant parfois à lui seul quatre-vingt pour cent.
Un troisième rôle principal est en train de se jouer. Avec lui, de
nouveaux malentendus. Des conflits de compétence. Le réalisateur
ne peut plus tricher avec les costumes! Il doit jouer le jeu. Garder tous les
rôles mais céder celui du costumier...
Chaque plan est un tableau. En tant que costumier, je peins des tableaux
vivants dans les couleurs, la profondeur et les mouvements. Je peins avec les
éléments naturels.
A Hombori, pendant le tournage du film La "génèse", je suis
allé voir le terrain, toucher les pierres, voir la couleur de l'herbe
aux différentes saisons, la densité du ciel et la force du
vent... Je me dis, c'est le costume qui crée l'harmonie du film.
Depuis Guimba, on parle du cinéma malien en termes de costumes et de
décor... Le costume séduit doucement, petit à petit. Nous
rêvons de grandes productions... qui fassent venir du monde et de
l'argent, qui donnent du travail à l'artisanat et aux techniciens d'ici.
Avec douceur mais en force, le costume perce!
Nous les costumiers n'avons pas l'écran, il appartient aux
réalisateurs. Nous devons être doux si nous voulons être
dans la bateau. Ce sont eux les commandants à bord. Du premier clap au
dernier et même après, il faut être là. Cela demande
de la patience et de l'argent, même si ce n'est pas beaucoup.
Je rêve de faire des défilés après chaque film.
Donner l'occasion au public de toucher les matériaux, de voir de plus
près ce qui brille. Je rêve aussi (pour le moment nous n'avons pas
de gros budget costumes) d'un musée du costume de cinéma malien.
En attendant, patience! Du scénario aux costumes finis, il me faut au
moins sept mois de travail. Puis après, c'est le public content et fier
des trouvailles qui me met dans d'autres rêves. Je rêve tout le
temps. Je fais mes mises en scènes.
Il faut aller vite, la roue tourne et ne perd pas de temps.
La vie est une course. Nous sommes dans des réseaux-aide-obstacles.
Mais le rêve, c'est d'aller vers la lumière. Pour cela, il faut
séduire et le public viendra vers nous. Pour séduire, il n'est
pas besoin de grandes écoles professionnelles modernes ni même
d'écoles traditionnelles. Il faut tout juste aimer. Moi, je n'ai pas
fait d'école de couture ou de stylisme. C'est l'amour du beau costume
qui m'a amené là. Il faut préserver la beauté de
nos ancêtres et de notre famille intérieure... Alors ce que l'on
crée prendra l'espace.
L'écran est un bel espace...
Un autre rêve, c'est d'avoir toute la jeunesse derrière moi.
Qu'elle ait envie de consommer les costumes du film Guimba parce qu'elle les
trouve beaux. Que cela devienne une mode comme le look américain l'est
devenu. Oui, l'écran a un impact sur nous. Donc, il faut qu'on arrive
à améliorer notre cinéma pour gagner l'espace de nos
écrans. Pour qu'ils soient un peu à nous.
Le costume du cinéma est tellement différent du costume de
la vie de tous les jours. Le cinéma historique veut des costumes
d'époque. Il y a des contraintes et des choix. D'ailleurs, le costumier
est-il libre?
La création du costume dépend du scénario. Puis, il
faut trouver les matériaux. Je touche à tout ce qui est malien si
le scénario est malien : le cuir, le coton, la calebasse... toutes les
matières de notre culture et de nos traditions pour coller au
scénario. S'il le faut, je sors de l'environnement malien pour trouver
les meilleures matières.
Ensuite, je regarde la vie et je parle avec les gens pour savoir comment ils
sont, pour comprendre leurs gestes... C'est tout cela qu'il faut pour
créer un costume qui ne soit pas yougou-yougou (friperie). Je ne reste
pas toujours dans la tradition même si j'emprunte mes
éléments à la racine, à la tradition. J'adapte. Je
modernise aussi. En bon styliste, je crée des costumes modernes avec des
matières textiles maliennes. C'est par là que j'ai
commencé : les bandes de cotonnade. Ces bandes, pour moi, sont des
gris-gris, une sorte d'énergie. C'est la peau de la fileuse, de la
teinturière.
La chair plus que la peau.
Oui! La chair du tisserand. Les gens qui portent les bandes de cotonnade
ont comme une deuxième peau d'énergie.
J'ai envie de passer de l'autre côté du mur, rentrer dans le
labo pour voir les secrets qui bénissent les mélanges de couleurs
et d'éclats. Je peux?
Une autre fois... Mais il n'y a pas de secrets cachés.
A L'ECOUTE DE KANDIOURA COULIBALY
Un entretien avec Kandioura Coulibaly, costumier
proposé par Amadou Chab Touré
Editions Donniya
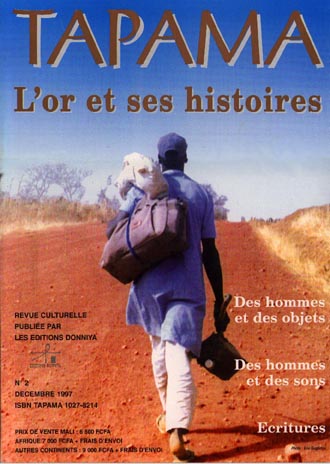
Cet article a été publié dans la Revue culturelle
TAPAMA
no2, Décembre 1997, pp.31-33.
Reproduit avec l'aimable autorisation des Editions Donniya.
This article may not be
published, reposted on the web, or included in a CD-Rom without written permission from Les Editions Donniya.
Le costume habille l'histoire. Le costumier capte une partie du rêve du réalisateur et aide
celui-ci à marcher vers l'écran. Notre cinéma... nos films
doivent faire ressortir la culture malienne : nos parures, nos costumes, nos
façons de vivre et nos manies.
Amadou Chab Touré
Editions Donniya
[Haut de la page] / [Sommaire du numéro 12 de MOTS PLURIELS]