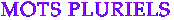
no 12. Décembre 1999.
https://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP1299aht.html
© Editions Donniya
Abdourahamane Hassèye Touré
L’histoire des universités de Tombouctou est encore mal connue de nos jours. En dehors des manuscrits du XVIe siècle, il ne nous reste que quelques reliques des lieux où s’est manifestée cette intense activité culturelle. Qui étaient les animateurs des cours?
Comment fonctionnaient les institutions? Les rôles et les fonctions des produits de ces grandes écoles étaient-ils en phase avec les réalités d’alors?
Autant de questions ouvertes qui pourraient inspirer la jeune université du Mali.
Pourrait-on réhabiliter ces centres d’enseignement pour que Tombouctou retrouve sa splendeur d’antan et redevienne une cité de l’esprit enviée par les pays du Nord et du Levant?
Les universités tombouctiennes:
grandeur et décadence
Editions Donniya, Bamako
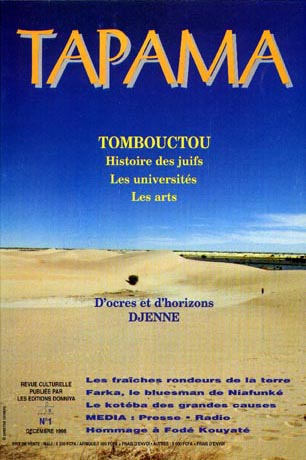
Cet article a été publié dans la revue culturelle
TAPAMA
no1, 1996, pp.6-10.
Reproduit avec l'aimable autorisation des Editions Donniya.
This article may not be
published, reposted on the web, or included in a CD-Rom without written permission from Les Editions Donniya
| Tombouctou avant l’édification du front islamique |
Il serait plus judicieux de parler d’universités au pluriel à Tombouctou, car chaque école (mosquée) abritait un "collège sacerdotal" qui l’animait et dont le cursus et les diplômes étaient reconnus par les autres établissements de la ville et dans le reste du monde musulman.
L’histoire culturelle de cette ville quoique contemporaine à sa fondation, serait selon nos chroniqueurs soudanais [1], l’apanage des seules familles maraboutiques Aqît et Anda. Ils disaient que "sa civilisation lui vient uniquement du Maghreb aussi bien sous le rapport de la religion que sous le rapport des transactions" [2].
Si ces dernières, les familles Aqît et Anda, lui ont donné ses lettres de noblesse, il reste cependant que Tombouctou est largement tributaire de sa ville mère Djenné qui a essaimé "toutes ses premisses de civilisation à travers la vallée occidentale du Niger, loin jusqu’à Tombouctou".
Deux éléments semblent apporter la preuve de cette avance de Djenné sur Tombouctou à propos des choses de l’esprit et le rôle d’avant-garde qu’elle a joué dans la formation de l’élite intellectuelle de Tombouctou. Tout d’abord, Djenné fut convertie à l'islam au VIe siècle de l’hégire et disposait déjà dans les années 1300 de notre ère de 4 200 ulémas [3]. Ensuite, même si cet islam était alors une religion d’Etat, de riches commerçants Wangara [4] et leurs accompagnants Maïga et Gabo migrèrent vers Tombouctou et sont cités parmi les grandes figures de ce prosélytisme islamique.
A Djingareyber, "les premiers personnages qui occupèrent des fonctions d’imam dans cette mosquée furent des savants nègres; ils exercèrent ce sacerdoce sous le règne des gens de Melli et en partie sous celui des Touarèg. Le dernier imam nègre fut le jurisconsulte Cadi Kâteb-Moussa. Il fut imam pendant quarante ans..." [5].
La seconde raison est que Djenné a assumé pendant toute l’époque de gloire de Tombouctou et même jusqu’à une époque relativement récente le rôle d’entrepôt commercial incontournable dans les relations Nord-Sud. "Le site de Djenné est admirablement choisi : avant-poste commercial de Tombouctou et du monde arabo-berbère vers les pays de l’or du sud, à la frontière du monde animiste, il fallait que la ville puisse communiquer librement avec le Nord par le fleuve, tout en étant à l’abri d’un coup de main de ses turbulents voisins qu’auraient pu attirer ses richesses" disait Raymond Mauny [6]. En regardant le tissu social actuel de Tombouctou, on pourrait se faire une idée de ce qu’a été la ville à ses origines quant à son occupation par les différentes composantes ethniques.
La carte de la ville publiée par la revue Sankoré montre Tombouctou au XIVe siècle sous l’occupation mandingue avec comme seules places importantes les forteresses (Palais Madougou, Fortin de Kankou Moussa et la place Koï-Batouma). C’est à côté de ces garnisons que sera édifiée la mosquée de Djingarey-ber qui donnera son nom à l’un des premiers quartiers de la ville.
Une seconde carte de la même revue fait mention des nouvelles frontières de la ville au début du XVIe siècle. En effet, le cœur de la ville est le domaine des populations de Djenné ou de l’ouest qui sont arrivées par voie d’eau jusqu’à Badjindé ou le canal des hippopotames. L’espace était alors partagé en kunda, mot qui signifierait quartier et dont l’origine serait d’ailleurs soninké. On y dénombrait plusieurs kunda : Wangara-kunda, Diawaï-kunda, Birintjé-kunda et Sinawar-kunda...
Chaque kunda correspondait à un corps socio-professionnel et le nom rappelle l’origine du peuplement ou son histoire. Saraï-Keina, qui est parti du minuscule bourg de Bissaou-Tjiré, connaîtra tout d’abord l’influence des apports culturels issus de la campagne de songhaïsation entamée par le Shi. "L’épopée Sonni-Ali en 1468 ouvre la voie à une nouvelle vague de migration cette fois de l’ouest vers l’est. Cette campagne songhoï va au-delà de Tombouctou car les armées du Shi voulaient rattraper les familles des ulémas qui étaient en fuite vers le nord. Elles arrivèrent jusqu’à Arawan où certains régiments ont choisi de s’installer définitivement" [7].
Ensuite en 1591, Sareï-Keïna sera le quartier général des troupes marocaines abritant la Casba, détruite en 1833 par les Peul de Sékou Amadu. "On sait cependant qu’elle était entourée d’une enceinte, avec deux entrées : la porte de Kabara et la porte du Marché. A l’intérieur, plusieurs résidences y étaient aménagées dont le mishwar du Pacha, la mosquée dite de la Casba (ancienne mosquée Al-Khalid), des écuries, un magasin aux grains, une prison et une place publique où étaient disposées les pièces d’artillerie traînées par les Marocains au Soudan".
Sankoré, comme dans l’empire du Ghana, était le quartier des Blancs arabo-berbères qui venaient commercer avec le pays des Soudans mais qui avaient des préoccupations culturelles. L’islam, nouvelle religion des Africains, n’était-il pas le mailleur moyen de s’imposer aux autres composantes sociales?
Mais, fort heureusement, l’édification de ce front islamique maghrébin se heurta à une résistance de quelques néophytes soudanais qui ont su intégrer cette religion au point d’en être la réplique valable des savants moyen-orientaux.
Cette bataille larvée entre gens du Nord et ceux du Sud pour le leadership au niveau de l’enseignement et dans d’autres fonctions administratives et juridiques a été longtemps entretenue par les souverains de la ville (le chef touarèg Akil d’obédience arabo-berbère et les Askia proches des souches africaines). Par ailleurs, nous savons que les fondateurs de la ville (le touarèg Imagcharen) étaient très peu portés sur la religion (F. Dubois).
Cet article n’a pas pour objet de relancer le débat sur les axes de pénétration de l’islam à Tombouctou mais plutôt de préciser les acteurs sociaux de la ville qui ont été les précurseurs de cette instense activité culturelle et religieuse dont le couronnement reste l’installation de ces universités de renom telles que Sankoré ou encore l’oratoire de Sidi Yahya.
Parmi les savants et professeurs émérites de ces universités, nous savons aujourd’hui que certains seraient venus de Djenné et de l’ouest africain, des villes comme Birou (Oualata), Tâïo, etc. Un auteur béninois Z.D. Issifou, en relisant le Tarikh es-Soudan, relève le rôle qu’a joué Djenné dans l’émergence culturelle de Tombouctou et cela avec une dose de réalisme, tout en laissant la part qui est due aux savants maghrébins et égyptiens : "Mais la plus grande fierté de Djenné en tant que ville universitaire" fut d’être le berceau du Câdi Mahmoûd ben Abou Bekr Baghayogo, père des éminents savants Mohamed et Ahmed qui eux feront la renommée de la cutlure islamique noire au Soudan [8].
| Le choix de Tombouctou pour abriter l’université du Soudan |
Les raisons sont de plusieurs ordres:
* Géo-économiques : ville carrefour, elle servait de rupture de charge pour les commerçants berbères du Nord et les populations noires du Sud qui s’échangeaient esclaves, colas et chevaux contre livres, sel et tissus...
Mais c'etait surtout les ressources naturelles de la ville qui faisaient la convoitise des populations pastorales du Nord et des agro-pasteurs et pêcheurs qui arpentaient les riches vallées du Niger.
Tombouctou et son hinterland constituaient les derniers oasis pour les caravaniers nomades venant du désert. Ses riches pâturages de saison sèche permettaient aux troupeaux de séjourner jusqu’au retour des pluies.
Le fleuve, par ses nombreux affluents, inondait des vallées fertiles aujourd’hui fossiles ce qui permettait aux populations sédentaires de mettre en culture les plaines situées au sud de la ville. Jusqu’à une période récente, le canal qui relie Tombouctou au fleuve Niger servait à la mise en eau d’immenses espaces de culture de contre-saison. L’intérieur de la ville regorgeait de mares et d’étangs qui entretenaient des périmètres maraîchers et des points d’abreuvement pour les animaux.
* Les considérations géo-poliques sont certainement l’élément le plus déterminant qui a favorisé l’éclosion de cette université, loin des capitales des grandes principautés d’alors (Mali, Songhay, Yatenga) qui, malgré leurs incursions, n’arrivaient pas à établir un contrôle effectif sur la ville.
* Enfin, la recherche d’un nouveau pôle pour l’islam serait une raison de la conquête de la ville. Les intellectuels arabo-berbères reculaient devant les poussées chrétiennes dans le nord de l’Afrique [9] et les Soudannais, après les exemples d’Etats théocratiques du Ghana et du Mali, voulaient reproduire une formation politique gérée par les préceptes islamiques, loin des grandes turbulences mais aussi des "islams entachés de paganisme" [10].
| Les fondements institutionnels des universités |
Le concept tombouctien de l’université est comparable à celui de l’église chrétienne du Moyen âge européen qui estimait que l’université était "une institution ecclésiastique jouissant de privilèges royaux et pontificaux et chargée de l’enseignement".
A Tombouctou, l’université s’est appuyée sur la gent islamique et a bénéficié du soutien matériel et d’une caution juridique de différents régimes politiques, notamment celui des Askia. Son cadre institutionnel repose sur un ensemble d’établissements (mosquées, écoles coraniques, oratoires, etc.) dont la gestion et le fonctionnement étaient très adaptés aux préoccupations des adeptes et aux conditions socio-économiques de la ville. En fait, les Soudanais avaient transcendé les dimensions spatiales et temporelles de l’université. Les séminaires et cours étaient dispensés de façon itérative aux différentes heures de la journée et il n’y avait aucune exigence pour les apprenants que celles relatives aux aptitudes intellectuelles à suivre les grandes digressions des professeurs.
Les mosquées constituaient les principaux centres d’enseignement. Parmi les plus célèbres, il y avait:
* Djingerey-ber. Construite entre 1325 et 1330 par l’empereur du Mali de retour de la Mecque. L’architecte Abou Ishaq Es Sahedi Al Touedjin a reçu 40 000 mithcals d’or pour la conception.
* Sankoré. Probablement construite entre 1325 et 1433, sa "partie nord servait de salle de classe du temps où la mosquée jouait la fonction d’université".
* L’Oratoire de Sidi Yahya ou mosquée de Mohamed Naddah. Elle fut créée vers 1400 et c’est 40 ans plus tard que le savant fut investi des fonctions d’imam.
Ces trois mosquées ont été réhabilitées par le cadi de Tombouctou El Hadj El Aqib. D’autres mosquées furent édifiées sous l’occupation marocaine : El Hena (1620-1630) fut détruite par les Peuls entre 1826 et 1860. Celle de Kalidi qui fut plus tard transformée en garnison, et enfin celle de Algoufour aujourd’hui fondue dans le quartier de Sarey-Keina.
Cette intense activité intellectuelle était soutenue par une riche bibliothèque universitaire dont les références pouvaient être obtenues auprès des professeurs. Chaque universitaire avait sa propre bibliothèque, constituée à partir d’ouvrages achetés ou échangés sur le marché du livre ou bien copiés auprès d’autres érudits.
Il convient de souligner qu’une fonction capitale, celle des scribes, qui fit la prospérité de ce fonds documentaire est aujourd’hui désuète. Un vaste commerce de manuscrits dont les retombées économiques étaient substantielles a dû caractériser cette époque médiévale.
De ces établissements, animés par d’éminents professeurs pour lesquels J.B. Villars n’hésite pas à donner les qualificatifs "d’Abelard, de Saint Thomas d’Aquin et de Maritain noirs" et des étudiants "plein d’ardeur pour la science et la vertu" (T.S.), sortaient les grands dignitaires de l’Etat : Cadi, Imams, professeurs, conseillers des rois, scribes, calligraphes...
Parmi les professeurs d’université, on peut citer quelques noms célèbres:
* Abou Hafs Omar, agrégé dans la science de la tradition, les biographies, les annales, l’histoire et le droit.
* El Hadj Ahmed, grand-père de Es-Sa’di, jurisconsulte, lexicographe, grammairien et prosodiste, avait laissé 700 volumes dont la plupart étaient "écrits de ses mains avec de copieuses annotations".
* Mahmoud ben Godalà fit progresser l’enseignement du droit.
* Le théoricien du droit, de la rhétorique et de la logique Ahmed ben Yahya possédait l’une des bibliothèsques les plus riches.
* Sidi Yahya El Tadelsi, au sujet duquel Zeid Abderrahman disait "qu’il est du devoir des gens de Tombouctou de visiter chaque jour le mausolée..." tant sa science était grande.
* Enfin, Ahmed Baba qui fut le plus célèbre étudiant et maître que Tombouctou ait jamais connu.
Du fonctionnement de l’uiversité, on sait peu de choses concernant les émoluments des professeurs. On sait quand-même que les rois et les grands dignitaires de la ville leur faisaient de grands présents : cotations sur les récoltes, dons d’esclaves et de concubines, financement de leurs voyages d’études ou sur les lieux saints de l’islam, etc.
Des critiques ont été faites au sujet des enseignements qui, semble-t-il, ont été trop focalisés sur la religion et les sciences humaines, mêmes si on reconnaît que certains universitaires se sont intéressés à l’astronomie. Il faut rappeler que les préoccupations des populations d’alors n’étaient pas d’aller sur la lune ou d’inventer de nouvelles machines, mais plutôt d’établir un nouvel ordre social basé sur la justice, la connaissance de la foi, la cartographie des lieux...
La pépinière de savants et érudits sortait de différentes écoles coraniques qui préparaient les jeunes à l’entrée à l’université après une dizaine d’années de cours sanctionnés par une licence Ijaza.
L’enseignement était assuré par des professeurs alfas dont le système de rétribution dépendait des présents donnés en nature ou en espèces par les élèves tous les mercredis de chaque semaine. Cette sorte de redevance, connue sous le nom alarba-dakara, était fixée en fonction de la situation socio-économique des parents d’élèves. Elle ne saurait être confondue avec l’exploitation matérielle de certains maîtres coraniques de nos jours.
Le cheikh Mohamed ben Ahmed, qui visita un mercredi l’école du célèbre Ali Takaria, attesta que ce dernier avait reçu 1725 cauris de ses disciples. L’enseignement était axé sur la connaissance des "114 chapitres du Coran", l’écriture et la calligraphie.
| Le parti musulman: le rayonnement culturel et le rôle des ulémas dans la vie socio-politique de Tombouctou |
Les auteurs sont partagés à ce sujet. Certains, comme H. Barth, considèrent que la classe intellectuelle "n’a joué à aucune époque, et surtout à celle de l’antique splendeur du pays, qu’un rôle politique tout-à-fait secondaire..." [11]. D’autres, comme D.Z. Issifou, mettent à l’actif de cette classe des ulémas, tous les malheurs du brillant empire songhoy.
Ce débat fera peut-être l’objet d’un autre article, mais il situe tout de même le rôle qu’a pu jouer la classe intellectuelle dans la gestion de l’empire songhoy. Voici quelques faits marquants de son histoire. Elle aurait pactisé avec les Touarèg contre Sonni Ali qui, en 1468, s’en est vertement pris aux ulémas. Elle a également été le réceptacle du pouvoir des Askia lors du coup d’Etat contre le Shi en 1493.
Selon D.Z. Issifou, tout le règne de la dynastie des Askia sera marqué par les ulémas. D’ailleurs, il pense que si "les Askia ont joué pleinement la carte musulmane, par conséquent, celle de Tombouctou, c’était d’une part dans le but de continuer à bénéficier du soutien politique de cette communauté islamique bien organisée et, d’autre part, pour mieux la surveiller en réduisant ses vélléités d’opposition" [12].
D’autres auteurs soutiennent que ce sont les exigences mêmes de l’Etat théocratique qui justifiaient le rôle des ulémas; "les ulémas par leurs conseils l’orientaient et participaient souvent à l’exercice du pouvoir. C’étaient eux qui inspiraient la politique impériale" [13]. Enfin, cette classe intellectuelle qui a aidé les Askia à gouverner sera incriminée dans la chute de l’empire à Tondibi en 1591.
On ne peut conclure sur les rôles et l’importance des universités à Tombouctou sans faire allusion aux différentes conquêtes qui entamèrent cette belle construction universitaire:
* La conquête de la ville par Sonni Ali au XVe siècle. Le shi persécuta les ulémas et confisqua leurs biens.
* L’invasion marocaine au XVIe siècle vit la déportation de nombreux savants parmi lesquels le célèbre Ahmed Baba.
Ce qu’il convient d’appeler la trahison des gens de Tombouctou et non le "renouvellement du serment de fidélité au sultan" dans la mosquée de Sankoré reste encore gravé dans la mémoire de tous les fils du pays. Selon le T. El Fettach : "Tous les habitants de Tombouctou s’assemblèrent donc dans cette mosquée et on fit apporter le Coran (Le Salîh d’El Bokhâri et celui d’El Moslim). Ceci se passait dans la matinée du mercredit 24 du même mois (20 octobre 1593). Quand tout le monde fut réuni, tandis que les fusilliers marocains se plaçaient à toutes les issues et sur les terrasses, alors se produisirent toutes les choses que Dieu avait décidé, des choses qu’il ne convient pas de raconter car le cœur ne pourrait supporter le récit... Ce fut le plus grand préjudice qui ait été porté à l’islam tout entier" (page 304 et suivantes).
Au cours de cette déportation, plusieurs savants furent mis à mort. Ce fut le début de la décadence. L’auteur du Tarikh El Fettach considère qu’après l’exil des savants "Tombouctou devint comme un corps sans âme..."
Tombouctou se relèvera de cette décadence après le retour de quelques-uns de ces ulémas mais les incursions touarèg Kel-Tadmekket et peul du Macina vers la fin du XVIIe et au XVIIIe siècles affecteront de façon irréversible le développement culturel de la ville.
Les visées impérialistes françaises donneront au XIXe siècle le coup de grâce à cette brillante culture. Certains missionnaires rapportèrent au gouvernment des colonies les mécanismes de la conquête culturelle de la ville de Tombouctou.
Félix Dubois [14] le stigmatise de la façon suivante: "Enfin, j’avais rêvé également d’un Tombouctou devenu un foyer de langue et de culture française, comme elle fut jadis un centre de culture arabe." Déception encore! On ne s’est point soucié, non plus, de prendre en main le grand levier moral et intellectuel qu’offre Tombouctou. Elle fut, de tout temps, le cerveau du Soudan. Les savants de son université étaient connus dans les universités de Fez, de Kaïroman au Touat et en Tripolitaine. Après une instruction primaire reçue au pays natal, c’est ici que Soudanais et gens du désert venaient faire de hautes études. Le proverbe soudannais dit "le sel vient du Nord. L’or vient du Sud. L’argent du pays des Blancs, les histoires et les contes jolis, on ne les trouve qu’à Tombouctou" (pages 80,81).
| Le livre dans la cité Salem ould Elhadj |
Notes
[1]. Es-Sa-di et Mohamed kâti, respectivement auteurs de Tarikh es-Soudan et Tarikh-El-Fettach.
[2]. Tarikh El-Fettach, pages 35/37.
[3]. in J.L. Triaud, 1973.
[4]. Les descendants de nos jours peuplent le quartier de Badjindé à Tombouctou.
[5]. T. El-Fettach, page 92.
[6]. in J.L. Triaud, 1973, pages 127 et 128.
[7]. in A.H. Touré (Mémoire Ensup 1985, page 37).
[8]. Z.D. Issifou, page 192, 1982.
[9]. Expéditions de Louis IX contre l’Egypte (1248-1254) et contre Tunis en 1270.
[10]. in A.H. Touré (Mémoire de fin d’études Ensup, 1985).
[11]. in J.L. Triaud, 1973.
[12]. D.Z. Issoufou, page 190, 1982.
[13]. Sidi Y.B. Maïga/CEDRAB.
[14]. F. Dubois "Notre beau Niger", éditions Flammarion. Paris 1911, page 299.
Bibliographie
Félix Dubois. Tombouctou, la mystérieuse. Paris: Ed. Figaro, Flammarion, 1897.
Jean-Louis Triaud. Islam et sociétés soudanaises au Moyen-age. Recherches voltaïques 16, Paris-Ouagadougou: CNRS-CVRS, 1973.
Tarikh El Fettach. Mahmoûd Kâti ben El Hâdj, El-Moutaouakkel Kâti. Paris: Ernest Leroux, 1913.
Adame Konaré Bâ. Sonni Ali. Etudes nigériennes no 40, IRSH Niamey, 1977.
Zakari Dramani Issirou. L’Afrique Noire dans les relations internationales au XVIe siècle. (Analyse de la crise entre le Maroc et le Songhoy) Paris: Ed. Karthala, 1982.
Sidi Yahiya Bania Maïga. Contribution des Askia à l’expansion et au rayonnement de l’islam en Afrique de l’Ouest. Tombouctou: CEDRAB, n.d.
Tarikh Es-Soudan. Es-Sa’di, Paris: Maisonneuve, éd. Hondas, 1981.
Abdourahamane H. Touré Tombouctou, le monde culturel non islamique. In mémoire de maîtrise, Ensup 1984-1985.
J. Bernard Villars L’empire de Gao Etat soudanais aux XVe et XVIe siècles. Paris: Plon, 1942.
Sankoré. Revue de vulgarisation scientifique. Ministère de l’Education nationale de la Jeunesse et des Sports, ESRS, Coll. Populaire no1973.
Back to [the top of the page] [the contents of this issue of MOTS PLURIELS]