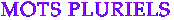
Vol.1. no 4. 1997.
https://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP497jvindex.html
© Jean-Marie Volet
Jean-Marie Volet
The University of Western Australia
On entend souvent dire que les femmes écrivains africaines d'expression française ont surtout contribué à élargir le domaine des lettres en y privilégiant un certain nombre de thèmes souvent négligés : les rapports familiaux, la naissance et l'éducation des enfants, la sexualité de la femme, les méfaits de la polygamie, etc.
Certes, les textes écrits par des femmes au cours de ces 20 dernières années comportent une masse considérable d'éléments propres à justifier cette vision des choses. Les écrivaines - tout comme leurs lecteurs et leurs lectrices - sont en partie le produit d'un environnement socio-culturel qui distingue de manière plus ou moins arbitraire, mais non moins catégorique, ce qui est du ressort des femmes et ce qui ne l'est pas. Il semble donc plausible que le fait d'écrire ait conduit les romancières à une meilleure représentation des problèmes de société qui les touchaient de près.
Cependant, à limiter le champ de la critique aux thèmes saillants sur lesquels se fonde, disent certains, l'originalité de la littérature féminine, on en vient à oublier ceux qui ne s'imposent pas d'emblée ou qui semblent être un domaine réservé à d'autres auteurs. Le thème de la guerre est un bon exemple. Considéré par la tradition comme étant situé en marge des responsabilités de la femme, il a été rejeté à la périphérie de l'analyse critique des romans écrits par des femmes africaines. Pourtant, les images dont nous bombardent les médias jour après jour montrent assez que les femmes comme les hommes se retrouvent toujours au centre des conflits les plus divers et de nombreux livres de femmes africaines évoquent cette violence qui n'est pas - et n'a sans doute jamais été - une mâle affaire où la soldatesque s'étripe à huis clos, loin de toute région habitée. La nouvelle de Marie-Léontine Tsibinda qui a été inclue dans ce numéro de Mots Pluriels en témoigne.
De l'ouvrage entièrement dévolu à un conflit de type "traditionnel" aux livres mentionnant en passant un état de guerre larvée ou un mouvement de résistance finalement réprimé, en passant par la poésie militante de Monique Bessomo, on trouvera une masse d'ouvrages faisant peu ou prou allusion aux conflits qui ont rythmé l'histoire de l'Afrique au gré d'événements sanglants dont les femmes ont été les victimes plus souvent qu'à leur tour.
Soulignons d'emblée qu'un survol de l'image de la guerre dans les écrits des romancières africaines nécessite un élargissement de la définition même du mot "guerre" qui échappe non seulement aux classifications bien nettes des dictionnaires, mais aussi aux images stéréotypées proposées par de trop nombreux livres d'histoire qui mettent en scène de grandioses batailles où la chair à canon est décimée au gré de manoeuvres savamment préméditées. Pour les enfants de la misère, la guerre représente au mieux l'attrait d'un uniforme grossier, comme le montre Simone Kaya dans l'extrait d'un de ses romans publié sur internet, ou l'espoir d'une solde misérable. Dans la réalité tragique de son inhumanité, la guerre représente l'angoisse d'une mère qui voit partir son fils vers la mort, les enfants arrachés à leurs parents pour devenir soldats, le pillage, les longs séjours en prison, la terreur imposée aux populations civiles, la torture, les viols, les exécutions sommaires, les villages détruits, une liste d'horreurs qui n'en finit pas, un univers où, comme le dit Michèle Rakotoson dans sa pièce Elle dansa sur la crête des vagues,
- même les chiffres deviennent fous, l'absurde et l'horreur deviennent normaux, ordinaires, 100 000, 200 000, un million de personnes bientôt sur la route de l'exode, la natte sur la tête et la petite casserole où cuira peut-être une racine, de la boue, une illusion de vie, de nourriture. (Manuscrit, p.31).
Révélatrice de la nature humaine aux heures les plus graves, l'image de la guerre proposée par les romancières suggère aussi un certain nombre de constantes allant bien au-delà des différences individuelles. Plusieurs critiques ont par exemple noté la propension des écrivains femmes à se situer et à situer leur personnages "en relation" avec autrui même aux heures les plus difficiles où la séparation semble inévitable. Cette insistance à renforcer les liens alors que tout s'accorde à vouloir les rompre n'est nulle part plus évidente que dans le cas qui nous préoccupe.
Le Chant des fusillés de Nadine Nyangoma est un cas de figure. Ce roman raconte le destin tragique de Mutima, un jeune Hutu du Burundi exécuté sommairement lors d'un des nombreux mouvements d'insurrection qui précédèrent les massacres de 1972 où plus de cinquante mille Hutu trouvèrent la mort. Abandonnons à l'Historien le soin d'apprécier la valeur historique de cet ouvrage publié sous l'appellation de roman, pour nous pencher sur l'attitude des deux personnages principaux, Mutima et Catherine, son amie. Deux personnages, deux visions de la guerre, deux perceptions des relations humaines. Pour Mutima c'est l'issue inévitable d'une lutte à mort qui le conduit à penser qu'il n'a pas le droit d'entraîner délibérément sa compagne dans un enfer programmé d'avance. S'il finit par se rallier à la manière de penser de son amie et à lui reconnaître le droit de décider par elle-même jusqu'où il convient qu'elle le suive, les vieux réflexes n'attendent que l'occasion opportune de refaire surface et à l'heure où la séparation semble imminente Mutima s'écrie :"j'aurais dû rester célibataire. Pas de femmes sur ce chemin sanglant, pas d'attaches déchirantes"(p.199).
Pour Catherine, au contraire, la guerre s'inscrit au coeur de sa relation avec Mutima et il n'est pas question qu'elle attende, docile et éplorée, le retour ou l'annonce de la mort du héros:
- Attendre en Belgique? dit-elle. Dix ans. Vingt ans? Toute une vie? Attendre quoi? Jouer à la femme qui attend? je ne peux pas. C'est horrible d'attendre dans son inutile impuissance. Toi, dans l'action, tout occupé à lutter, et moi en Belgique, ou sur quelque frontière à ruminer le silence qui ne m'informe pas sur toi. Toujours le
même tableau du mari qui part à la guerre, milite, et de sa bonne épouse qui attend. (pp.199-200)
Sans compter l'engagement direct de nombreuses femmes dans les armées les plus diverses, l'idée d'une épouse passive attendant le retour du soldat n'est guère représentative. Les six ans passés par Léonie Abo dans le maquis congolais aux côtés de Pierre Mulele, pourchassé par les troupes de Mobutu, le montrent bien. Son autobiographie et le témoignage écrit à l'occasion du vingt-troisième anniversaire de la mort de son époux, représentent une source d'information de première main. Si l'expérience de Madame Abo s'inscrit dans les limites d'une action de résistance où s'affrontent deux armées, de nombreux autres textes montrent que la guerre n'est pas uniquement le fait de forces armées bien structurées.
Bien des mouvements de guérilla, de conflits larvés et de répression ou d'opposition à des tyrans sanguinaires ne permettent pas de distinguer le front de l'arrière, le civil du militaire. A cet égard, il est intéressant de lire en parallèle le Carnet de Prison (Abidjan: Ceda,1984) de Bernard B. Dadié et La Marche des femmes sur Grand-Bassam d'Henriette Diabaté. Nous nous trouvons là à la limite de la littérature et de l'Histoire, de l'organisation politique et du mouvement insurrectionnel. Les deux livres évoquent l'emprisonnement des dirigeants syndicaux ivoiriens dans le cadre de la guerre larvée menée par le gouvernement français contre les mouvements indépendantistes qui demandaient le retrait des forces coloniales de leurs pays vers la fin des années 1940 et au début des années 1950. Dadié écrit du point de vue des prisonniers enfermés pendant plus d'une année dans la prison de Grand-Bassam à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan. Diabaté se fait le porte parole des femmes séparées de leurs époux et promptes à se demander "si éventuellement les femmes ne pouvaient rien tenter pour la libération de leur maris, plutôt que de se contenter de leur porter du linge et à manger"(p.23). L'histoire témoigne du succès de leur entreprise qui conduisit indirectement à la libération des prisonniers quelques mois plus tard, mais elle montre aussi le prix humain de leur engagement comme en témoigne Madame Marie Koré, battue, jetée en prison et incapable d'assister à son procès tant elle était mal en point: "Il m'ont fait mal, il m'ont tapée au côté gauche avec leur fusil et je sens que je ne vais pas bien". (p.54). Les abus des forces coloniales n'en font pas oublier pour autant les excès des forces armées leur faisant face, souvent promptes à répondre à l'horreur par l'horreur, oeil pour oeil, dent pour dent. Les premières lignes d'Assèze l'Africaine de Calixthe Beyala ou encore une nouvelle de Marie Claire Dati intitulée Le Préfet et les maquisards, elle aussi située au début des années cinquante, au Cameroun, nous rappellent que les violences contre les populations n'étaient pas uniquement dues aux forces d'occupation.
Plusieurs livres évoquent la période qui a suivi les indépendances. Après une brève période d'euphorie, il devint rapidement évident que les armées coloniales avaient cédé la place à de nouvelles armées aussi féroces que les précédentes. A l'opposition à l'intrus colonialiste succédait une "drôle de guerre" dominée par un florilège d'assassinats, de mesures répressives, d'insurrections, de coups d'Etat militaires et de grands massacres des populations civiles. Dans son roman Ex père de la nation, Aminata Sow Fall décrit fort bien le chemin qui conduit Madiama, un homme ordinaire et bien intentionné, à devenir le jouet de ses conseillers et un despote terrorisant la population par la torture et le règne de l'arbitraire:
-
Les femmes avaient été transportées sans interrogatoire ni jugement à la prison des femmes, et les autres à la maison d'arrêt des délinquants durs pour y subir 'une bonne lessive', disait Yorro. Et il racontait comment ces délinquants traitaient les nouveaux venus: viols, sévices et tortures de toutes sortes(p.152).
La répression sanglante qui a marqué l'histoire de la Guinée et tant d'autres pays africains est aussi mentionnée brièvement dans Senteurs d'hivernage, un roman qui relate le départ de Anita Tembi Mkwanazi d'Afrique du Sud où elle a maille à partir avec le régime et se trouve à deux doigts de se faire lyncher. Mais son arrivée en Guinée correspond avec les premières exécutions publiques ordonnées par Sékou Touré et Tembi n'est pas prête à partager la mansuétude de sa mère qui affirme :
-
Oui, je sais ce que tu penses: un tyran reste un tyran quelle que soit la couleur de sa peau. [...]. Mais je continue à penser qu'il est préférable pour L'Africaine que je suis d'être jugée et fusillée cent fois dans un pays indépendant de l'Afrique par des autorités africaines reconnues par leur peuple que de l'être une fois par nos chefs racistes blancs d'Afrique du Sud. (p.83)
Ayant perdu tout sens de direction, se sentant comme "une statue sans socle" (p.85), Tembi quitte alors la Guinée avec l'espoir de se forger de nouvelles racines.
Le roman de Véronique Tadjo intitulé Le royaume aveugle, met aussi en scène une jeune femme qui décide de ne pas plier face aux exigences meurtrières du régime. Sa décision de lutter contre l'autorité est d'autant plus courageuse et dramatique que la jeune femme est la fille du dictateur en place. Mais pour elle, "...il n'y a pas trente six solutions : ou le royaume se régénère ou il brûle!"(p.85) et c'est en ces termes qu'elle prend congé de l'autorité paternelle:
- Ecoute, c'est simple. Les temps sont mauvais. Je n'ai plus la foi. Si nous ne voulons pas construire la guerre, il nous faut bâtir la paix. Ça au moins je le sais. Rien d'autre ne compte. Il faut changer.
J'ai soif d'une vie où dormir à poings fermés n'est pas un signe de faiblesse. Une vie en majuscule, propre et sans rature.
Père! Père! Pendant trop longtemps tu as régné avec fureur, Tu as façonné le royaume comme il te semblait bon. Tu as parlé au nom de tous et les voix se sont tues pour que chacun puisse t'écouter.
Aujourd'hui, c'est à toi de garder le silence et de t'asseoir dans un coin de l'histoire. Ecoute, c'est important: je m'en vais!.(pp.38-39).
Et comme si les romancières semblaient vouloir souligner que c'est bien souvent aux filles qu'il appartient de faire changer le monde, on retrouve un personnage similaire à celui d'Akissi dans le roman d'Aminata Sow Fall mentionné plus haut. Incapable de suivre son père sur le chemin de la compromission, elle lui exprime franchement sa manière de voir avant d'être tuée au cours de manifestations organisées contre le régime dictatorial en place.
Si le rôle de la femme dans la lutte contre les tyrannies est soulignée par les romancières, ces dernières ne nient en rien celui de leurs compagnons d'armes. L'histoire de Lem proposée par Werewere Linking dans L'amour-cent-vies et tous les autres textes mentionnés plus haut le montrent. Les romancières s'insurgent plutôt contre une tendance à vouloir les tenir à l'écart de l'action sous de faux prétextes au moment où, plus que jamais, elles sont appelées à participer, de gré ou de force.
Agitation, violence et invasions ne se limitent bien sûr pas à l'époque contemporaine. Un certain nombre de romancières nous le rappellent en situant l'action de leur roman à des époques plus éloignées. Tita Mandeleau situe son roman Signare Anna à l'époque où Français et Anglais se disputaient le port de Saint Louis du Sénégal afin d'assurer l'avenir de leurs juteux trafiques. Et c'est sur une toile de fond reflétant une situation politique aussi houleuse qu'incertaine que se déroule l'action:
-
le spectacle d'une authentique bataille navale entre Blancs surgis les uns et les autres, un beau matin, de la mer par on ne sait quel hasard, donnait aux jours à venir une saveur plus pimentée que les classiques escarmouches contre les tribus de la Rivière auxquelles les gens de l'île étaient habitués.(p.49)
Ségou, de Maryse Condé, se situe à la même époque, un temps où l'expansion de l'Islam et la Traite des Noirs mettaient à rude épreuve les communautés locales. Les deux volumes du roman de Condé retracent l'effondrement du Royaume de Ségou sous la pression des Toucouleurs convertis à l'Islam. Puissante communauté dont la prospérité était due en partie à ses succès militaires, Ségou finit par s'incliner devant ceux qui se prétendaient les nouveaux maîtres du monde, illustrant parfaitement les propos d'un des personnages principaux : " toute l'histoire de Ségou n'était-elle pas sanglante et violente"(p. 33).
Le fort maudit de Nafissatou Diallo raconte quant à lui l'invasion du fertile royaume de Cayor par le Boal au début du dix-neuvième siècle et montre aussi combien il était facile de basculer d'un état de paix à un état de guerre:
- une mère appelait son enfant. Un mendiant psalmodiant d'une voix nasillarde la miséricorde du Seigneur. Bruits familiers, témoins de la paix de tous les jours.
Soudain tout changea. La poussière s'éleva. Le village disparaissait sous un épais voile gris. Un instant, il sembla qu'une force redoutable tombait du ciel brusquement assombri. Un bruit d'enfer! Des galops de chevaux aussi puissants que ceux des cavaliers de l'Apocalypse. Des coups de fusil. Des cris. Des plaintes. Des hurlements. Délire. Panique. [...] Le massacre continuait. Un émissaire arriva du palais et donna ordre à Fallène de se rendre. Le Cayor venait de capituler devant le Baol, qui remportait la plus grande victoire de son histoire. (pp. 88-89 et 93).
L'histoire du Misora - un anagramme de Samory - proposée par Tanella Boni dans Les Baigneurs du Lac Rose souligne combien les exploits guerriers célébrés par la légende s'incrustent dans l'imaginaire populaire et glorifient l'exploit aux dépens de la souffrance et du sang versé par les victimes des grands conquérants. Ces derniers ont endeuillé l'Afrique au nom de la religion, parfois, pour élargir leurs terres ou tout simplement par esprit de lucre. Leurs noms sont devenus tristement célèbres alors que ceux de leurs victimes ont sombré dans l'anonymat. Il appartenait aux romancières africaines d'en faire resurgir quelques-unes du néant.
Les femmes africaines ont ouvert le monde des lettres à un certain nombre de problèmes qui leur tenaient à coeur mais leur apport ne s'arrête pas là. L'éclairage nouveau que leurs textes jettent sur les domaines que l'on croyait à tort ne les toucher que de très loin est tout aussi inestimable. Guerre et violence concernent les hommes comme les femmes et tout comme la bravoure, la souffrance n'appartient à personne. Les ouvrages mentionnés ci-dessus ne font que nous le rappeler.
Dr. Jean-Marie Volet est chargé de recherche à l'Université de Western Australia. Au nombre des ouvrages témoignant de son intérêt pour les littératures africaines, on relèvera La Parole aux Africaines Amsterdam: Rodopi, 1993, Les Romancières africaines d'expression française Paris: L'Harmattan, 1994 (co-auteur Beverley Ormerod) et A Bibliography of African Literatures Lanham: Scarecrow Press, 1996. (co-auteur Peter Limb).
Back to [the top of the page]
[the contents of this issue of MOTS PLURIELS]