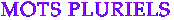
no 11. September 1999.
https://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP1199fu.html
© Françoise Ugochukwu
Françoise Ugochukwu
University of Central Lancashire
Que l'on analyse Omenuko, la biographie romancée d'un grand commerçant publiée par Pita Nwana en 1933, Le Monde s'effondre de Chinua Achebe dont l'action se situe à la fin du siècle dernier, ou encore le roman igbo contemporain, on ne manquera pas de relever que tous ces livres nous parlent en termes éloquents des hommes et des femmes avec lesquels le lecteur prend la route alors que les paysages où ils se meuvent, eux, sont laissés dans l'ombre. [1]
Le monde d'Omenuko se confond avec l'univers traditionnel igbo, divisé en deux : le village et la brousse. Les hommes vivent au village, et la brousse, espace inculte qui sépare les villages, est un désert - une zone inhabitée - souvent perçu comme hostile. La description du lieu-dit de la Brousse Froide où Omenuko se trouve forcé d'aller vivre, rejoint celle de Le Monde s'effondre d'Achebe, dont l'action se situe aux environs de 1890 et qui a été influencé par Omenuko :
- Si on lui avait donné ce nom, c'est qu'on y enterrait les
hydropiques, ceux morts d'hydrocèle, les varioleux et les femmes mortes
grosses. [Omenuko]"[2]
Chaque clan et chaque village avait sa forêt maudite. Là étaient enterrés tous ceux qui mouraient de maladie réellement mauvaise comme la lèpre ou la petite vérole C'était aussi le dépotoir des puissants fétiches des grands hommes-médecine quand ils mouraient [Le Monde s'effondre]."[3]
Le seul personnage qui semble, dans Le Monde s'effondre, apprécier vraiment la beauté de la nature, c'est Unoka, le père du héros : il "aimait cette saison de l'année où les pluies ont cessé", la "resplendissante beauté" du soleil levant, l'épais brouillard d'harmattan, les vieux et les enfants se réchauffant "autour des feux de bûches.(...) Unoka aimait tout cela, et il aimait les premiers milans qui revenaient avec la saison sèche, et les enfants qui leur chantaient des chants de bienvenue."[4] Mais Unoka est un "raté" dont le manque d'ambition et la paresse sont la risée du village. Dans les deux romans, témoins d'une culture dont la philosophie est inscrite dans les noms : aku bu ndu* - "la richesse c'est la vie", adage tempéré par nwa ka ego - "l'enfant a plus de valeur que l'argent", les relations humaines tiennent une place essentielle, l'apparence des personnages important d'ailleurs moins que leurs actes, puisque c'est à leur comportement que la société les juge.
Le paysage est donc limité à ce qui porte la marque de l'homme : la concession, la maison, la disposition des cases à l'intérieur des murs ayant toujours une signification. C'est ainsi que l'auteur d'Omenuko décrit les maisons de la Brousse Froide avec un luxe de détails inhabituel :
- Voilà comment ils avaient construit leurs maisons. Elles
étaient entourées d'un vaste mur carré, et tous les
administrés d'Okonkwo vivaient à l'intérieur (...). Voyez
la belle couleur verte des murs qu'ils ont construits pour protéger la
ville et chaque cour! Voyez la belle couleur jaune de leurs maisons, et les
portes des cours peintes en noir! Regardez bien maintenant entre le vert et le
jaune : vous allez voir du blanc; ce sont les chemins des concessions
d'Omenuko et de ses frères.[5]
Cette description, qui a pour but de mettre en valeur les qualités de travailleur et le goût du héros, ignore l'intérieur des cases - les pièces, d'ordinaire sommairement aménagées, ne servent que la nuit, puisque la famille passe le plus clair de ses journées dehors entre la véranda, la cour et la cuisine ouverte - mais met en valeur la partie qui se voit, la façade annonçant la position sociale de ses occupants. La beauté, la solidité de l'architecture proclament également la victoire de l'effort humain sur la nature sauvage, asociale, domaine de l'interdit, antique sentier de guerre, terrain hanté où les rebelles entrent en contact avec les Esprits malveillants, forêt maudite, désert, lacs cannibales des contes[6]. Dans le roman d'Achebe, Ekwefi, femme du héros, dont la prêtresse vient d'emmener la fille unique, suit celle-ci en pleine nuit
- sur le sentier sablonneux bordé de chaque côté de
branches et de feuilles humides. Elle se mit à courir.(...) Son pied
gauche heurta une racine à l'air libre et la terreur la prit.
C'était un mauvais présage.(...). Il n'y avait pas
d'étoiles au ciel à cause d'un nuage de pluie. Des lucioles
voletaient de-ci de-là avec leurs minuscules lampes vertes, ce qui ne
faisait que rendre l'obscurité plus profonde.[7]
Dans Le Monde s'effondre, la nature est toujours associée au mal, au danger, à de sinistres pressentiments, et l'effroi naît à son contact. Dans ses étroits sentiers, on marche seul ou en file indienne, plus que jamais conscient de la protection qu'apporte le groupe. La littérature comme les chroniques le disent, c'est là qu'on abandonnait les jumeaux et les enfants dont la naissance était considérée comme anormale. C'est là que les marchands d'esclaves guettaient leur proie. C'est là encore, au coeur de la forêt, que le jeune Ikemefuna va être sacrifié à la demande expresse de l'oracle, au moment où il se laissait pénétrer par la majesté du lieu :
- les arbres courts et le sous-bois clairsemé qui entouraient le village
des hommes commençaient à faire place à des arbres
géants et à d'immenses plantes grimpantes qui peut-être
étaient là depuis le début du monde, vierges de coups de
hache et de feux de brousse. Le soleil en se frayant un passage à
travers leurs feuilles et leurs branches dessinait une mosaïque de
lumière et d'ombre sur le sentier sablonneux."[8]
- et le fait même que le garçonnet entre comme en symbiose avec le paysage est signe qu'il n'était pas fait pour vivre avec les hommes.
En fait, plutôt que de nature, c'est de forces de la nature qu'il faudrait parler : premières pluies, soudaines et formidables, claquements du tonnerre ou bourrasques. La langue igbo elle-même dit la violence de la confrontation de l'homme et des éléments. Au début d'Omenuko, décrivant l'accident survenu au groupe au moment de la traversée du cours d'eau, Pita Nwana écrit : o dighi onye o bula miri riri*[9], "personne ne s'est noyé" - littéralement "l'eau n'a mangé personne". Dans la pensée traditionnelle, l'eau, le sol, le tonnerre, les éléments du paysage, sont révérés comme l'habitat de divinités du même nom, et reçoivent un culte [10] empreint d'une crainte entretenue par la rigueur des châtiments encourus par les rebelles - car les alusi* sont aussi impitoyables que les Erinnyes grecques. Le philosophe igbo Nwala l'explique, "le plus grand ennemi de l'homme traditionnel, ce sont les forces de la nature, et il a besoin de la solidarité collective pour leur résister."[11]
Le sacrifice animal, dont le sang répandu est offert à la Terre en expiation de la faute commise ou de l'infraction du tabou, est destiné à apaiser une nature que l'on sait dotée d'une personnalité hostile et impitoyable, et scelle la réconciliation de l'homme et de son environnement. C'est sans doute pourquoi, outre le fait qu'il sert de charnière à la seconde partie du roman, le repas de communion fraternelle restaurant Omenuko au sein de la communauté villageoise et dans sa relation aux ancêtres du clan est longuement décrit, avec la précision d'une recette de cuisine :
- Ils prirent ensuite le coq blanc, le tuèrent,
décapitèrent le boeuf, jetèrent la tête de boeuf et
le coq dans une marmite et les mirent à cuire - la part de nos anciens.
Ils prirent encore quatre oeufs, qu'ils mirent dans la marmite, puis les huit
grosses ignames qu'ils pelèrent et coupèrent en petits morceaux
avant de les ajouter au reste. Quand la tête de boeuf fut cuite à
point, ils sortirent la marmite du feu et vidèrent le contenu dans un
plat en bois. [12]
La nature n'a de valeur utile que domestiquée, l'animal utilisé ou sacrifié, la forêt défrichée et le terrain ensemencé, l'épouse fécondée - ainsi le veut la coutume. Et l'art traditionnel reflète cette pensée : "hautement fonctionnel", il "renforçait les liens avec les forces dont dépendaient, pensaient-ils, leur survie, leur bien-être et leur progrès."[13]
Dans Omenuko, par exemple, la rivière rencontrée par les commerçants est perçue dans ses seuls rapports utilitaires avec eux.
- Elle était en crue : le niveau de l'eau était
monté, du fait de la grosse pluie de la veille. Il y avait
là un tronc d'arbre qui servait de pont.[14]
La description est neutre, schématique, et ne révèle que les détails indispensables à la compréhension du récit. Le lit de la rivière est, nous dit-on, "boueux, herbeux et pierreux et le courant rapide" - il s'agit de bien nous faire comprendre que "tout ce qui tombait à l'eau (...) était perdu, on ne le récupérait pas."[15] Ce n'est que rarement, et comme en passant, que des détails nous sont donnés, toujours dans un but utilitaire : le chaume recouvre les toits et le haut des murettes - il doit donc être changé régulièrement.
Entre Omenuko et Le Monde s'effondre, la perception du monde a évolué, mais globalement et en dépit des changements socio-économiques et des influences de tous ordres, la relation de l'igbo à son environnement reste régie par les mêmes lois. The naked gods, roman d'un autre auteur igbo, Chukwuemeka Ike, publié en 1970[16] et qui fait pénêtrer ses lecteurs dans l'univers clos et mesquin d'une jeune université d'après l'indépendance, est bâti sur le même modèle : l'essentiel du récit est consacré aux dialogues, débats et incessantes réunions d'intellectuels et à la toute-puissance du verbe, dans un paysage réduit à de rares aperçus de coins de jardins aux pelouses ornées de bougainvilliers ou plantées de vagues manguiers, anacardiers, cocotiers et pamplemoussiers réduit à la seule mention de leur nom. Seule évidence de modernité : à la description des huttes du sorcier Ebenebe viennent s'ajouter celle des moëllons empilés dans sa cour, "évidence visible de la richesse qu'il amassait"[17] et une visite détaillée de la résidence du recteur de l'université qui s'enorgueillit d'un
-
vaste bureau et six chambres. Chaque chambre avait salle de bains et WC
attenant. Au rez-de-chaussée se trouvaient un vaste living, un salon
privé et une salle de banquet, ainsi que le bureau et deux chambres
destinées aux invités personnels du recteur.(...) Tout le
mobilier du salon avait été importé. [18]
Si Pita Nwana n'a pas publié d'autre roman après Omenuko, la littérature igbo a continué à se développer dans l'ombre. Tony Ubesie, mort il y a quelques années, est l'un de ses auteurs les plus appréciés en raison de sa remarquable maîtrise de la langue et de son usage fréquent des proverbes, très prisés pour leur valeur philosophique et la maturité qu'ils supposent. L'un de ses romans les plus lus, Juo Obinna*, publié dans les années qui ont suivi la guerre du Biafra et qui s'en inspire, présente la même interaction entre l'homme et la nature, et des flashs d'images montées en proverbes :
-
L'éclair zèbre le ciel, le tonnerre gronde, les gens commencent
à rentrer leurs affaires dans la maison, se disant que la pluie
s'annonce et qu'il ne faut pas se laisser tremper si près de chez soi.
Pendant ce temps-là, un vent violent secoue l'iroko à le
déraciner. Mais alors que tout le monde s'attendait à voir tomber
la pluie, le ciel s'éclaircit."[19]
De roman en roman, la littérature igbo, aujourd'hui partie intégrante de la riche littérature nigériane, confirme la place centrale de l'homme, au sein du groupe et inséparable de lui, en lutte permanente avec une nature hostile qui s'obstine à défendre ses secrets, les routes défoncées où s'embourbent les véhicules protégeant désormais l'approche des sentiers et enfermant le citadin dans de nouvelles forteresses.
Notes
[1]. P.Nwana. Omenuko. London 1933.
(Premier roman igbo).
C.Achebe. Le Monde s'effondre. Paris:
Présence africaine, 1972 (Things fall apart. London:
Heinemann, 1958)
Reprinted Lagos: Longmans of Nigeria, 1963.
[2]. P.Nwana. traduction, p.16
[3]. Achebe, p.179
[4]. Ibid., p.11
[5]. Nwana. trad., p.39
[6]. Cf. F.Ugochukwu. Contes igbo, de la brousse à la rivière. Paris: Karthala, 1992
[7]. Achebe, pp.126-7
[8]. Ibid., p.75
[9] Nwana, p.3
[10]. Cf.M.A.Onwujeogwu. An Igbo Civilization - Nri Kingdom and Hegemony. London/Benin-City: Ethnographica/Ethiope, 1981
[11]. T.U.Nwala. Igbo Philosophy. Lagos: Lantern Books, 1985 p.223
[12]. Achebe, p.35
[13]. Nwala, p.212
[14]. P.Nwana. Histoire de la vie d'Omenuko. Traduction française de F.Ugochukwu. Inédit, p.3
[15]. Ibid.
[16]. C.Ike. The Naked Gods. London: Fontana Books, 1971 (Harvill Press 1970)
[17]. Ike, p.51 (ma traduction)
[18]. Ibid., p.80
[19]. T.Ubesie. Juo Obinna*. Ibadan: Oxford University Press, 1977, p.2 (ma traduction)
Back to [the top of the page]
[the contents of this issue of MOTS PLURIELS]
Dr Françoise Ugochukwu, M.I.L., Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques. Après avoir passé vingt-quatre ans au Nigéria où elle a enseigné à l'Université [University of Nigeria, Nsukka, Enugu State, Nigeria], Françoise Parent-Ugochukwu se trouve depuis 1997 à l'University of Central Lancashire (UK). Elle a publié neuf ouvrages et est une spéciliste de la littérature igbo. Elle a traduit de nombreux contes, nouvelles et poèmes igbos en français. Pour plus de renseignements, prière de consulter la page de Madame Ugochukwu sur le site "Lire les femmes écrivains et les littératures africaines".