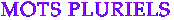
no 16 - December 2000.
https://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP16OOmb.html
© Marlène M. Biton
CNRS/ Paris-I-Pantheon-Sorbonne
| CETTE PAGE CONTIENT DES ILLUSTRATIONS. IL EST POSSIBLE QUE LEUR AFFICHAGE PRENNE QUELQUES MINUTES. SI VOUS ETES PRESSE, PRIERE D'OUVRIR LA VERSION SANS IMAGE |
| Contrairement aux idées reçues, l’Afrique n’est pas un continent hors du temps replié sur lui-même. L’exemple choisi ici évalue les influences européennes exercées sur la société royale du Dahomey. Il souligne la manière dont les bas-reliefs ornant les bâtiments des rois et des reines-mères du Dahomey relevés par un officier français en 1893 rendent compte de cette interpénétration. On remarque dans ces oeuvres aujourd’hui presque toutes disparues, des influences que certains dirent brésiliennes ou égyptiennes, mais qui sont vraisemblablement venues d’Europe par l’intermédiaire des traitants portugais, hollandais, anglais, français, par les commerçants Haoussa et Yorouba et aussi arabes. Ces influences se situent essentiellement au niveau du vocabulaire iconographique et sont mêlées si intimement à cette forme d’expression qu’elles en sont constitutives. |
| Les notions d’emprunts et d’influences sont des notions complexes et difficiles à manipuler. A l’évidence aucune société ou culture ne s’est développée sur une longue durée sans échanges. Cependant, dans la mesure où l’on restreint l’espace temporel, il peut sembler facile de déterminer ce qui apparaît comme des emprunts, en particulier dans le domaine des artefacts ou des objets matériels.
Dans ce cas, il est nécessaire de présiser les propriétés de l’emprunt. Dans quelle mesure est-il assimilé et intégré par la culture emprunteuse? Dans quelle mesure celle-ci se le réapproprie-t-elle en le transformant et/ou en le modifiant? Nous proposons quatre types d’emprunts du domaine de la culture matérielle:
- L’objet d’importation utilisé tel quel sans autre assimilation que le savoir-faire lié à son utilisation.
Ce dernier type d’influence peut être difficile à différencier du précédent car il opère à un niveau de généricité plus grande au sens où l’emprunt porte plus sur l’aspect abstrait de la fonction que sur la réalisation matérielle qui en permet l’exercice. Il est évident que les frontières de ces catégories précisées uniquement pour les besoins de l’analyse sont mouvantes (en particulier les deux dernières, à la fois les plus importantes et les plus difficiles à évaluer) si on les envisage dans une perspective temporelle. La présence de ces diverses manières d’emprunter ou de subir des influences atteste seulement - à partir du moment où la possibilité d’un échange et d’une confrontation existe - de la capacité d’une société à innover et à évoluer en empruntant et en s’inspirant de ce qu’elle juge utile. Il nous a semblé particulièrement intéressant d’évaluer les problèmes posés par la notion d'emprunt et d’apporter quelques éléments de réponse à ce sujet en utilisant un lieu d’observation privilégié: la société et le royaume du Dahomey dont l'histoire et la périodisation sont assez bien connues. Ce royaume qui dura un peu moins de 300 ans et dont l’histoire agitée fut liée à la guerre, fut porté à se saisir de tout ce qui était susceptible d'améliorer entre autre son potentiel et sa technologie militaires. Les relevés effectués par un officier français lors de la conquête offrent un instantané et un dispositif de représentations significatives de ce royaume par lui-même. Parallèlement aux opérations militaires et à la conquête du Dahomey par les troupes coloniales françaises (1890-94) que dirigeait le colonel Dodds, ce dernier fit procéder à des recherches d’ordre historique auprès des populations africaines vaincues. Son but était peut-être de satisfaire sa propre curiosité (n’oublions pas qu'il était né au Sénégal), mais son but était plus vraisemblablement lié à son désir de mieux asseoir le nouveau pouvoir et l’administration qu’il mettait en place au fur et à mesure de l’avancée militaire et de la conquête sur le terrain. Pour procéder à ces études, le colonel Dodds choisit un certain nombre d’officiers et de sous-officiers de son Etat-major. Les dons de certains avaient pu être appréciés alors qu’ils étaient auprès de lui sur un autre champ de bataille, l’Indochine. Le lieutenant Victor Maire possédait un sens aigu de l’observation et un bon coup de crayon ce qui lui valut d'être chargé d'une mission précise et relativement originale: se consacrer au relevé systématique des bâtiments et des bas-reliefs des palais d'Abomey ainsi qu'à la notation de l’histoire du royaume à partir de la tradition orale recueillie sur place. Maire laissera derrière lui un travail qui représente une véritable mine de renseignements iconographiques pour toute personne qui s’intéresse à ce royaume africain[2]. De plus, les documents qu’il publie ont cet avantage particulier d’être datés précisément et de donner ainsi un instantané iconographique de ce royaume à un moment précis. En effet, nous savons que Maire est présent au Dahomey entre août 1893 et août 1894[3].
Le travail de Maire sera édité en 1903, mais l’indication "décembre 1893" portée en couverture fait sans doute référence à la date des relevés. Ces derniers présentent des plans et 165 bas-reliefs ornant les murs de quatre palais royaux de la capitale du roi Gbéhanzin, d’un trait fragile et naïf quoique précis et prenant en considération de nombreux détails. De retour en France, l’amour de la perfection le pousse à faire reprendre ses croquis par un professionnel[4]. Bien qu’édité en 1903, le travail de Maire fut certainement prêt bien plus tôt, tout au moins en ce qui concerne l’iconographie : A. L. d'Albéca[5], publiera en 1894, quarante-neuf bas-reliefs dont vingt-neuf sont "empruntés" à Victor Maire et une vingtaine, au travail d’un second militaire Eugène Fonssagrives[6]. Il est primordial que le travail de Maire soit daté (1893) et que la période de ses relevés soit contemporaine de la chute d’Abomey (nov. 1892) car ces éléments garantissent que les oeuvres relevées sont très proches de celles que l’on pouvait trouver dans cette ville pendant le brillant règne du roi Glélé (1858-1889). En effet, l’ensemble des bas-reliefs n’a guère dû ou pu changer entre son règne et celui de son fils, Gbéhanzin. Ce dernier n’a d'ailleurs guère gouverné, Glélé décédant fin décembre 1889 et Gbéhanzin se rendant aux autorités françaises en 1894[7]. En fait, pendant son règne, Gbéhanzin n'a connu que la guerre et on peut supposer que les conditions de cette courte et sombre période n’ont pas été propices à la création de nombreux bas-reliefs. Il est possible de dégager une multitude d’informations en se fondant sur les relevés de Maire mais nous nous bornerons ici à mettre en lumière les objets qui, dans cette forme d’expression artistique, attestent des influences d’origine européenne ainsi que de l’éventuelle datation de ces emprunts. Ces objets peuvent avoir été utilisés tels quels ou bien réaménagés localement afin de mieux correspondre à divers besoins aussi bien d’ordre technologique que d’ordre spirituel ou politique. En tout état de cause, leur intégration dans l’iconographie des bas-reliefs, exprime les préoccupations du pouvoir royal et atteste de leur importance et de leur assimilation par la société dahoméenne.
Maire présente son travail de manière chronologique. Il avoue s’appuyer, en ce qui concerne l’histoire du Dahomey, sur les travaux de son collègue Eugène Fonssagrives et sur ceux du Père Bouche des Missions africaines de Lyon[8].
Quatre unités sont proposées :
"Hodjia", (unité privée du roi Kpengla;1775-1789), "Bécon-Houli", (bâtiments privés du roi Gézo; 1818-1858), et "Nahonghi"[9], (unité de la mère de Glélé; 1858-1889). Pour mieux appréhender les bas-reliefs, Maire avait par ailleurs déjà créé deux catégories distinctes[10] : celle des "bas-reliefs figuratifs" et celle des "bas-reliefs géométriques ou abstraits". Les bas-reliefs publiés dans l’ouvrage de Maire peuvent être répartis ainsi:
Seuls les 113 bas-reliefs "figuratifs" de Maire seront pris en compte dans le cadre de ce travail. Nous examinerons dans un premier temps les éléments qui composent les bas-reliefs, puis nous établirons un inventaire présentant le nombre et la variété des éléments d’origine étrangère; leur nature donnera quelque indication sur la place que le Dahomey leur réservait.
Il serait fastidieux d'ennumérer ici tous les éléments qui composent les 113 "bas-reliefs figuratifs" de Victor Maire. Il est suffisant de savoir que nous en avons relevé 383. En revanche, il est intéressant de noter que 42 bas-reliefs présentent des éléments étrangers (soit 37 % de l’ensemble) et qu’ils sont composés de 168 éléments dont 52 étrangers (soit près de 31 %). Le tableau suivant présente l’ensemble des bas-reliefs figuratifs comportant un ou plusieurs éléments étrangers ainsi que le décompte des éléments et la description sommaire de ces derniers.
Les éléments étrangers regroupés par nature donnent:
En opérant un regroupement entre les différents types d’armes individuelles (blanches ou à feu) on obtient:
Il apparaît clairement que les armes forment l’essentiel des éléments étrangers rencontrés ici, à quoi s’ajoutent des objets tels que: drapeaux, villes, échelles et navires. On peut ainsi systématiser cette liste sous cette forme.
A) LES ARMES Les armes sont les éléments étrangers les plus nombreux: fusils, coutelas, sabres, faux et canons (plus de 80 % de l’ensemble) dont une majorité d’armes à feu. LES FUSILS: Les fusils font partie de la vie des Fon depuis longtemps mais ils sont encore considérés comme des armes étrangères qu’il est utile, voire indispensable de posséder. La tradition orale les évoque très tôt dans l’histoire du royaume. Elles sont par exemple liées à la chute des villes d’Allada puis de Ouidah : Allada avait la chance d’être placée géographiquement entre Abomey et la mer et elle contrôlait le commerce avec les Blancs grâce à la ville de Djekin, sa vassale. Abomey s'étant vu refuser une demande de paiement pour obtenir le libre trafic avec les Européens, son armée profita de la mort du roi d'Allada et d’un désaccord entre deux prétendants en 1724 pour passer à l’attaque. La seconde manoeuvre consista à conquérir le petit royaume de Savi et la ville d'Ouidah qui était son ouverture sur la mer. Une des raisons de cette annexion est directement liée aux armes à feu: Abomey aurait commandé des fusils par l’intermédiaire de Savi et celle-ci - craignant à juste titre sa voisine - aurait subtilisé les chiens de fusils, rendant les armes inutilisables. Sur quoi, l’armée du roi Agadja (1708-1740) prit ces deux villes en 1727, supprimant du même coup les intermédiaires et devenant l'interlocuteur direct des blancs qui leur fournissaient les armes dont ils avaient besoin pour assurer la survie et l’expansion du Dahomey. Les Fon multipliaient leurs sources d’approvisionnement[11] et Maire indique la variété des fusils qui faisaient partie de l’armement de l’armée aboméenne à la fin du XIXe siècle, on trouve des Snider, Winchester, Chassepot, Tabatière, Spencer, Werndll, Peabody, Mannlicher, Martini. Certains auteurs affirment que les fusils étaient quelquefois retravaillés, en particulier, retrempés - peut-être pour les rendre plus sûrs, car il semble que les fusils d’exportation n’étaient pas de très bonne qualité ou peut-être encore pour les rendre plus beaux ou plus grands ? La crosse pouvait être ornée ou sculptée de motifs ressortant de domaines divers. Ici, l’objet d’importation représenté est utilisé tel quel sans autre assimilation que le savoir-faire lié à son utilisation. LES COUTELAS, LES SABRES Ces armes existaient de manière traditionnelle au Dahomey, mais le royaume était peu riche en ressources métallifères et le fer qui provenait d’échanges avec les populations voisines fut remplacé progressivement par celui obtenu en grande quantité par le trafic côtier avec les Européens. Ces armes comportent généralement des parties non-retouchées et des parties retouchées: la poignée est souvent d’origine, on y reconnaît la marque de régiments militaires occidentaux, tandis que la lame est souvent retravaillée sur place afin de lui donner l’aspect et la forme, courbe, large, dentelée, etc... correspondant aux besoins de leurs nouveaux possesseurs. Pour Maire, ces armes étaient portées par les aides des soldats de métier. Ces conscrits au service du roi en temps de guerre servaient principalement de porteurs de charges pour les guerriers.[12]. LES RASOIRS Ces grands rasoirs qui peuvent de loin faire penser aux faux utilisées par les agriculteurs européens ont été décrits par Maire comme étant des armes spécifiques aux régiments féminins, "Les Cloucloucaccala"[13]. Le Père Bouche citant le Père Borghéro présent en 1861 à une revue militaire à Abomey, décrit ainsi ces régiments que les Européens nomment "amazones" en référence à la Grèce antique : "Sur trois mille femmes, deux cents, au lieu de fusils, sont munies de grands coutelas en forme de rasoirs, qui se manient à deux mains, et dont un seul coup tranche un homme par le milieu". Borghéro précise même qu’il s’agit d’un: "énorme couteau en forme de rasoir qui peut s’ouvrir et se fermer; le manche a presque un mètre de long et la lame autant"[14]. Pour d’autres auteurs, des régiments masculins portent aussi le rasoir. Maire décrit par exemple des régiments d’hommes créés par le roi Glélé dont le nom, Niegpley, voudrait dire "(compagnie) forte par le rasoir"[15]. Les armes blanches sont retravaillées, que ce soient les sabres ou les rasoirs. Les forgerons fon - très appréciés - adaptent les pièces aux besoins et aux goûts de "leur clientèle ": Ils modifient les lames et poignées fournies par les traitants ou seulement les lames, lorsque le métal provient de ventes ou d’échanges de barres brutes. Ici l’objet importé peut être matériellement modifié. L’assimilation du savoir-faire d’utilisation se double d’un savoir-faire local de transformation.
LES CANONS: Les canons sont connus à Abomey depuis longtemps, ils furent même la raison officielle donnée pour l’attaque contre la ville de Gbadagry en 1784, sous le règne du roi Kpengla (1774-1789). Gbadagry avait acheté quatre années plus tôt deux magnifiques canons hollandais[16] que Kpengla avait voulu s’offrir mais auxquels il avait du renoncer en raison du prix jugé excessif que le capitaine en demandait : 300 esclaves. Sur l’invitation de l’Alafin (roi) d’Oyo et avec l’aide de Lagos et de Porto-Novo, Abomey attaqua Gbadagry qui suscitait des jalousies, fit des prisonniers et surtout récupéra les deux canons qu’elle ramena chez elle[17]. Mais la tradition parle de canons bien avant cet épisode. En effet lors de la prise de Ouidah, en 1727, les Houeda[18] ne purent se défendre contre les fon d’Abomey en utilisant leurs célèbres canons situés sur les remparts car une femme du roi Houffon, la princesse Na-Guézé d’Abomey, avait mouillé la poudre avec ses suivantes. Déjà en 1724, on pouvait dénombrer vingt-cinq canons dans les cours du palais d'Abomey, [19]. Abomey avait une notion très claire de la valeur stratégique des armes à feu (fusils et canons) et elle en faisait usage pour attaquer les villes et les royaumes voisins. Ces armes firent la différence entre Abomey et ses ennemis, lui permettant de s'affirmer dans la région et de devenir un royaume puissant entre l’Achanti et l’Oyo, jusqu’au jour où elle trouva en face d'elle une autre nation mieux équipée technologiquement. Ces armes lourdes étaient utilisés sans transformation. B) LES AUTRES ELEMENTS Ces éléments consistent en une petite liste d'éléments hétéroclites. Echelles, villes, drapeaux, crucifixion et navires - représentent ensemble moins de 20 % d’éléments étrangers. Toutefois, les échelles, les villes et les drapeaux pourraient être regroupés car ces trois éléments se retrouvent au Dahomey dans un même cadre guerrier.
LES ÉCHELLES: Les échelles sont nettement de type européen : deux montants parallèles dans lesquels s’insèrent perpendiculairement des barreaux permettant l’ascension. Il ne s’agit pas de soutenir qu’il n’y avait pas d’échelles au Dahomey, mais si il y eut des échelles traditionnelles à Abomey, elles ressemblaient certainement à celles que l’on trouve dans le nord-Bénin, en particulier dans la région de l’Atakora[20]. Les travaux de A.-M. Maurice en représentent quelques-unes, elles sont relativement proches des célèbres échelles dogon où un tronc d’arbre est creusé à distance régulière créant ainsi des marches. A quoi pouvaient servir ces échelles de type européen? On peut se poser quelques questions à ce sujet. En effet, les maisons traditionnelles sont de plain-pied; les maisons à étages réservées aux rois étaient vraisemblablement inspirées des maisons européennes de la côte ou de brésiliens revenus en Afrique. Dans les bas-reliefs, les échelles sont liées à des batailles. On peut supposer qu’elles devaient, comme ce fut le cas en Occident, aider à surmonter les enceintes qui ceignent les villes ou les palais. De nombreux voyageurs visitant Abomey ou les villes de la région - en particulier celles de l’aire yorouba - parlent d’enceintes devant lesquelles se trouvent un fossé. Il peut être rempli ou remplacé par des épineux. Pour prendre une ville, il fallait donc franchir de hautes défenses. Dans les bas-reliefs les échelles sont donc la représentation d’un moyen simple pour conquérir un village ou une ville et peuvent être soit comprises au sens figuré, soit comme moyen de surmonter les obstacles.
LES VILLES: Avec la ville, nous trouvons un autre élément intéressant. Bien sûr, la ville n’est ni étrangère au Dahomey ni à cette région, aussi bien du côté Adja que Yorouba. On sait pertinemment que les royaumes du golfe du Bénin se sont constitués souvent à partir de villes et de proches campagnes. Ce qui est un élément étranger ici, ce n’est pas la ville mais sa représentation. Elle tient dans un cercle qui se veut parfait, avec quelques éléments rabattus, tantôt à l’extérieur, tantôt à l’intérieur. S'agit-il de maisons, de corps de garde inscrits dans le rempart ? Au moins depuis le XIVe siècle, on trouve en Occident des représentations géographiques qui tiennent dans des cercles; on en trouve également dans des "atlas islamiques" depuis les Xe ou XIe siècles[21]. Tout au long du XVIIIe siècle, des gravures occidentales utilisent encore ce procédé, ou celui du rectangle avec éléments rabattus, comme dans celle du fort portugais de Ouidah[22]. Les artistes d’Abomey étaient loin d’être coupés du monde. Ils avaient de nombreuses occasions de voir des ouvrages, des cartes et des plans. La présence d’étrangers à la cour d’Abomey est attestée au XVIIIe s mais elle remonte au début du royaume: diplomates ou traitants européens s'arrêtant là quelques semaines ou quelques mois pour les fêtes; prisonniers ou otages retenus pendant des années, etc. On y trouve également des malé ou mallays, marchands haoussaislamisés installés pour plusieurs saisons à Abomey[23]. Ces derniers pratiquaient le commerce et/ou la divination, possédaient des ouvrages et connaissaient la lecture, si ce n’est l’écriture[24]. Des livres étaient regardés, offerts, les gravures pouvaient inspirer les artistes créateurs de bas-reliefs. Ce qui est intéressant et mérite d’être noté est le fait qu’il y a ici intégration d'une figuration étrangère à une forme d’expression plastique locale sans modification et sans que cela semble poser problème. Il faut noter également qu'il s'agit là, à notre connaissance, des seules représentations de villes - ou d’univers géographiques - dans l’art traditionnel d’Afrique sub-saharienne.
LES DRAPEAUX: Les drapeaux permettent de signaler les régiments vainqueurs qui portent haut les valeurs guerrières du Dahomey et que l’on veut mettre à l’honneur. Même les Français reconnaissent le courage des guerriers fon pendant la guerre de conquête. Ils écrivent que ces derniers se précipitent au-devant des troupes coloniales comme si leur corps était à l’épreuve des balles ou de la mitraille. Les drapeaux se retrouvent assez souvent dans les bas-reliefs, en particulier sur l’ajalala du roi Gézo, son bâtiment de réception. Les visiteurs du XIXe siècle signalent que les drapeaux font systématiquement partie du décor des cérémonies officielles. La plupart des drapeaux de cette époque sont d’ailleurs confectionnés à base de tissus européens, redessinés, coupés et recousus afin de créer un art tout-à-fait original qui a d’ailleurs survécu jusqu'à aujourd'hui et continue à avoir un grand succès auprès du public. On les appelle des "appliqués". Maire passant en revue les différents régiments du Dahomey note la permanence des drapeaux: "Les drapeaux étaient de toutes sortes, représentant des fétiches, ordinairement faits d ’applications d’étoffes voyantes sur fond blanc"[25]. L’objet importé, le tissu va être modifié retravaillé, découpé, rassemblé et l'on pourrait imaginer une sorte de parenté avec un art ou un usage local. Ne serait-il pas possible d’imaginer par exemple un lien avec l’art de la tenture ? (l’appliqué). En effet, la tradition orale enseigne que les espions du Dahomey, les agbajibéto, souvent des Maxi[26] inscrivaient sur l’écorce des arbres puis sur des tissus les informations relevées pendant leurs missions de repérage. Leurs messages, incompréhensibles à qui les auraient vus ou fait prisonniers, étaient traduits au roi à leur retour. Ces espions rendaient compte ainsi des populations rencontrées, de leur nombre, des forces militaires mais aussi de la topographie et des éléments de reconnaissance inscrits sur le terrain. Les drapeaux semblent représentatifs d’un type d’emprunt où à partir de l’observation d’une pratique, on va s’inspirer de son principe et utiliser ce qui dans sa propre culture assure à la fois en partie et au-delà le même type de fonction. Les Fon utilisaient les tissus pour représenter un certain type de messages; ils avaient d’autre part une pratique de l’héraldique. Le drapeau européen qui résume ces deux fonctions a du être adopté et adapté pour ces avantages. Nous sommes là dans le cas-limite situé entre la troisième et la quatrième catégorie où le savoir-faire d’utilisation s’enrichit d’un savoir-faire de transformation et où l’élément retenu porte aussi bien sur l’objet que sur le concept dépendant des technologies locales.
LA CRUCIFIXION Tout d’abord est-on ici face à une représentation d’élément étranger ? A notre avis, oui, bien qu’il ne s’agisse pas de la représentation d’un élément mais de la représentation d’un usage. Ce type de torture est rarissime dans la littérature concernant le Dahomey et semble avoir été utilisé à partir du travail effectué par des missionnaires, c’est-à-dire de la seconde moitié du XIXe s. Il s’agit d’une sorte de reviviscence de la torture romaine connue des Dahoméens par l’intermédiaire du nouveau testament. C'est le premier et seul cas attesté de crucifixion - à notre avis - dans la volumineuse littérature écrite concernant la région. Décrit par Euschart, négociant hollandais en visite à la cour d’Abomey en 1862[27] et illustré d’une gravure représentant cette scène macabre[28], il suggère que l'’homme qui connut cette terrible fin aurait été fait prisonnier lors d’une expédition punitive contre la ville d’Ichaga[29] qui aurait trahi Abomey en guerre contre Abéokuta, sa rivale[30]. Edouard Dunglas, historien et administrateur colonial, près d’un siècle plus tard, en précise les circonstances. Sur les demandes du Foreign office, les membres du clergé et les protégés anglais prisonniers ramenés d’Ichaga auraient obtenu leur élargissement[31]. Apprenant sa libération prochaine, un certain Moses Osoko "revêtit ses plus beaux habits, chaussa des souliers, pris son ombrelle..."[32] et se pavana ainsi dans Abomey. Le malheureux ne savait pas que souliers et ombrelles étaient des objets de prestige réservés aux seuls rois et personnes de haut rang au Dahomey. Cette atteinte directe et caractérisée à l’autorité royale devait être punie de mort. Il fallait apprendre la bienséance à Osoko et une variation fut apportée à la crucifixion classique;: un des bras du supplicié continuait à tenir l’ombrelle, rappelant la cause de sa perte. Pour conclure sur ce point, cette forme de torture est un élément étranger à l’univers des fon. En effet, ils ne l’ont pas intégré de manière systématique à leur inventaire pourtant riche de supplices - dont ils n’ont d'ailleurs pas l’apanage. Ils s’adaptent dans ce domaine aux circonstances. Nous dirons ici que l’emprunt porte sur le concept.
LE NAVIRE: Le navire se retrouve quelquefois dans les bas-reliefs, il est un élément essentiel représentant et symbolisant l’Etranger. Depuis plusieurs siècles, il est le moyen de transport utilisé par les Européens pour atteindre la côte et apporter des objets attendus et inattendus. A la fin du XIXe s., on trouve dans les bas-reliefs plusieurs représentations de navires dont les mâts, vergues, ancres, et les sabords sont relativement surdimensionnés. Un bas-relief aujourd’hui disparu du palais d’Agadja - dont le moulage fut relevé par E.-G. Waterlot en 1911[33] représente par exemple le pont d'un navire. Assis sur une chaise, un homme semble prendre le frais. Des traits caractéristiques trahissent son origine : un nez pointu, des cheveux longs retenus par un catogan, un vêtement à basque, des chaussures à talons. Souvent, il brandit un crucifix. Ce ne peut être qu’un Européen... Le navire est un élément essentiel. On l’aperçoit de loin, on remarque sa découpe lorsqu’il est à l'ancre dans la rade. Comme il ne peut accoster, le déchargement des hommes comme celui des marchandises se fait en barque. D’ailleurs, une des pommes de discorde entre les Français et les Dahoméens fut la construction d’une jetée métallique à Cotonou permettant le déchargement des navires sans souci du temps ou de leur tirant d’eau. Les rois du Dahomey Glélé et Gbéhanzin s’y opposèrent car une telle construction pouvait également être utilisée pour débarquer des troupes. Le temps leur donnera raison! On trouve également à partir du XXe s., des représentations de navires à vapeur, reconnaissables à leur grande cheminée. L’emprunt est ici sans conséquences d’ordre technologique.
Le travail de Maire offre un instantané de l’univers technologique et matériel des Fon dans un contexte particulier, mais nous ne pouvons pas savoir si ce travail était représentatif de l’iconologie des bas-reliefs, ni si cette iconologie était représentative de l’univers matériel. En ce qui concerne le travail de relevé, y a-t-il eu une sélection des bas-reliefs ou bien Maire a-t-il tout noté? N’a-t-il visité que les quatre unités mentionnées? A-t-il opéré un tri au niveau des bâtiments ? Malheureusement, il n’en dit mot. Il nous faut donc accepter de travailler sur les matériaux dont nous disposons sans certitude et tout en gardant à l’esprit ces questionnements. Les bas-reliefs furent un moyen privilégié d’expression d’un pouvoir soucieux de propagande et il n’est pas étonnant que la technologie militaire y tienne une place importante. De plus, on peut saisir dans ce secteur l’importance de l’emprunt et la facilité avec laquelle la société Fon a su assimiler et mettre à profit les échanges avec l'Europe. Les Fon connaissaient les étrangers depuis longtemps. On en trouve à la Cour dès le début du XVIIIe siècle. Les Fon connaissent également les productions étrangères, ils les apprécient et les intégrent à des degrés divers en fonction de leurs besoins et de leur mode de vie. Ils peuvent soit les assimiler quasi-totalement soit au contraire leur laisser leur caractère "d’étrangeté". Les divers objets relevés sont la plupart du temps subordonnés à la sphère de la guerre car le Dahomey est un état guerrier où les valeurs viriles et guerrières sont à l’honneur. Toutefois, les bas-reliefs donnent aussi l’impression que ces éléments sont là pour apporter leur concours à la sphère politique. Ils sont en quelque sorte subordonnés à la volonté royale de créer un "royaume toujours plus grand". Le Dahomey n’a pas été fermé à l’Etranger et à ses productions, il a simplement choisi ce qu’il jugeait utile, conscient de ses intérêts et de ses valeurs. |
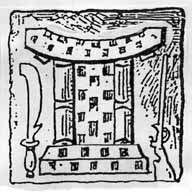 Fig. n°1. Planche VIII (33) LES FUSILS
Pour Maire, le trône représenté est celui du roi Kpengla (1744-1789). Il est entouré d'un fusil et d'un sabre dont la lame semble une création originale.
Maire écrit que ce canon rappelle l'introduction de l'artillerie au Dahomey. A notre avis, il s'agit de glorfier les victoires du roi Agadja (1708-1740) Pour Maire ce bas-relief est une représentation du siège de Lefou. Le roi Gézo (1818-1858) serait en personne sur l'échelle. Il s'agit d'aprè Maire de la forteresse d'Ocomey, située sur les bords de l'Ouémé. Il pourrait s'agir, comme le signale Maire, de la prise de Kenglo en pays mahi. Pour Maire ce bas-relief célèbre l'amitié entre un capitaine et le roi Agadja (1708-1740). Il s'agit plus vraisemblablement de commémorer l'ensemble des victoires de ce roi permettant au Dahomey de se désenclaver et d'avoir accès à la mer, donc aux Occidentaux et aux produits qu'ils apportaient. |
Notes
[1] Il s'agit ici du royaume du Danxome, partie méridionale de l'ancienne colonie du Dahomey puis de la République du Dahomey, aujourd'hui République du Bénin.
[2] Maire, V., Dahomey, tome I et II, Hyères, 1893-1903.
[3] Bibliothèques de l'Armée de Terre et de la Marine, Château de Vincennes, Paris.
[4] "Croquis rapportés par l'auteur, dessinés par M. Luc Franceschi", Maire, V., 1893-1903.
[5] Albéca, A.-L., (d') "Au Dahomey", Le Tour du Monde, ndeg. 5-6-7-8, août 1894, pp. 65-128, ndeg. 7, p. 110. D'Albéca fut nommé en 1893 administrateur de Ouidah.
[6] A ce sujet, v. Biton, Marlène, Les bas-reliefs royaux d'Abomey, Bénin ex-Danxome, thèse N.F., avril 1996, Paris-I-Panthéon-Sorbonne.
[7] Il fuit sa capitale le 16 novembre 1892 et se rend aux Français en février 1894. Exilé au fort Tartenson à la Martinique, il ne se rapprochera de l'Afrique que peu de temps avant sa mort en 1906.
[8] Bouche, Pierre (Abbé), La côte des esclaves et le Dahomey, 7 ans en Afrique occidentale, E. Plon et Nourrit, Paris, 1885 et Fonssagrives, Eugène, "Au Dahomey, souvenir des campagnes de 1892-1893", Bulletin et mémoires de la société africaine de France, nov-déc. 1894, Librairie Africaine et coloniale, Paris, pp. 209-255.
[9] Bienvenu Akoha, linguiste béninois, remarque que ce mot signifie littéralement /reine/porte/ sur/ "Sur la porte de la reine". Nahondji est un lieu..."situé dans le palais royal central... ". C'est possiblement l'endroit où serait enterrée la mère du roi Glélè, Nan Zognidi ".
[10] Biton, Marlène-M., L'art des bas-reliefs d'Abomey, Bénin-ex-Dahomey, Harmattan, Paris, 2000 et 1996.
[11] Maire, 1903, p. 53.
[12] Maire, 1903, p. 53.
[13] Maire, 1893-1903, p. 51.
[14] " Une sur dix est armée d'un énorme couteau en forme de rasoir qui peut s'ouvrir et fermer; le manche a presque un mètre de long et la lame autant. Un coup ... peut couper un homme en deux Journal de Francesco Borghero, premier missionnaire du Dahomey, 1861-1865, Karthala, 1997, Paris, p. 77.
[15] Maire, V., 1893-1903, p. 45.
[16] Chefs-d'oeuvre du maître fondeur hollandais Conraert Wegenwaert de la Haye. Ces pièces " avaient été fondues en 1640 Dunglas, 1957, t. II, p. 13-14. Cet auteur précise que l'une se trouve toujours au Musée d'Abomey, la seconde fut abandonnée près d'Ichaga au retour du siège d'Abéokuta, le 3 ou le 4 mars 1851 (no 1, p. 14).
[17] Dunglas, Ed., 1957, tome II, p. 13-19.
[18] Population de Ouidah.
[19] Lettre de Bullfinch Lamb (employé du comptoir anglais de Djakin, venu pour affaires à Allada où il fut fait prisonnier par les Dahoméens lors de la prise de la ville) écrite le 27 novembre 1724, Dunglas, Ed., 1957, tome I, p. 150.
[20] Maurice, Albert-Marie, Peuples du nord-Bénin (1950), Académie des sciences d'Outre-mer, Paris, 1986, pl. XXI, XXIII, XXV, XLIII et XLVII.
[21] Kupcik, Ivan, Cartes géographiques anciennes, Grund, Paris, 1984, p. 27.
[22] Verger, Pierre, " Le fort St-Louis de Grégoy ", Etudes dahoméennes, IRAD, 1966.
[23] Norris, Robert, Mémoires du règne de Bossa-Ahadée, roi de Dahomé, Etat situé à l'intérieur de la Guinée; et voyage de l'auteur à Abomé qui en est la capitale, Gattey, Paris, 1790, p.120.
[24] Maupoil, Bernard, " Contribution à l'étude de l'origine musulmane de la géomancie dans le bas- Dahomey ", Journal de la Société des Africanistes, Paris, 1943.
[25] Maire, V., 1903, p. 53.
[26] Populations voisines vivant au nord d'Abomey.
[27] Euschart se rendit à Abomey en juillet 1862, la crucifixion eut lieu le 4 juillet 1862.
[28] Répin, "Voyage au Dahomey", Le Tour du monde, 2e sem., 1863, pp. 65-112. (description p. 110 et gravure p. 105). Pour Euschart (récit noté par le Ct. Perry en aôut 1862) il s'agit de la mort d'un ministre anglican, Willam Doherty. Edouard Dunglas affirme qu'il s'agit là, d'une erreur: Doherty, sujet britannique du Sierra Leone fut libéré et un second prisonnier, Moses Osoko, un Egba, fut crucifié. Dunglas se fonde sur les chants dahoméens qui racontent la vengeance de Glélé et la prise d'Ichaga en nommant un certain Mossissi (Moses), Dunglas, Ed., " Contribution à l'histoire du moyen-Dahomey ", Etudes dahoméennes, ndeg. XIX, Vol. I-III, IFAN, Porto-Novo, 1957, pp. 111-114.
[29] Ichaga fut détruite le 5 mars 1862, Bouche, Pierre (Abbé), La côte des esclaves et le Dahomey, 7 ans en Afrique occidentale, E. Plon et Nourrit, Paris, 1885, p. 358.
[30] La vengeance se consomme froide. En effet, Ichaga aurait reçu l'armée d'Abomey lui offrant de " l'eau pure, signe d'amitié sincère et de loyauté " et prévenu Abéokuta de son approche, le 2 mars 1851. Glélé était donc décidé à venger cette offense infligée à son père, Gézo (1818-1858). Onze années plus tard, le crâne du roi Bakoko (Oba Koko) servira de coupe montrant ainsi comment Abomey se venge. Dunglas, Ed., 1957, p. 110-111.
[31] Dunglas, Ed., 1957, p. 111, (Burton, t. I p. XIII).
[32] Dunglas, Ed., 1957, p. 111.
[33] Waterlot, E.-G., Les bas-reliefs des palais royaux d'Abomey, Institut d'Ethnologie de Paris, ndeg. 1, 1926, pl. V, B. et Biton, M., "Emmanuel-Georges Waterlot et les bas-reliefs d'Abomey", Arts d'Afrique noire, arts premiers, automne 1999, pp. 28 - 39.
Après avoir travaillé au Musée de l’Homme, au Musée des Arts africains et océaniens puis au Musée des Arts et Traditions populaires, Marlène Biton a été affectée à l’équipe mixte CNRS/ PARIS-I-PANTHEON-SORBONNE, (UMR 8592) où elle travaille en particulier sur l’évolution de la réception en Europe des objets africains. Elle est aussi chargée de cours à Paris-I, en Arts et Sociétés de l’Afrique subsaharienne.
En 1996, elle a soutenu une thèse (NF) à Paris-I-Panthéon-Sorbonne sur "Les bas-reliefs royaux d’Abomey, Bénin, ex-Danxome" et elle vient de publier l’ouvrage L’art des bas-reliefs d’Abomey (Collection Les arts d’ailleurs n°1, L’Harmattan : Paris, sept. 2000, 240 p.)
Au nombre de ses publications, on relèvera divers articles sur des vodoun dahoméens, tel que Gou, divinité du fer et de la guerre : "Question de Gou" Arts d’Afrique noire, arts premiers, pp. 25-34, Arnouville, automne 1994; ou un vodoun, Legba, lié à de nombreux aspects de la vie quotidienne : "Legba, une divinité singulière du Golfe du Bénin", Définitions et fonctions, Arts d’Afrique noire, arts premiers, pp. 25- 34, décembre 1997 ; "Legba, une divinité singulière du Golfe du Bénin, Caractéristiques psychologiques et esthétiques", Arts d’Afrique noire, arts premiers, mars 1998.
L’histoire l’intéresse également. Dans le cadre du 150e anniversaire de la 2e loi d’abrogation de l’esclavage (Schoelcher), elle a rédigé : "Traite, esclavage et abolitions en France", Mémoires et métissages, n°1, février 1999, pp. 6-25, ed. du Phare, Champigny.
Dans le domaine des Arts et du statut de l’artiste elle a publié : "Waterlot et les bas-reliefs d’Abomey", Arts d'Afrique noire, arts premiers, octobre 1999, pp. 28-39 ;
"Le statut de l'artiste dahoméen, un exemple, Akati Ekplekendo, le maître de Gou. Ni Anonyme, ni impersonnel" 3e colloque européen sur les arts d'Afrique noire, Collection arts d'Afrique noire, arts premiers, 23 oct 1999, pp. 19-26.
Elle a collaboré dernièrement au catalogue d’une exposition des objets non-européens au Louvre : "Notice sur Gou", Catalogue de l’exposition de la Mission de Préfiguration du Musée des Arts et civilisations, Louvre, ed. R.M.N., Paris, avril 2000 ; "Notice société (Gou)", CD-ROM / Réunion des musées nationaux/, Musée du quai Branly, avril 2000 ; "Notice usage (Gou)", CD-ROM / Réunion des musées nationaux/ musée de Branly, avril 2000.
Back to [the top of the page] [the contents of this issue of MOTS PLURIELS]





